lundi, 08 avril 2024
Communisme et communautarisme
Communisme et communautarisme
Carlos X. Blanco
Le communautarisme de Costanzo Preve se démarque de tout mouvement intellectuel nostalgique qui cherche à retourner à la communauté organique vierge. Le philosophe italien la présente comme une sorte de déduction sociale de catégories socio-ontologiques. Elle naît de « la détection des contradictions dégénératives du monde moderne et de la même réflexion autocritique radicale sur la même expérience du communisme historique » (De la Comuna a la Comunidad, Fides, Tarragone, 2019, p. 126; édition par Carlos X. Blanco, désormais les citations en sont tirées).
Cela n’a aucun sens de parler d’une opposition abstraite entre l’individu et la société. Les deux pôles sont des « concepts conjugués » au sens de Gustavo Bueno: des paires de concepts qui naissent ensemble mais qui s'entrelacent et s'opposent tout au long de leur développement historique, avec lesquels nous nous retrouvons dans une situation où non seulement l'un exige de l'autre, et vice-versa, mais les deux concepts co-déterminent et influencent le développement réciproque. Il n’y a jamais eu d’individu sans société ni de société sans individu mais, par ailleurs, le rôle que joue chacun des pôles pour son opposé/complémentaire est le résultat d’une évolution, une évolution qui forme le contexte environnant de déterminations réciproques.
L'individu est le fruit de la société (trouver un partenaire, procréer de nouveaux individus, fermer un couple et un environnement familial aux étrangers, etc.) et les actes sociaux sont des actes dans lesquels se forment des communautés et des individus, co-déterminant les deux extrêmes, l'individualité et le groupe communautaire. L’« individu » n’est pas le même à Rome, au Moyen Âge ou dans le capitalisme: précisément l’individu moderne différencié est le résultat de conditions socio-économiques et historiques très spécifiques. L’individu véritablement différencié est le résultat d’un processus graduel, d’un développement qui coïncide avec la « société bourgeoise » et, par conséquent, la fin de cette même société bourgeoise (et non la fin du capitalisme) peut signifier la fin de l’individu différencié.
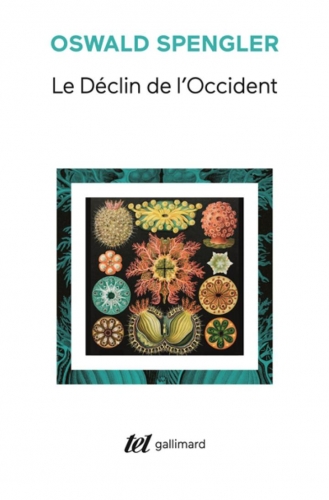
Le magnum opus de Spengler, Le déclin de l'Occident, est le lieu où nous pouvons en apprendre davantage sur cette profonde transformation de l'Europe et des pays qui ont hérité de sa culture: la conversion de sociétés d'individus différenciés en sociétés de « fourmis ». Dans des cages de ciment, de béton et de verre, sont enfermés des millions d'êtres humains, détachés de toute parcelle et de tout flux de tradition et de sang, des hommes froids et sans « caste », très semblables les uns aux autres, absolument interchangeables, produits après d'innombrables mélanges somatiques et spirituel. Le capitalisme tardif considère l’individu de « caste », quelle que soit sa race, comme un obstacle et un ennemi. Le capitalisme cosmopolite nourrit la décadence sociale et produit des fourmilières humaines; il est l’ennemi de la personnalité individuelle. Seul le communisme – la seule solution rationnelle au post-capitalisme – peut signifier le retour de la personnalité individuelle.
L'accumulation capitaliste est destructrice. Cela dissout non seulement la communauté humaine mais le concept même d’individu (p. 129). La création de poches et de bastions communautaires, ainsi que la fortification de ceux qui existent et qui survivent, constituent un défi à l’accumulation capitaliste et une plate-forme pour un avenir communiste. C’est ramer et nager à contre-courant: le courant néolibéral qui, à partir du protestantisme ultra-individualiste, détruit l’individu, doit être contrebalancé et vaincu par le communautarisme.
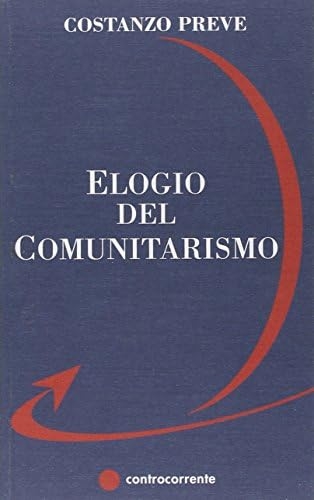
La proposition de Costanzo Preve est extrêmement innovante et provocatrice: éliminons chez Marx la lecture « futuriste » de son œuvre et plaidons pour une interprétation « traditionaliste ». Selon l’auteur italien « Marx est un épisode d’une tradition (…) née en Grèce (…) qui s’oppose de manière cyclique aux tendances dissolvantes et destructrices de l’accumulation anomique des richesses individuelles… » (p. 169). Et aujourd’hui, alors que nous approchons du premier tiers du 21ème siècle, cette tendance anomique et atomiste est de plus en plus forte. Nous vivons une vague d’intense atomisation et de centrifugation sociale. Les deux classes sociales appelées à la lutte « motrice » qui pousse l’Histoire (bourgeoisie et prolétariat) s’effondrent. Le prolétariat d’Occident s’est affaibli, et la gauche est allée chercher des poches de population « offensées » pour des raisons partielles ou identitaires afin de capter des voix, et refaire « le sujet anticapitaliste ». Mais ces poches d’« offensés » sont des minorités qui, même si elles peuvent parfois être marginalisées, discriminées, etc., prises comme des catégories abstraites, finissent, quand les choses évoluent, en groupes parfaitement intégrés au système capitaliste: loin de rejeter le système, les groupes LGTBIQ+, les groupes d'immigrés, les régionalistes et les nationalistes fractionnaires, les écoféministes , etc., ont tendance à chercher un bon ancrage dans le système, et même à le renforcer, pour peu qu'ils reçoivent (au moins en partie) un traitement privilégié. La vraie gauche doit commencer à comprendre que les causes partielles et identitaires n’ont rien à voir avec la lutte anticapitaliste. La vraie gauche doit s’éloigner définitivement de « l’identitarisme » car sa logique interne coïncide et fonctionne avec la dynamique du mode de production capitaliste. Ce régime, comme ceux qui l'ont précédé, tend à ségréguer les classes privilégiées qui, en échange de servir loyalement les services du capital, détournent une partie de la population de l'exploitation pure et simple, et la placent dans une situation privilégiée grâce à certaines miettes de pouvoir, la plus-value extraite.
Mais non seulement la classe ouvrière disparaît face à ces « nouveaux collectifs » identitaires qui usurpent les fonctions de la classe ouvrière, devenant en réalité des serviteurs du Capital, mais la bourgeoisie disparaît également. Comme l’écrit Preve, le capitalisme « a licencié » la bourgeoisie, sans même la remercier pour les services rendus. La bourgeoisie, comme le dit le Manifeste du Parti Communiste, a démoli toutes les frontières et tous les murs – ceux de l’Ancien Régime, avec ses résidus féodaux, et les murs des cultures exotiques, c’est-à-dire extra-européennes. De même, la bourgeoisie historique a franchi le Rubicon de la science et de l’innovation technologique. Sous et autour d’elle s’étaient créées diverses couches de classes moyennes qui garantissaient le recrutement efficace d’ingénieurs, de professeurs, de chefs d’entreprise, de professionnels libéraux, etc. qui, sans remettre en cause le régime capitaliste, l'a soutenu. Ils ont garanti la reproduction de ce qu’on appelle aujourd’hui le « capital humain » ou « capital cognitif » et ont multiplié les emplois bien rémunérés qui, à mesure qu’ils se développent, donnent une apparence de capitalisme mésocratique, toujours plus stable et apaisé. Mais si la bourgeoisie disparaît aujourd'hui, ces emplois et groupes mésocratiques disparaissent aussi et la dualisation de la société se fait encore plus féroce et dangereuse: en haut, nous avons une super-élite chaque fois plus réduite en nolmbre et éloignée du reste, non seulement de la nation mais de la réalité. En bas, une masse indifférenciée de précaires et de sous-prolétaires .
Dans cette situation, la gauche postmoderne développe de fausses idéologies – de la plus fausse conscience – malhonnêtes et insensées: abolition du travail, répartition du travail, revenu de base, salaire universel à vie… Nourrir le vice de la paresse, un vice antimarxiste, partout où il y en a - et les rêves de l'adolescence (passer sa vie à ne rien faire, mais avoir de l'argent pour ses vices et ses caprices), la tristement célèbre gauche de la postmodernité (ou du capitalisme tardif) ne fait rien d'autre que de produire les produits les plus idéologiques appropriés à la phase actuelle de l'évolution tardive du capitalisme: habituer les masses à une existence misérable, inactive, improductive et simplement consumériste.

La société que crée le turbo-capitalisme est une non-société: anomique, individualiste et, comme le dit Preve, sujette à l'extorsion fiscale, à la précarité de l'emploi, au nomadisme forcé (mobilité géographique pour des raisons professionnelles) et destructrice de la famille. Avec les mêmes titres avec lesquels on l'appelle « post-bourgeois », on peut aussi l'appeler « post-prolétarien ».
Preve est le philosophe marxiste idéal pour s’habituer aux temps difficiles à venir. En Occident, au moins, nous nous étions habitués à un travail stable et durable, à une famille stable (famille monogame, hétérosexuelle à vocation procréatrice), et sur cette base, à un État doté d'une certaine homogénéité ou de bon voisinage ethnique, garant de services publics d'une certaine qualité, avec des matelas qui atténuent les chutes ou les rechutes dans la pauvreté, etc. Eh bien, tout cela est parti. Depuis mai 1968, la gauche « radicale » ridiculise un monde bourgeois lié à un système économique, mais la critique des années 60 , qui inclut des développements structuralistes et autres développements non marxistes (Foucault, etc.), s'en est prise à la bourgeoisie en elle-même, et non à la bourgeoisie en tant que système injuste, irrationnel et exploiteur qui jusqu’alors pilotait la bourgeoisie.
Mais maintenant, en plus, la super-élite a expulsé la bourgeoisie ou l'a soumise, l'a placée sous sa domination, et le prolétariat a été désorganisé, réduit ou a été recruté dans des contingents qui se trouvent à l'étranger, très loin (délocalisation) ou a été importé en masse via les taxis cayuco, les « papiers pour tous » (réglementation massive) et d’autres techniques visant à promouvoir une migration massive visant à détruire le marché du travail national.
Mais une chose doit être claire. Si aujourd’hui le prolétariat ne peut pas être la classe véritablement révolutionnaire en Occident, il ne pouvait pas non plus l’être à l’époque de Marx. Jamais. La « mythologie du prolétariat » est, pour Preve, une irrationalité du mouvement communiste que le père fondateur lui-même, Marx, a alimenté:
« Le communisme continue de gérer le mythe sociologique du prolétariat comme seule classe « véritablement » révolutionnaire, un mythe philosophique de la fin de l’histoire (évidente sécularisation positiviste d’une religion messianique antérieure), une contrainte stupide à l’abolition de la religion, de la famille et de l'État, résultat d'une avant-garde extrêmement dépassée, d'une tendance incontinente à réglementer la liberté d'expression humaine de manière bureaucratique, d'un progressisme inertiel qui manque désormais de justification historique et, surtout, d'une conception collectiviste de la société" (p. 110).
La proposition précédente , comme on le sait, consiste à insérer le communisme dans une philosophie communautaire, ce qui implique de dissiper les nuages sombres qui ont éclipsé Marx (dans la vie) et, bien pire encore, le marxisme (c'est-à-dire post mortem). Le meilleur de la pensée de Marx consiste en une continuation de la pensée aristotélicienne: l'homme est par nature un animal politique; ainsi que de l'idéalisme allemand: l'homme est action, praxis transformatrice. Un régime de production qui l’annule, qui le castre, le rendant incapable de transformer le monde… est un régime qui doit à son tour être transformé (par des moyens révolutionnaires). Et il faut qu’il en soit ainsi avant qu’il ne soit trop tard.
19:44 Publié dans Définitions, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marxisme, communisme, communautarisme, costanzo preve, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 15 mars 2024
Le système fermé du capitalisme de guerre

Le système fermé du capitalisme de guerre
Markku Siira
Source: https://markkusiira.com/2024/03/08/sotakapitalismin-suljettu-systeemi/
Le système économique et politique occidental est "désespérément dépassé et devient donc un système fermé et totalitaire", affirme l'universitaire italien Fabio Vighi.
Les quelques super-riches (0,01 %) qui profitent encore du système capitaliste sont prêts à tout pour prolonger son existence. La dernière astuce des banquiers pour gérer et ralentir l'effondrement est toujours la même : la guerre.

Les gestionnaires du mécanisme capitaliste basé sur la dette sont des "technocrates à la recherche du profit dont le principal trait psychologique est la psychopathie", diagnostique M. Vighi. Ils sont "tellement dévoués au mécanisme qu'ils en sont devenus les prolongements - comme des automates, ils travaillent sans relâche pour le mécanisme, sans aucun remords pour la destruction de la vie humaine qu'il provoque".
Cependant, la psychopathie n'est pas l'apanage de la clique financière transnationale, mais s'étend à l'élite politique (des chefs de gouvernement aux administrations locales) et à ce que l'on appelle l'"intelligentsia" (qui comprend divers experts, scientifiques, philosophes, journalistes et artistes).
En d'autres termes, "quiconque entre dans le système doit en accepter les règles et, en même temps, en adopter ipso facto les caractéristiques psychopathologiques. C'est ainsi que l'objectivité capitaliste aveugle (la recherche du profit) devient inséparable des sujets qu'elle représente", philosophe Vighi.
Mais les technocrates désaxés surestiment-ils leur capacité à mettre en place un système fermé qui pourrait encore masquer la décadence du capitalisme ? "D'abord la farce tragique de la pandémie et maintenant les vents froids de la guerre en cours mettent à l'épreuve la confiance des citoyens moyens dans leurs institutions représentatives", spécule M. Vighi.
Il était relativement facile pour les opportunistes de la classe politique d'améliorer leur profil et de faire taire les sceptiques pendant l'urgence de l'ère Corona, mais "l'implication dans le génocide de Gaza, combinée à la création d'un front néo-mcarthyste et anti-russe et à l'accélération de la course aux armements, pourrait commencer à saper la confiance de la majorité silencieuse".
"Dans la nouvelle normalité totalitaire, nous faisons l'expérience d'une hyperréalité théorisée par Jean Baudrillard, qui n'est ni un fait ni une fiction, mais un contenant narratif qui les a remplacés tous les deux", explique M. Vighi en reprenant les termes du célèbre chercheur français en sciences sociales.
"Ainsi, le nettoyage ethnique brutal de Gaza se poursuit à toute vitesse, tout en exprimant sa préoccupation pour le sort des civils, en s'opposant à l'extrémisme et en mettant en garde contre les dangers de l'antisémitisme rampant".
"Dans le même temps, on nous rappelle 24 heures sur 24 que les Russes (qui d'autre ?) préparent une attaque nucléaire depuis l'espace et une attaque contre l'Europe."

Ce "tourbillon d'informations médiatiques crée un état d'hypnose collective qui s'avère plus efficace que la censure traditionnelle". Le discours officiel et stérilisé sur Gaza ou l'Ukraine, par exemple, "se transforme constamment en un discours sur le discours lui-même, strictement délimité par des binaires moralement préformulés (par exemple, démocratie/terrorisme)".
Vighi, homme de gauche, ramène tout à la vie économique, de sorte que même la manipulation actuelle des masses est historiquement établie "en tant que résultat de la virtualisation économique, dans laquelle la rentabilité du travail salarié a été remplacée par la rentabilité simulée du capital spéculatif".
Qu'il s'agisse d'un effondrement ou d'une correction drastique, les marchés financiers bénéficieront de l'augmentation des dépenses de défense. La production militaire pour les "engagements de sécurité à long terme" est désormais un soutien essentiel à une croissance réelle de plus en plus faible, mesurée par le PIB.
"Par exemple, sur les 60,7 milliards de dollars alloués à l'Ukraine dans le dernier plan d'aide, 64 % vont à l'industrie militaire américaine. La source n'est pas le TASS de Poutine, mais le Wall Street Journal, qui admet également que depuis le début du conflit en Ukraine, la production industrielle américaine dans le secteur de la défense a augmenté de 17,5 %", précise M. Vighi.
"La psychopathie qui alimente la guerre est en fin de compte une extension de la psychopathie économique, le résultat d'une prise de risque spéculative incontrôlée", conclut M. Vighi. L'industrie de l'armement est "un gardien de type Cerbère du capitalisme financier qui, dans sa version traditionnelle - un monde fantastique de plein emploi, de consommation de masse hédoniste, de croissance sans fin et de progrès démocratique - est mort et enterré depuis un certain temps".

Par conséquent, l'objectif inavoué des États-Unis et de leurs États vassaux est de "maintenir l'hégémonie militaire en tant qu'épine dorsale de l'hégémonie du dollar, et de protéger le stock de dette toxique déjà virtuellement insoutenable".
C'est pourquoi le Premier ministre estonien, Mme Kaja Kallas, a recommandé à l'UE la même stratégie de politique économique qu'à l'époque du coronatralalavirus : cette fois, il s'agit d'émettre des euro-obligations d'une valeur de plus de 100 milliards d'euros pour relancer l'industrie de guerre de l'UE.
Emprunter pour faire face à la menace russe et à d'autres "urgences apocalyptiques" promues par les (faux) médias du pouvoir est le dernier modèle économique du capitalisme de crise occidental. Les puissances vassales de l'Amérique, la Grande-Bretagne et les pays de l'euro, ont rapidement commencé à s'armer.
Alors que les tambours de guerre résonnent, nous entrons dans une "ère d'endettement militaire croissant". Comme l'a prédit le ministre britannique de la défense Grant Shapps, dans les années à venir, non seulement la Russie, mais aussi les autres ennemis jurés de l'Occident, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord, figureront dans une série de théâtres de guerre motivés par des considérations économiques.
Comme l'a déclaré Julian Assange en 2011, en faisant référence à l'Afghanistan, "l'objectif est une guerre sans fin, pas une guerre gagnée". Si l'on considère les conflits actuels dans le monde, il est plus probable que leur nombre augmente plutôt qu'il ne diminue.
Vighi prévient toutefois qu'il serait "trompeur de croire que le récit du "noble engagement militaire" de l'Occident n'est que le dernier épisode d'une série Netflix que nous pouvons nous permettre de regarder depuis nos canapés, à bonne distance".
Alors que le capitalisme financier vacille, ceux qui continuent à en profiter n'hésitent pas à sacrifier aux "bombes démocratiques" non seulement des populations comme les Palestiniens, longtemps abandonnées à une misère inhumaine, mais aussi les habitants des pays occidentaux, que la psychélite valorise "autant que du bétail en pâture avec un smartphone collé à leur museau".
"L'appel aux armes désormais permanent (contre le virus, Poutine, le Hamas, les Houthis, l'Iran, la Chine et tous les méchants à venir) sert de couverture désespérée et criminelle à une logique financière défaillante, à la merci du déclin économique et des crédits constants distribués sur les écrans d'ordinateur des banques centrales", déclare Vighi.
Le drame de l'urgence doit se poursuivre sans interruption, faute de quoi la bulle des profits éclatera. La cabale des banques centrales - la superclasse qui possède la Réserve fédérale et les sociétés de gestion d'actifs - "aura bientôt besoin de l'effet de levier de nouvelles urgences pour justifier la baisse des taux d'intérêt et l'injection de liquidités fraîchement imprimées dans le système".
Dans ce scénario de crises multiples, la classe moyenne occidentale est prisonnière de son passé. Elle est convaincue que "le capitalisme libéral démocratique d'après-guerre est non seulement fondamentalement juste en tant que modèle d'organisation sociale, mais aussi éternel et indiscutable". Ce n'est pas vrai, bien sûr, mais il est difficile de se défaire de l'illusion et de l'indulgence.
L'illusion est née pendant la Grande Dépression, lorsque les gens jouissaient d'un boom économique et faisaient partie d'un contrat social rentable, résultat de la "destruction créatrice" causée par les deux guerres mondiales. Aujourd'hui encore, nous sommes perdus dans le brouillard de la guerre. L'histoire va-t-elle bientôt se répéter ?
19:25 Publié dans Actualité, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : capitalisme, capitalisme de guerre, fabio vighi, actualité, théorie politique, sciences politiques, économie, politologie, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 05 mars 2024
Ordo ordinans: le caractère instituant du terme nomos

Ordo ordinans: le caractère instituant du terme nomos
Giovanni B. Krähe
Ex : http://geviert.wordpress.com/
On le sait, la dissolution de l'ordre médiéval a donné naissance à l'État territorial centralisé et délimité. Dans cette nouvelle conception de la territorialité - caractérisée par le principe de souveraineté - l'idée d'État a surmonté à la fois le caractère non exclusif de l'ordre spatial médiéval et le cloisonnement du principe d'autorité (1).
Parallèlement, l'avènement de l'ère moderne a entraîné une véritable révolution dans la vision de l'espace. Celle-ci s'est caractérisée par l'émergence, à travers la découverte d'un nouveau monde, d'une nouvelle mentalité globale. En ce sens, la relation évolutive entre ordre et localisation a introduit un nouvel équilibre entre terre et mer libre, ''entre découverte et occupation de fait'' (2). Il nous semble important à ce stade de souligner la spécificité de la relation qui caractérise un ordre spatial particulier. Il ne s'agit pas, comme on peut le déduire d'une première lecture de l'œuvre schmittienne, du simple changement des limites territoriales produit par le développement de la domination technique sur d'autres dimensions spatiales (terre, mer, air ou espace global). Toute modification des frontières de ces dimensions peut conduire à l'émergence d'un nouvel ordre, d'un nouveau droit international, mais pas nécessairement à l'établissement de cet ordre. C'est là que réside le concept de défi (Herausforderung) à partir duquel, pour Schmitt, une décision politique établit un nouveau nomos, qui remplace l'ancien ordonnancement de l'espace (3).

Dans cette perspective, nous pouvons considérer le concept de "politique" comme une approche théorique en réponse au défi ouvert laissé par la fin de l'État en tant qu'organisation non conflictuelle des groupes humains. De même, nous pouvons saisir, à travers les transformations du concept de guerre, la proposition théorique schmittienne d'une possibilité de régulation de la belligérance. Il est donc vrai qu'une décision politique peut aussi se résoudre en une simple relation de domination hégémonique, toute centrée sur l'autoréférentialité de sa politique de puissance. On ne peut pas parler dans ce cas de l'émergence d'un nouveau nomos car le problème de la conflictualité ne se pose plus en termes de possibilité de régulation. En ce sens, ce problème, si l'on se réfère à la guerre à l'époque moderne, caractérisée par l'ambiguïté du principe d'auto-assistance, devient une source inépuisable de nouvelles inimitiés:
"Les nombreuses conquêtes, dédicaces et occupations de fait (...) soit s'inscrivent dans un ordre spatial déjà donné du droit international, soit rompent ce cadre et tendent - s'il ne s'agit pas de simples actes de force éphémères - à constituer un nouvel ordre spatial du droit international"(4).
Nous avons dit qu'un ordre spatial donné peut émerger de la relation entre l'ordre et le lieu. La possibilité ouverte de fonder, au sens du défi lancé par Schmitt, un nouvel ordre dépend du caractère instituant de la décision politique. Le pouvoir constituant, qui émerge de cette décision, problématise dans ses fondements la relation considérée comme implicite entre actes constituants et institutions constituées, entre nomos et lex. Dans la synonymie évidente de ces deux catégories fondamentales, l'auteur introduit une distinction radicale. Cette distinction qui considère l'acte fondateur d'un ordre spatial donné à travers la spécificité prénormative de la décision politique est le caractère constitutif du terme nomos (5). Ce caractère pré-normatif du nomos n'est pas à comprendre dans le sens d'un droit primitif antérieur à l'ordonnancement de la légalité étatique, mais au sein d'une pluralité de types de droit. Dans cette perspective, c'est dans cette pluralité que se situe la norme, fondement du droit positif - constitué à son tour sur l'efficacité matérielle d'un espace pacifié.
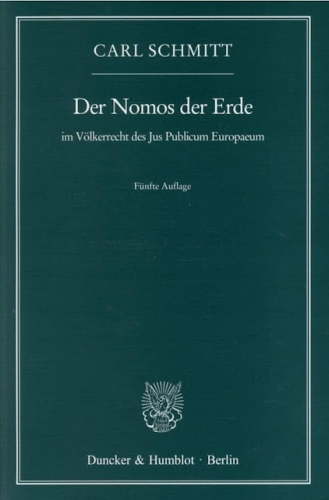
Or, pour Schmitt, le nomos "est un événement historique constitutif, un acte de légitimité qui seul donne sens à la légalité du simple droit" (6). Nous ne reviendrons pas ici sur cette opposition entre nomos et lex reprise à plusieurs reprises par l'auteur, car elle peut être comprise comme un processus unique ayant un caractère ordonnateur. Ce processus, qui est généralement opéré par la norme, est déjà, entre autres, implicite dans le nomos lui-même (7) . Ce qu'il nous intéresse de souligner à l'intérieur de ce processus d'ordonnancement, c'est plutôt la localisation du concept de guerre. Ainsi, en termes modernes, si le caractère instituant du terme nomos - au sens d'un ordo ordinans impérial ou fédéral comme le mentionne A. Panebianco - détermine le début d'un processus unique de structuration entre ordonnancement et localisation, alors le conflit peut être régulé s'il est placé à l'intérieur de ce processus. En ce sens, les catégories actuelles du droit international issues du principe du jus contra bellum (comme, par exemple, les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité) non seulement ne résolvent pas le problème en déclarant la guerre "hors-la-loi", mais réduisent la régulation de la belligérance à de simples actes de police internationale.
Notes:
(¹) La non-exclusivité réside dans la superposition de différentes instances politico-juridiques au sein d'un même territoire. Voir John Gerard Ruggie, "Territoriality and beyond : problematising modernity in international relations", in International Organization, no. 47, 1, Winter 1993, p. 150.
(2) Carl Schmitt, Le Nomos de la Terre (1950), Adelphi, Milan, 1991, p. 52.
(3) Cf. ibid. p.75 ; voir aussi Carl Schmitt, Terre et mer, Giuffrè, Milan, 1986, pp. 63-64 et pp. 80-82 ; sur le concept de défi, voir l'introduction (1963) à Id, Le categorie del 'politico', cit. pp. 89-100 in : Carl Schmitt : Il concetto di 'politico' (1932), in Id., Le categorie del 'politico', édité par G. Miglio et P. Schiera, Il Mulino, Bologna, 1972.
(4) Carl Schmitt, Le Nomos de la Terre, cité, p. 75 ; sur le rôle de l'Amérique entre hégémonie et nomos, cf. "Change of Structure of International Law" (1943), pp. 296-297 et "The Planetary Order after the Second World War" (1962), pp. 321-343 dans Carl Schmitt, The Unity of the World and Other Essays édité par Alessandro Campi, Antonio Pellicani Editore, Rome, 1994.
(5) Sur la distinction de Schmitt entre nomos et lex, voir Carl Schmitt, Il nomos della terra, cité, p. 55-62. Le caractère problématique que cette distinction introduit, en ce qui concerne le système juridique interne de l'État, a été développé par l'auteur dans Légalité et légitimité, in Id, Le categorie del 'politico' cit. p. 223 et suivantes.
(6) Carl Schmitt, Le Nomos de la Terre, cité, p. 63.
(7) Sur la spécificité processuelle du terme nomos, voir "Appropiation/Division/Production" (1958), in C. Schmitt, Les catégories du politique, cit. p. 299 et suivantes, et Id., "Nomos/Nahme/Name" (1959), in Caterina Resta, World State or Nomos of the Earth. Carl Schmitt entre univers et plurivers. A.Pellicani Editore, Rome, 1999.
21:07 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carl schmitt, théorie politique, politologie, philosophie politique, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 24 février 2024
L'État managérial néolibéral et les organisations non gouvernementales (ONG)

L'État managérial néolibéral et les organisations non gouvernementales (ONG)
Diego Fusaro
Source: https://posmodernia.com/el-estado-gerencial-neoliberal-y-...
La "managérialisation" de l'Etat, imposée avec grande arrogance après 1989, correspond en fait à sa neutralisation ou, plus précisément, à sa subsomption sous la dynamique économique qui a conduit à la réalisation de la prophétie de Foucault: "il faut gouverner pour le marché, au lieu de gouverner à cause du marché".
Le renversement du rapport de force traditionnel a finalement conduit au passage du marché sous la souveraineté de l'État à l'État sous la souveraineté du marché: en plein cosmopolitisme libéral, l'État n'est plus que l'exécutant de la souveraineté du marché.
Célébrée par la nouvelle gauche post-gramscienne et son programme (qui coïncide de plus en plus clairement avec celui de l'élite libérale), l'abolition de la primauté de l'État a contribué à libérer non pas les classes dominées, mais la "bête sauvage" qu'est le marché.
A l'ère de l'Etat à souveraineté limitée ou dissoute, la prérogative de superiorem non recognoscens est acquise de manière stable et directe par l'élite mondialiste qui prend le figure du seigneur néo-féodal, qui l'exerce à travers des organismes reflétant ses intérêts - de la BCE au FMI. L'économie planétaire a conquis le statut d'une puissance qui ne reconnaît rien comme supérieur.
Les entités privées et supranationales susmentionnées annihilent toute possibilité d'aborder avec des ressources publiques les questions sociales dramatiques et urgentes liées au travail, au chômage, à la misère croissante et à l'érosion des droits sociaux.

En l'absence du pouvoir édificateur de l'État, les élites ploutocratiques libérales-libertaires prêchent ouvertement et pratiquent discrètement, dans leur propre intérêt, la modération salariale, le contrôle des comptes publics et, bien sûr, la sanction d'un éventuel non-respect. En même temps, elles peuvent récupérer tout ce qu'elles ont perdu dans les conflits de classe, c'est-à-dire tout ce que le mouvement ouvrier a réussi à obtenir au cours du 20ème siècle - le siècle des conquêtes ouvrières et sociales, et pas seulement des "tragédies politiques" et des totalitarismes génocidaires: de l'entrée du droit sur le lieu de travail à la formation des syndicats, de l'éducation gratuite pour tous aux fondements de l'État-providence.
En outre, le fanatisme économique de classe peut facilement utiliser les idéologies du passé, liées à des projets politiques ayant ignominieusement échoué, comme une ressource symbolique négative pour se légitimer. Il peut désormais se présenter comme préférable à toute expérience politique antérieure, ou liquider a priori tout projet de régénération du monde et toute passion utopique-transformatrice, immédiatement assimilés aux tragédies du 20ème siècle.

La proclamation de la Fin de l'Histoire est proposée, depuis 1992, comme le condensé idéologique du monde d'aujourd'hui entièrement subsumé par le capital. Emblématique de la philosophie destinaliste du progrès capitaliste de l'histoire, elle a réussi à installer dans la mentalité générale la nécessité de s'adapter aux nouveaux rapports de force. Et cela, d'ailleurs, avec la conscience - cynique ou euphorique, selon les cas - d'être parvenu au terme de l'aventure historique occidentale, achevée avec la liberté universelle du marché planétaire et l'humanité réduite à l'état d'atomes consommateurs solitaires, à la volonté de puissance abstraitement illimitée et concrètement coextensive par rapport à la valeur d'échange disponible.
Fonctionnelle pour l'alignement général sur l'impératif du ne varietur, la démystification postmoderne des grands méta-récits a procédé de pair avec l'imposition d'un seul grand récit autorisé et idéologiquement naturalisé dans une seule perspective admise comme vraie: le storytelling usé et la vulgate libérale abusive de la Fin de l'Histoire destinaliste dans le cadre post-bourgeois, post-prolétarien et ultra-capitaliste, inauguré avec la chute du Mur et avec la cosmopolitisation réelle du nexus de la force capitaliste.

Il suffit de rappeler ici, à l'aide d'un exemple concret tiré de notre présent, le rôle de ce qu'on appelle les "organisations non gouvernementales". Celles-ci, avec les entreprises multinationales et déterritorialisées, ont contesté la prédominance des Etats. Derrière la philanthropie avec laquelle ces organisations prétendent agir (droits de l'homme, démocratie, sauver des vies, etc.), se cachent les intérêts privés du capital transnational.
Les Organisations Non Gouvernementales, en réalité, revendiquent d'en bas et depuis la "société civile" les "conquêtes de la civilisation", les "droits" et les "valeurs" établis d'en haut par les Seigneurs du mondialisme niveleur qui "per sé fuoro" (Inferno, III, v. 39), les nouveaux conquérants financiers et les gardiens de la grande entreprise du marché supranational sous l'hégémonie de la spéculation capitaliste privée.
Ces conquêtes, ces droits et ces valeurs sont donc toujours et uniquement ceux de la classe mondiale compétitive, idéologiquement présentés comme "universels": démolition des frontières, renversement des États voyous (c'est-à-dire de tous les gouvernements non alignés sur le Nouvel ordre mondial unipolaire et américano-centré), encouragement des flux migratoires au profit du cosmopolitisme d'entreprise, dé-souverainisation, déconstruction des piliers de l'éthique bourgeoise et prolétarienne (famille, syndicats, protection du travail, etc.).
Dans cette perspective, sous le vernis humanitaire des ONG, on découvre le cheval de Troie du capitalisme mondial, le tableau de bord de l'élite cosmopolite, avec sa règle fondamentale impitoyable (business is business) et son assaut contre la souveraineté des Etats.
Si elles ne sont pas analysées selon le schéma imposé par l'hégémonie de l'aristocratie financière, les organisations non gouvernementales se révèlent être un moyen puissant de contourner et de saper la souveraineté des États, et de mettre en œuvre point par point le plan mondialiste de la classe dirigeante, en vue de la libéralisation définitive de la réglementation politique des États-nations souverains en tant que derniers bastions des démocraties.

L'affrontement entre les ONG et les lois des Etats nationaux ne cache pas, comme le répètent les maîtres du discours, la lutte entre la philanthropie, celle de "l'amour de l'humanité", et l'autoritarisme inhumain; au contraire, on y trouve la guerre entre la dimension privée du profit des groupes transnationaux et la dimension publique des Etats souverains qu'ils assiègent.
Plus précisément, pour ceux qui s'aventurent au-delà du théâtre vitreux des idéologies et affirment la volonté de savoir de la mémoire foucaldienne, à l'horizon de la mondialisation comme nouvelle étape du conflit cosmopolitisé entre Seigneur et Serviteur (le Maître et l'Esclave, Hegel), les organisations non gouvernementales apparaissent comme les instruments idéaux pour l'imposition d'un agenda politique mûri en dehors de tout processus démocratique et protégeant exclusivement les intérêts concrets de la classe hégémonique.
Cette dernière, d'ailleurs, grâce au travail diligent des anesthésistes du spectacle, calomnie de "souverainiste" - énième catégorie frauduleuse inventée par la néo-langue des marchés - quiconque ne dit pas définitivement adieu au concept de souveraineté nationale. Bastion de la défense des démocraties développées au sein des espaces étatiques encore réfractaires au Nouvel Ordre Mondial (qui est post-démocratique au même titre qu'il est post-national), l'objectif est que la notion même de souveraineté nationale soit idéologiquement dégradée en un instrument d'agression et d'oppression, d'intolérance et de xénophobie.
20:29 Publié dans Actualité, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : diego fusaro, néolibéralisme, ong, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 20 février 2024
Définir ce qu'est la "sécurité nationale"

Définir ce qu'est la "sécurité nationale"
Ronald Lasecki
Source: https://ronald-lasecki.blogspot.com/2024/02/kwestia-bezpieczenstwa-narodowoego.html
Sur la chaîne Centrum Edukacyjne Polska (= Education Centre Poland), animée par Rafał Mossakowski, le député Grzegorz Braun, récemment plus connu pour ses interventions parlementaires avec un extincteur, a classé les questions de l'anti-avortement et de la déviance sexuelle dans le domaine de la "sécurité nationale" dans l'une de ses émissions.
La sécurité nationale
Le terme "sécurité nationale" est apparu pour la première fois dans la littérature occidentale avec la publication de la loi américaine sur la sécurité nationale de 1947 et la création d'institutions chargées de mettre en œuvre ses dispositions. Ainsi, Andrzej Zapałowski, expert en la matière (et en même temps membre de la Diète de la dixième législature sur la liste Konfederacji Korony Polskiej a défini la "sécurité nationale" comme "la capacité d'une nation exprimée par son organisation sous forme d'organes institutionnels de défense à protéger sa population, son territoire, ses valeurs culturelles et son potentiel matériel tant à l'intérieur de l'État que dans l'environnement international" (A. Zapałowski, entrée "Sécurité nationale" [in :] L. Sykulski (éd.), Mały leksykon geopolityki (= "Petit lexique de géopolitique"), Częstochowa 2016, pp. 19-20).
La sécurité nationale est la protection de ces valeurs, dont la menace constituerait un danger pour la survie de la nation dans un avenir proche ou lointain, et la neutralisation de ces menaces internes et externes, dont l'actualisation menacerait la survie de la nation dans un avenir proche ou lointain. La sécurité nationale est donc liée à la survie et à la vie de la nation, occupant une place de premier plan parmi les objectifs de la politique nationale.
L'intérêt national
En ce sens, la catégorie de la "sécurité nationale" se confond avec celle de l'"intérêt national". Ce dernier, selon le fondateur de l'école des relations internationales de Varsovie, Józef Kukułka (Tenże, "Problems of the Theory of International Relations", Varsovie 1978, pp. 262, 264-265 et al.), est la résultante des besoins d'une communauté donnée et de la possibilité de leur satisfaction par cette communauté ; les besoins articulés et adaptés pour être satisfaits deviennent des intérêts, sur la base desquels le centre de décision indique les objectifs politiques.

J. Kukulka
Objectifs existentiels
Les objectifs conditionnant la survie et la vie d'un organisme politique donné sont appelés "existentiels" par J. Kukułka (qui les distingue des objectifs "coexistentiels" et "fonctionnels"), les liant à la poursuite de la satisfaction des "besoins matériels et de conscience de l'État dans la mesure où ils assurent sa survie, sa sécurité, son identité et son développement" (J. Kukułka, "La politique étrangère en tant qu'élément du processus des interactions internationales", "Relations internationales" vol. 4/1987, p. 11). Bien que J. Kukułka ne se réfère qu'aux actions extérieures de l'État, nous pensons qu'elles caractérisent tout aussi bien le reste des actions politiques de l'État.
Ethnopolitique
Le créateur du terme "géopolitique", le politologue suédois et homme politique conservateur Rudolf Kjellén (1864-1922), dans son ouvrage le plus célèbre en dehors de la Suède, "L'État en tant qu'organisme vivant" (1916), considère l'"ethnopolitique" comme l'une des dimensions de l'organisme politique éponyme (c'est le titre du chapitre III de son ouvrage précité - "Staten som folk (etnopolitik)", pages 76-124 de l'édition de Stockholm de 1916), incluant des facteurs tels que la taille de la population, la cohésion ethnique, la santé de la population, son identité historique et le moral national. Ces facteurs ont été considérés par les conservateurs et les universitaires suédois comme des variables qui déterminent la vitalité et l'état d'un corps politique donné.
Dans toutes ces théories, on retrouve le thème des "ressources humaines" biologiques et culturelles qui contribuent à un organisme politique donné (communauté politique) ou, en d'autres termes, dont l'État dispose. Elles sont une composante élémentaire et donc nécessaire de tout organisme politique, sans laquelle il ne peut exister.
Les positions marxistes
Les spéculations marxistes selon lesquelles les facteurs démographiques et ethniques perdront à l'avenir leur importance pour le maintien de l'ordre politique et civilisationnel, parce que le travail humain sera remplacé par le travail mécanique, sont à jeter à la poubelle. Tout d'abord, pour diverses raisons - nous y reviendrons dans un instant -, les machines ne peuvent remplacer que certains types de travail humain ; plus précisément, le travail mécanique qui n'exige pas de réflexion qualitative et de compréhension profonde, et, contrairement aux apparences, les exigences à cet égard s'appliquent également à de nombreuses activités et types de travail peu valorisés et mal payés dans la civilisation occidentale gynécocratique d'aujourd'hui.

Les positions futuristes
Deuxièmement, et comme nous l'avons indirectement évoqué plus haut, les prédictions des adeptes de l'intelligence artificielle, censée remplacer la pensée humaine, sont également à mettre à la poubelle. L'intelligence artificielle, au sens propre, est la capacité des ordinateurs à apprendre sans intervention humaine. Elle résulte de l'augmentation de la vitesse et de la puissance de calcul des ordinateurs. Sa nature est purement "extensive" et reste aux antipodes de phénomènes et de qualités tels que la "vie", la "personnalité", la "pensée" ou la "compréhension". L'intelligence artificielle n'est encore qu'un ordinateur - qui recalcule plus efficacement mais ne se rapproche même pas, non seulement de l'homme, mais aussi de tout autre organisme vivant, en termes de "conscience" et de "compréhension".
Un organisme, pas un mécanisme
En combinant les deux paragraphes précédents, nous arrivons à la question du besoin naturel de l'homme pour des communautés organiques et des groupes primaires, à travers lesquels il forme son identité, ainsi que sa compréhension de la réalité. Ce besoin naît de la pensée "qualitative", de la compréhension "significative", qui englobe la perception symbolique. Il s'agit d'une nature que l'intelligence artificielle non naturelle ne peut atteindre et qui fausse les concepts programmatiquement anti-nature, économistes (autrefois) ou "culturalistes" (aujourd'hui) des marxistes. Non seulement les humains ne seront pas remplacés par des machines sous une forme ou une autre, la Vie ne sera pas remplacée par un algorithme, mais les humains ne deviendront pas de simples rouages d'une machine de production globale.
La sécurité biologique
Pour l'organisme politique, c'est donc toujours une question de sécurité nationale que la reproduction biologique de sa population (l'"ethnopolitik" de Kjellen). Dans diverses circonstances historiques, les organismes politiques peuvent également "tomber malades" en raison d'une dynamique démographique excessive. L'histoire connaît de nombreux cas de ce type, dont le plus récent, très discuté, est par exemple l'explosion démographique du Bharat après la Seconde Guerre mondiale. La Pologne a connu ce problème pour la dernière fois au début du 20ème siècle, lorsque la surpopulation (selon le niveau d'organisation économique de l'époque) touchait la campagne galicienne, et sous la Seconde République, lorsque les migrants de la campagne polonaise partaient encore pour l'Amérique.
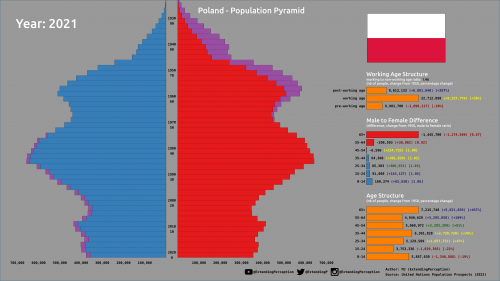
Mais aujourd'hui, la dynamique démographique de la Pologne est insuffisante et menace à moyen terme le maintien d'une productivité suffisante de l'économie et la pérennité non seulement du système de retraite par répartition, mais aussi du système de sécurité sociale et de santé. La question de l'augmentation du taux de natalité, même jusqu'au niveau du simple remplacement des générations, est donc une nécessité existentielle pour la Pologne.
Sécurité culturelle
Le cadre institutionnel permettant d'atteindre cet objectif politique sera sans aucun doute la famille nucléaire et le mariage, qui sont les sujets de la reproduction biologique. Si l'on inclut également dans l'analyse la question de la reproduction culturelle (formation morale et axiologique, éducation à une vie créative et socialement valable, sécurité sociale au sens large, transmission de la tradition et de la sagesse, etc.), on constate la nécessité de faire revivre des tribus et des communautés plus larges, comme les clans et les clusters.
Actions hostiles
À ces deux niveaux - reproduction biologique et reproduction culturelle - la l'interruption volontaire de grossesse constitue une menace existentielle : elle menace la reproduction biologique, tout en étant un facteur de désorganisation des institutions sociales et en compromettant les attitudes et les visions du monde nécessaires à leur maintien. L'avortement doit être considéré comme un phénomène relevant d'une menace pour la sécurité nationale et sa promotion doit être considérée comme créant une telle menace, donc comme une action qui nuit à l'ensemble de l'organisme politique, c'est-à-dire comme une action nuisible.
Dans le cas de la promotion directe ou indirecte (par exemple par le biais d'un financement) de l'avortement par des acteurs extérieurs tels que des organisations internationales, des États ou des organisations "non gouvernementales", ces acteurs doivent être considérés comme menant une action préjudiciable. En tant que représentation institutionnelle de la communauté politique, l'État devrait déclarer la reconnaissance de la reproduction biologique et des institutions culturelles de sa population comme une valeur existentielle et mettre en garde contre tout préjugé à leur égard.
La promotion de l'avortement, contrairement à ces déclarations de l'État, devrait être considérée comme un acte hostile, une agression axiologique, une agression informationnelle, une idéo-toxification ou même, dans des cas extrêmes, un moyen de "guerre par des moyens non militaires". La catégorie de ces menaces est bien connue depuis le voisinage de la Deuxième République avec les Soviétiques et les tentatives de pénétration communiste transfrontalière de Moscou à l'époque. Par ailleurs, durant l'occupation allemande de la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas un hasard si les Allemands ont favorisé la promotion de l'avortement chez les femmes polonaises.
Au cours des premières décennies de la guerre froide, les pays occidentaux ont dû faire face à une pénétration communiste similaire, alors que depuis 1975, avec l'aide de l'universalisme de "droite", ils ont eux-mêmes fait de telles tentatives de décomposition dans d'autres pays du monde. Les participants au système de Vienne (établi en 1815), puis à l'"alliance des trois empereurs" d'Europe orientale (Allemagne-Russie-Autriche-Hongrie) étaient déjà sensibles à la question de l'idéo-toxicité démo-libérale.
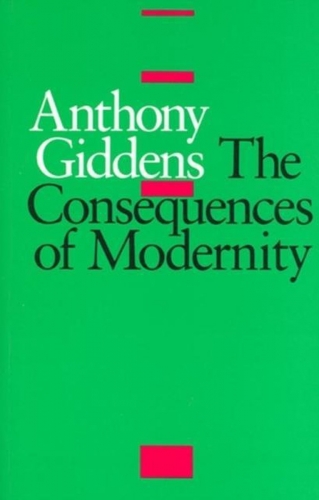
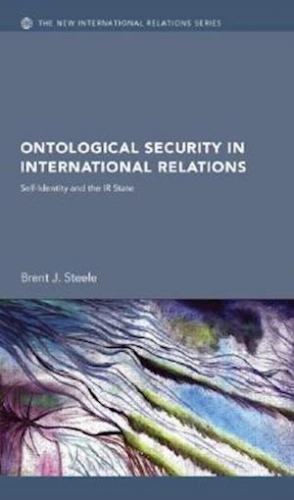
La sécurité ontologique
Nous arrivons ici à la catégorie de la "sécurité ontologique", théorisée par le sociologue Anthony Giddens (The Consequences of Modernity, Stanford 1990) et le politologue Brent J. Steele (Ontological Security in International Relations. Self-Identity and the IR State, New York-Londres 2008), comme une sorte de sentiment d'identité et d'enracinement culturel et social, qui sont des sources de confort psychologique pour l'individu. La "sécurité ontologique" pourrait être comparée en ce sens à la catégorie du Dasein ("être-au-monde") du philosophe allemand Martin Heidegger. A. Giddens associe étroitement la sécurité ontologique aux facteurs idéationnels, c'est-à-dire à l'influence des idées, des croyances, des valeurs, des traditions, de la culture et d'autres facteurs immatériels sur le comportement humain et les processus sociaux.
La sécurité ontologique de la communauté politique polonaise est donc son identité ou, plus précisément, les éléments adaptatifs de cette identité, c'est-à-dire tout ce qui confère à la communauté politique polonaise un avantage concurrentiel sur les autres communautés. Il s'agit sans aucun doute des éléments de l'identité collective de la personnalité culturelle polonaise, des éléments du tempérament et de la mentalité de l'ethnos polonais, des attitudes et des institutions sociales de l'organisme politique polonais qui soutiennent la reproduction biologique de la population, l'environnement naturel et la reproduction culturelle de la population. Il s'agit sans aucun doute de l'identité de genre, d'une sexualité saine, du mariage, de la famille, de la fécondité. Il faudrait éventuellement discuter de l'appartenance à un clan et du renforcement du patriarcat.
Les facteurs idéologiques menaçants comprennent la relativisation, voire la négation de l'identité sexuelle, la promotion de la perversion sexuelle, la déconstruction du mariage au profit de la permissivité sexuelle, la déconstruction de la famille au profit de l'individualisme combiné à la pornographisation de la culture ("culture de l'onanisme" au lieu de "culture de la famille"), la déconstruction de la fécondité au profit de l'avortement. L'idéologie kitsch des "valeurs familiales" sentimentales (famille nucléaire au lieu de clan), de "l'amour romantique" (famille comme histoire d'amour au lieu de famille comme institution) et de "l'égalité entre les hommes et les femmes" (chaos égalitaire au lieu d'intégration hiérarchique autour d'un facteur solaire) devrait être soumise à une analyse critique.
Un débat rationnel
Les positions des cercles politiques qui, en Pologne, imposent avec une grande intensité des idéologies biologiquement, socialement et culturellement en décomposition, devraient être considérées comme non pertinentes ou même "superficielles", souvent qualifiées avec mépris de "moralité". Il est vrai que le débat sur la valeur de la vie, l'humanité, l'identité, le genre, le mariage, la famille et la fertilité a été détourné par des cercles qui tentent d'exercer une pression émotionnelle et qui utilisent des arguments idéologiques intersubjectifs non convaincants - catholiques d'une part et libéraux d'autre part ; le problème est que pour une personne qui ne connaît pas une religion particulière, les arguments se référant à cette religion sont sans valeur, tout comme pour une personne qui ne connaît pas l'idéologie libérale, les appels aux "droits de l'homme" et autres superstitions similaires n'ont aucune force de persuasion - tout ce qui reste aux participants à un tel échange de vues est une tentative de "faire taire" l'adversaire.
Cela ne signifie pas qu'un débat sur les valeurs existentielles susmentionnées pour la communauté politique soit sans fondement et impossible. Le plan d'un tel débat rationnel est constitué par les catégories de la sécurité nationale, de l'intérêt national, des valeurs et des biens existentiels, de la sécurité ontologique, etc. Ainsi, Grzegorz Braun a raison lorsqu'il propose d'inclure la défense de la Pologne contre l'avortement, l'euthanasie et la promotion des déviations sexuelles parmi les objectifs de la politique de sécurité nationale. Dans la lignée des considérations de J. Kukułka, on devrait même les inclure parmi les objectifs existentiels de la communauté politique et affirmer que la neutralisation de ces menaces est une question d'intérêt national.
Il est toutefois étonnant qu'elles ne soient pas considérées comme telles par les acteurs de la scène politique polonaise, tels que le parti Bezpieczna Polska (= Safe Poland) dirigé par Leszek Sykulski, qui se réfèrent précisément à la catégorie de la "sécurité ontologique" dans leur programme. Il est tout à fait incompréhensible que le chapitre du programme du parti susmentionné consacré à la sécurité ontologique contienne une déclaration sur la "neutralité de l'État en matière de vision du monde".

Les auteurs mêmes du concept de "sécurité ontologique", A. Giddens et surtout B. J. Steele, soulignent son lien avec la politique idéologique. De telles considérations sont en fait déjà enracinées dans la sociologie depuis des décennies, qu'il s'agisse de "L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme" (1905) de Max Weber (1864-1920), du concept de "valeurs asiatiques" plus proche de notre époque du Premier ministre malaisien Mahathir bin Mohammad et du Premier ministre singapourien Lee Kuan Yew (photo), ou les réflexions déjà contemporaines sur les valeurs et la signification du néoconfucianisme (qui est l'équivalent chinois du conservatisme - meilleur que le conservatisme européen, parce qu'il est dépourvu d'éléments individualistes).
Il est donc tout aussi possible de débattre de la valeur de certaines religions, idéologies, visions du monde, traditions et institutions, qui offrent ou non des possibilités de répondre aux besoins d'un corps politique donné. Comme le reconnaissent aujourd'hui la psychologie sociale et la sociologie de la culture, l'identité se caractérise autant par la continuité que par la mutabilité. Comme le soulignent les défenseurs du traditionalisme tels que Julius Evola, il faut donc faire un "choix de la tradition" conscient et rationnel. Une communauté politique qui abdique son "choix de la tradition" renonce à contrôler les variables sur la base desquelles une menace existentielle peut naître pour elle.
Par ailleurs, pour ceux qui sont conscients de l'importance de l'identité (sécurité ontologique) pour la vitalité de l'organisme politique, on pourrait suggérer d'étendre la réflexion aux sources de l'idéo-toxification démo-libérale actuelle. Aujourd'hui, ce ne sont pas la Chine, la Russie ou le Belarus qui tentent de forcer la Pologne à légaliser l'avortement et la perversion sexuelle, mais les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne et la France, ainsi que l'ONU, l'OTAN et l'UE qu'ils dirigent. C'est également uniquement à partir des centres occidentaux et par le biais de canaux occidentaux (tels que les plateformes de médias sociaux) que la propagande de la permissivité et de la déconstruction des institutions sociales fonctionnelles afflue aujourd'hui en Pologne.
Il est donc nécessaire d'identifier les sources de menaces pour la sécurité ontologique de la Pologne, d'identifier les canaux de leur influence, puis de limiter l'influence menaçante des premières en éliminant les seconds. L'intervention bravache de Grzegorz Braun avec un extincteur nous permet d'espérer qu'il sera capable de réfléchir dans ce domaine, qu'il sera ouvert au dialogue et qu'il ne manquera pas de force de caractère pour au moins articuler les menaces et stigmatiser leurs sources.
Ronald Lasecki
Publié à l'origine dans Chrobry Szlak, décembre 2023
Soutenez mon travail d'analyse: https://zrzutka.pl/xh3jz5
19:19 Publié dans Définitions, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sécurité nationale, définition, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 18 février 2024
Marx : penseur de la libre communauté et de l'individualité selon Diego Fusaro

Marx: penseur de la libre communauté et de l'individualité selon Diego Fusaro
Recension de: Marx: Pensador de la individualidad comunitaria libre de Diego Fusaro (Letras Inquietas, La Rioja, España, 2024)
Carlos X. Blanco
Débarrasser Marx du "marxisme" semble être une tâche ardue. Une grande partie des interprétations qui ont suivi la mort du philosophe et révolutionnaire se sont écartées de la voie principale qu'il avait ouverte. Certes, Karl Heinrich Marx lui-même est en partie responsable de cette déviation, lui qui, enfant d'une époque, n'a pu éviter toute une imprégnation environnementale. Marx s'est retrouvé avec toute une série de "-ismes" qui ont gâché la nouveauté radicale et entamé l'acuité de sa pensée. Le philosophe de Trèves n'était pas, en ce sens (et de son propre aveu), un marxiste. Il le savait, et pourtant il "laissait faire". Il a laissé son ami Friedrich Engels compléter son héritage, et a mis en ordre ad libitum les parties inachevées et fragmentairement élaborées. Pire encore, le troisième de la dynastie des dirigeants politico-intellectuels d'un mouvement déjà appelé "marxisme", à savoir Karl Kautsky, a approfondi les préjugés et les imprégnations de l'environnement.
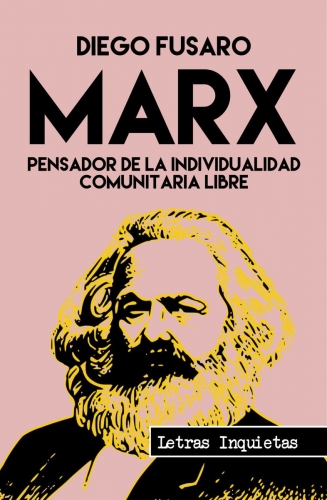
L'un de ces biais et l'une de ces contaminations propre à l'époque était le positivisme évolutionniste. La philosophie de Marx a été considérée comme une "théorie" de l'évolution des modes de production, que la social-démocratie allemande et le stalinisme soviétique ont compris de manière linéaire, déterministe, rigide et quasi-naturaliste. Le rôle volontariste du sujet révolutionnaire, le prolétariat, a été réduit au minimum, comme un simple spectateur qui n'a qu'à suivre la tendance inexorable du capitalisme vers son propre effondrement.
Un autre biais du "marxisme", et pas tellement de Marx lui-même, concerne le soi-disant matérialisme. Fusaro, comme son maître Costanzo Preve, insiste dans ses livres sur le fait que Marx a été victime d'une sorte de malentendu. Comme la psychanalyse nous l'a déjà montré, c'est parfois l'auto-compréhension qui est la pire. On ne peut pas juger un auteur sur la base des jugements qu'il porte sur sa propre œuvre et ses propres théories.
Ce qui est curieux, c'est que cette circonstance, que Marx lui-même n'ignorait pas - des décennies avant l'apparition de la psychanalyse -, il ne l'a pas su ou n'a pas pu se l'appliquer à lui-même. Marx se décrivait comme un matérialiste, comprenant le terme plutôt comme un synonyme de "scientifique". À bien des égards, l'auteur se déclarait matérialiste d'une manière purement métaphorique: de même que la science newtonienne n'était pas une spéculation gratuite sur la nature, mais une connaissance réelle en son temps (science stricte à l'apogée du 18ème siècle et paradigme de la physique jusqu'à la fin du 19ème siècle), le matérialisme historique, par analogie, se voulait une science stricte dans le domaine difficilement contrôlable et prévisible de l'histoire de l'humanité.

Face à l'utilisation purement métaphorique du terme "matérialisme", qui a causé tant de destructions intellectuelles entre les mains d'Engels, de Lénine et de Gustavo Bueno, Fusaro défend dans ce livre la proposition de Preve: considérer Marx comme le dernier grand représentant de la tradition idéaliste allemande. Le cycle des grands métaphysiciens partis de l'idéalisme transcendantal kantien (Fichte, Schelling et Hegel) s'achève avec Marx, qui ne se contente pas de retourner Hegel, de le mettre "à l'envers", en conservant une prétendue méthode dialectique et en remplaçant la vision idéaliste par une vision matérialiste, dans laquelle l'économie détermine "en dernière instance" la superstructure (les idées et les valeurs d'une formation sociale). Ce n'est pas ainsi que les choses se passent. La vision dialectique du monde commence avec Fichte, qui comprend l'ego comme une activité. L'idéalisme de Fichte, dont Hegel et Marx se sont principalement inspirés, n'est pas un "mentalisme". Ce "moi" n'est pas un reflet contemplatif ou spéculatif du monde: ce "moi" est un transformateur du monde. L'infrastructure (économie et technologie, principalement) n'est rien chez Marx si elle n'est pas comprise comme un ensemble de systèmes d'action qui travaillent et retravaillent un monde largement humanisé, pour le meilleur et pour le pire.
Mais le texte qui fait l'objet de la présente étude se concentre principalement sur le problème de la Communauté. Marx est, après Hegel, le grand penseur de la Communauté. Il n'y a pas d'homme libre s'il n'y a pas de véritable Communauté. Contrairement à ce que nous montre la version libérale, à savoir une idée de l'homme atome qui ne peut être lié à l'autre que par le contrat, Marx sait (à la manière aristotélicienne et hégélienne) que sans Communauté il n'y a pas d'homme vraiment libre. Ce n'est pas du totalitarisme, c'est du communautarisme.
Il n'y a pas de meilleure façon d'étudier Marx que d'aller main dans la main avec Fusaro.
Source: https://www.letrasinquietas.com/marx-pensador-de-la-indiv...
17:19 Publié dans Livre, Livre, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : karl marx, diego fusaro, livre, marxisme, théorie politique, philosophie, philosophie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 08 février 2024
Mythe et sédation démocratique

Mythe et sédation démocratique
Adriano Segatori
Source: https://electomagazine.it/il-mito-contro-la-sedazione-democratica/
Il existe un gros volume - 738 pages pour être précis - qui mérite d'être étudié, et pas seulement lu. Il a été écrit par Francesco Germinario et s'intitule Totalitarianismo in movimento (Le totalitarisme en mouvement).
 Le résumer serait une tâche titanesque, mais je pense qu'il est nécessaire de s'attarder sur un point. La fonction du mythe comme dispositif de rupture d'une vision de l'Histoire comprise comme une succession rationnelle d'événements prédestinés à l'intérieur d'un processus prédéfini et, essentiellement, rationnel et, pourrait-on dire, scientifico-matérialiste.
Le résumer serait une tâche titanesque, mais je pense qu'il est nécessaire de s'attarder sur un point. La fonction du mythe comme dispositif de rupture d'une vision de l'Histoire comprise comme une succession rationnelle d'événements prédestinés à l'intérieur d'un processus prédéfini et, essentiellement, rationnel et, pourrait-on dire, scientifico-matérialiste.
En partant de Sorel, en passant par Gramsci, Lénine, Schmitt, Hitler, Mussolini et d'autres - avec les distinctions naturelles et les clarifications évidentes - tous les penseurs arrivent à la même conclusion, en identifiant le point essentiel du mythe dans la production de deux actions importantes: la mobilisation des masses et le décisionnisme d'un leader charismatique.
Contre une démocratie représentative qui prive le peuple de tout protagonisme politique, à l'exception de celui, fictif et peu concluant, du cirque électoral ou, pire encore, comme à l'époque contemporaine, qui confisque même le droit à la vie privée et à la liberté d'expression; contre une démocratie "discutidora" et chaotique - pour reprendre l'expression de Donoso Cortés - qui s'auto-suffit dans le procéduralisme et le bureaucratisme, ainsi que dans les médiations épuisantes entre des partis politiques uniquement intéressés par leurs propres positions et la défense de leurs propres intérêts; contre une démocratie en proie à l'hésitation et à l'incertitude provoquées par les enchevêtrements administratifs et les formalismes réglementaires, contre cela et surtout contre l'enfermement de l'Histoire dans une voie binaire de prévisibilité et de rationalité, la réanimation d'un mythe, et son incarnation dans une personnalité évocatrice qui décide de son pouvoir politique, détermine l'arrachement à ce qui est considéré comme acquis et l'ouverture vers une réalité nouvelle et inattendue.
L'activation du mythe s'accompagne d'une "radicalisation de la dialectique" : finis les compromis, les médiations, les négociations. L'ennemi est identifié de manière schmittienne et, dans la mobilisation des masses, la souveraineté du peuple est établie.
La superstition de l'argument est remplacée par la foi en la volonté, et l'autre superstition, celle d'un progrès pacifiste et apprivoisé, mais aussi anesthésiant et donc violent de manière déguisée, est ainsi brisée.

Pourquoi tous les principaux penseurs politiques cités dans l'essai - à l'exception d'un contingent marxiste en désaccord avec cette perspective - n'ont-ils pas envisagé la possibilité d'une rectification vitaliste de la démocratie de l'intérieur de ses appareils ? Tout simplement parce que la démocratie, dans sa genèse même, est porteuse d'indolence sociale, de paresse morale, d'affaiblissement de tout élan vital. La démocratie apprend au peuple la résilience face aux décisions du pouvoir, et c'est pourquoi elle veille toujours à endormir, à soumettre les masses bruyantes et contestataires.
Face à une démocratie qui a toujours le ton monotone de la narration rassurante et hypnotique de l'Histoire, le mythe politique "ne s'attache pas à la narration, mais à l'action". Il ne s'intéresse pas à la gestion et au maintien du présent, mais veut et prétend construire un avenir, selon ses propres principes et sa propre vision.
Germinario cite la pensée de Caillois selon laquelle "le mythe appartient par définition au collectif, il justifie, soutient et inspire l'existence et l'action d'une communauté". C'est pourquoi la démocratie se divise - vax/novax, gauche/droite, etc. - parce qu'elle a peur de la communauté et qu'elle est terrifiée par la possibilité d'une renaissance du mythe, comme ce fut le cas avec le "fascisme [qui] a réussi à retravailler et à fusionner des thèmes de gauche et de droite [dans] une vision mythique de la politique". Pour savoir pourquoi les choses se sont passées ainsi, posez directement la question à la démocratie.
16:41 Publié dans Livre, Livre, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : démocratie, théorie politique, politologie, sciences politiques, livre, totalitarisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Weimerica ? - Carl Schmitt sur l'État de droit

Weimerica ? - Carl Schmitt sur l'État de droit
Tom Sunic
Source: https://www.theoccidentalobserver.net/2024/02/02/weimerica-carl-schmitt-on-the-rule-of-law/
Le système libéral aime se parer de l'étiquette "État de droit", suggérant implicitement que d'autres systèmes de croyance, d'autres États ou îlots d'États non libéraux à travers l'histoire fonctionnent uniquement comme des entités sans foi ni loi violant la liberté de leurs citoyens. Ce n'est pas le cas. Depuis des temps immémoriaux, les États du monde entier, même les pires tyrannies, ont eu recours à des politiques législatives pour prononcer un verdict contre des opposants politiques ou des criminels de droit commun. Le problème n'est pas de savoir si ces États ou îlots d'États illibéraux sont/étaient justes ou injustes ; le problème est plutôt le choix correct ou incorrect des mots et l'interprétation subséquente de ces mots par les détracteurs ou les partisans de ces États.
 Par exemple, les législations de l'Europe de l'Est communiste et de l'Union soviétique contenaient des structures constitutionnelles détaillées couvrant tous les aspects de la vie des citoyens. Il en va de même pour le fascisme en Italie et le national-socialisme en Allemagne (1922-1945), dont les dirigeants considéraient les lois de leur pays comme bien plus respectueuses de la liberté que les lois du système libéral. Dans l'Amérique contemporaine, sous le couvert de l'expression grandiloquente de "l'État de droit", le pouvoir judiciaire tend de plus en plus à glisser vers un légalisme excessif - la guerre sous n'importe quel autre nom - qui conduit tôt ou tard à des perturbations administratives susceptibles de déclencher des troubles civils. Actuellement, ce processus de lawfare peut être observé dans le système judiciaire américain, comme l'illustrent les nombreux actes d'accusation contre l'ancien président Donald Trump, la croisade de Letitia James contre VDARE, le procès de Charlottesville, et bien d'autres choses encore. De plus, les procès quasi soviétiques contre des milliers de manifestants du Capitole du 6 janvier battent leur plein, les accusés devenant des sujets aux noms mal définis et souvent abstraits (émeutiers ?, intrus?, insurgés?, terroristes? ...ou combattants de la liberté!?). Il faut souligner que la salve d'accusations mutuelles, de charges criminelles et de contre-accusations de l'équipe juridique de Trump contre les procureurs locaux parrainés par le gouvernement américain et les avocats activistes qui détestent Trump comme Robert Kaplan n'est pas une caractéristique inhérente au système américain. Pas du tout. En fait, l'hyper-juridisme manifeste aux États-Unis, qui frôle de plus en plus l'anarchie administrative, représente l'essence même de la dynamique historique du système libéral [i].
Par exemple, les législations de l'Europe de l'Est communiste et de l'Union soviétique contenaient des structures constitutionnelles détaillées couvrant tous les aspects de la vie des citoyens. Il en va de même pour le fascisme en Italie et le national-socialisme en Allemagne (1922-1945), dont les dirigeants considéraient les lois de leur pays comme bien plus respectueuses de la liberté que les lois du système libéral. Dans l'Amérique contemporaine, sous le couvert de l'expression grandiloquente de "l'État de droit", le pouvoir judiciaire tend de plus en plus à glisser vers un légalisme excessif - la guerre sous n'importe quel autre nom - qui conduit tôt ou tard à des perturbations administratives susceptibles de déclencher des troubles civils. Actuellement, ce processus de lawfare peut être observé dans le système judiciaire américain, comme l'illustrent les nombreux actes d'accusation contre l'ancien président Donald Trump, la croisade de Letitia James contre VDARE, le procès de Charlottesville, et bien d'autres choses encore. De plus, les procès quasi soviétiques contre des milliers de manifestants du Capitole du 6 janvier battent leur plein, les accusés devenant des sujets aux noms mal définis et souvent abstraits (émeutiers ?, intrus?, insurgés?, terroristes? ...ou combattants de la liberté!?). Il faut souligner que la salve d'accusations mutuelles, de charges criminelles et de contre-accusations de l'équipe juridique de Trump contre les procureurs locaux parrainés par le gouvernement américain et les avocats activistes qui détestent Trump comme Robert Kaplan n'est pas une caractéristique inhérente au système américain. Pas du tout. En fait, l'hyper-juridisme manifeste aux États-Unis, qui frôle de plus en plus l'anarchie administrative, représente l'essence même de la dynamique historique du système libéral [i].
Quis judicabit? - qui prend la décision juridique finale?
La similitude frappante entre le système judiciaire américain actuel et le système judiciaire semi-anarchique de l'Allemagne de Weimar, qui avait entraîné des troubles civils incessants et des assassinats politiques en série, a été observée par Carl Schmitt dans ses nombreux articles critiques publiés de 1933 à 1944 dans les revues juridiques de l'Allemagne nationale-socialiste. L'étude de l'œuvre juridique de Carl Schmitt doit cependant tenir compte de plusieurs points, lesquels doivent focaliser notre attention. La langue anglaise n'a pas d'équivalent pour le substantif allemand composé "Rechtsstaat" (État de droit), un substantif qui a sa réplique verbale et conceptuelle exacte dans toutes les langues d'Europe continentale (état de droit, pravna država, stato di diritto, právní stat, etc.) Au lieu de cela, les juristes américains/britanniques recourent à une expression plus générale telle que "l'État de droit" ou "l'État constitutionnel" - des termes qui ne véhiculent pas la même signification spécifique que le "Rechtsstaat" allemand. L'expression que j'utilise dans mes traductions des citations de Schmitt, à savoir "État de droit", est peut-être la plus proche du substantif allemand original "Rechtsstaat".
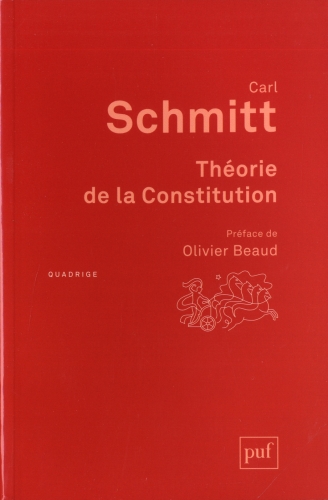 Deuxièmement, il faut garder à l'esprit que Schmitt, qui est souvent cité aujourd'hui par des dizaines d'universitaires traditionalistes américains et européens contemporains, d'intellectuels et d'activistes de l'Alt-Right ou de la Nouvelle Droite, n'était pas seulement un expert juridique et un politologue renommé, mais aussi un érudit multilingue qui s'interrogeait constamment sur la signification des concepts politiques et sur leurs distorsions sémantiques par les diverses classes politiques dirigeantes en Europe et aux États-Unis. L'expression "fake news" n'existait pas de son vivant, mais Schmitt était parfaitement conscient du jargon juridique truqué utilisé par les juges libéraux. Malgré sa sympathie ouverte pour le national-socialisme et le fascisme, il vaut la peine d'examiner la pertinence de ses articles, en particulier lorsqu'il s'agit d'évaluer les systèmes juridiques actuels des États-Unis et de l'Union européenne dans le cadre du droit international. Dans son article au sous-titre élogieux "L'État national-socialiste est un État juste", il écrit :
Deuxièmement, il faut garder à l'esprit que Schmitt, qui est souvent cité aujourd'hui par des dizaines d'universitaires traditionalistes américains et européens contemporains, d'intellectuels et d'activistes de l'Alt-Right ou de la Nouvelle Droite, n'était pas seulement un expert juridique et un politologue renommé, mais aussi un érudit multilingue qui s'interrogeait constamment sur la signification des concepts politiques et sur leurs distorsions sémantiques par les diverses classes politiques dirigeantes en Europe et aux États-Unis. L'expression "fake news" n'existait pas de son vivant, mais Schmitt était parfaitement conscient du jargon juridique truqué utilisé par les juges libéraux. Malgré sa sympathie ouverte pour le national-socialisme et le fascisme, il vaut la peine d'examiner la pertinence de ses articles, en particulier lorsqu'il s'agit d'évaluer les systèmes juridiques actuels des États-Unis et de l'Union européenne dans le cadre du droit international. Dans son article au sous-titre élogieux "L'État national-socialiste est un État juste", il écrit :
L'existence d'un "Rechtsstaat" [c'est-à-dire un État de droit] dépend d'une propriété spécifique que l'on attribue à ce mot ambigu et aussi de la mesure dans laquelle un Rechtsstaat se rapproche d'un État juste. Le libéralisme du 19ème siècle a donné à ce terme une signification spécifique, transformant ainsi le Rechtsstaat en une arme politique dans sa lutte contre l'État. Quiconque utilise cette expression doit préciser exactement ce qu'il entend par là et en quoi son Rechtsstaat diffère du Rechsstaat libéral, ainsi qu'en quoi son Rechtsstaat devrait être national-socialiste, ou d'ailleurs tout autre type de Rechtsstaat [ii].
Compte tenu de la surutilisation généralisée de l'expression "État de droit", il ne faut pas s'étonner que cette expression ne soit plus guère crédible. "En ce sens, écrit Schmitt, le libéralisme s'est efforcé au cours du siècle dernier de présenter tout État non libéral, qu'il s'agisse d'une monarchie absolue, d'un État fasciste, d'un État national-socialiste ou bolcheviste, comme un État non régi par le droit (Nicht-Rechtsstaat) ou comme un État injuste ou sans loi (Unrechtsstaat) [iii]. "En outre, le système libéral, comme le soulignent inlassablement ses partisans, est établi comme une construction sociale à deux niveaux avec une division nette entre l'appareil d'État et une personne privée. L'hypothèse sous-jacente est qu'une telle division est le meilleur moyen d'empêcher la montée d'un État puissant et d'un dirigeant dictatorial. L'État libéral, selon les théoriciens libéraux, doit uniquement jouer le rôle de "veilleur de nuit" occasionnel, sans jamais s'immiscer dans la sphère privée de l'individu :
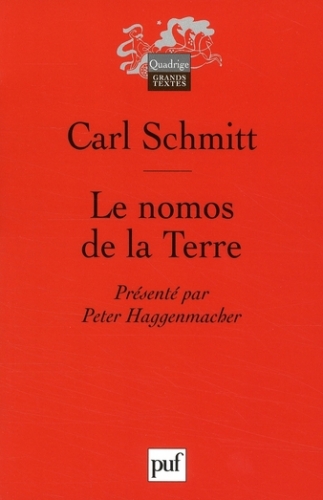 Cette nature à deux niveaux explique le cadre constitutionnel à deux niveaux typique du Rechtsstaat bourgeois. Les droits et libertés fondamentaux garantis par l'État libéral-démocratique et son système constitutionnel sont essentiellement des droits de la personne privée. Pour cette seule raison, [ces droits] peuvent être considérés comme "apolitiques". L'État libéral et le cadre constitutionnel reposent sur une opposition simple et directe entre l'État et la personne privée. Ce n'est que sur la base de ce contraste qu'il est naturel et utile de s'efforcer de créer tout l'édifice des protections et facilités juridiques afin de protéger une personne privée sans défense, pauvre et isolée contre le puissant Léviathan qu'est "l'État". Ce n'est que pour la protection d'un individu pauvre que la plupart de ces mesures de protection juridique, dans ce que l'on appelle le Rechtsstaat, ont un sens. Elles peuvent être justifiées par le fait que la protection contre l'État doit être de plus en plus calquée sur les procédures judiciaires, et plus encore sur la décision d'une autorité judiciaire indépendante de l'État [iv].
Cette nature à deux niveaux explique le cadre constitutionnel à deux niveaux typique du Rechtsstaat bourgeois. Les droits et libertés fondamentaux garantis par l'État libéral-démocratique et son système constitutionnel sont essentiellement des droits de la personne privée. Pour cette seule raison, [ces droits] peuvent être considérés comme "apolitiques". L'État libéral et le cadre constitutionnel reposent sur une opposition simple et directe entre l'État et la personne privée. Ce n'est que sur la base de ce contraste qu'il est naturel et utile de s'efforcer de créer tout l'édifice des protections et facilités juridiques afin de protéger une personne privée sans défense, pauvre et isolée contre le puissant Léviathan qu'est "l'État". Ce n'est que pour la protection d'un individu pauvre que la plupart de ces mesures de protection juridique, dans ce que l'on appelle le Rechtsstaat, ont un sens. Elles peuvent être justifiées par le fait que la protection contre l'État doit être de plus en plus calquée sur les procédures judiciaires, et plus encore sur la décision d'une autorité judiciaire indépendante de l'État [iv].
La citation susmentionnée sur l'auto-perception romantique du système libéral est erronée. On peut se poser la question suivante: est-il vrai, comme le prétendent les théoriciens libéraux, que la division entre la société civile et l'État est le meilleur moyen de garantir les libertés individuelles et de protéger les citoyens contre les décisions arbitraires de l'État? C'est loin d'être le cas. Est-il vrai que les freins et contrepoids libéraux tant vantés, y compris une séparation nette entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, sont les mieux à même de prévenir les tentations totalitaires? Difficilement. Le clivage trop souvent vanté entre la sphère privée et la sphère publique est trompeur; il ne permet pas aux citoyens d'échapper à l'État de surveillance libéral moderne. Il faut souligner encore et encore que dans le système libéral, ce n'est plus l'État qui exerce le contrôle, mais une myriade de groupes de pression, d'ONG, de médias et de lobbies élitistes et bien financés qui influencent les citoyens au quotidien, tout en utilisant sagement l'État comme une simple couverture juridique. Schmitt a analysé il y a longtemps l'impact négatif des groupes de pression non gouvernementaux de contre-pouvoir.
 Mais tout cela devient complètement absurde dès que des associations ou des organisations collectives fortes conquièrent des sphères de liberté non gouvernementales et non politiques, dès que des organisations non gouvernementales (mais nullement apolitiques) s'emparent de personnes privées, d'une part, tout en affrontant l'État sous le couvert de divers titres juridiques (peuple, société, bourgeoisie libre, prolétariat producteur, opinion publique, etc. Ces associations non gouvernementales, mais, comme nous l'avons mentionné, entièrement politiques, en viennent à dominer à la fois (par le biais du pouvoir législatif) la volonté de l'État et (par le biais de la coercition sociale et du "droit purement privé") l'individu individuel qu'elles transforment en sujet médiatique. Elles sont des décideurs politiques réels et effectifs et manipulent les leviers du pouvoir de l'État" [v].
Mais tout cela devient complètement absurde dès que des associations ou des organisations collectives fortes conquièrent des sphères de liberté non gouvernementales et non politiques, dès que des organisations non gouvernementales (mais nullement apolitiques) s'emparent de personnes privées, d'une part, tout en affrontant l'État sous le couvert de divers titres juridiques (peuple, société, bourgeoisie libre, prolétariat producteur, opinion publique, etc. Ces associations non gouvernementales, mais, comme nous l'avons mentionné, entièrement politiques, en viennent à dominer à la fois (par le biais du pouvoir législatif) la volonté de l'État et (par le biais de la coercition sociale et du "droit purement privé") l'individu individuel qu'elles transforment en sujet médiatique. Elles sont des décideurs politiques réels et effectifs et manipulent les leviers du pouvoir de l'État" [v].
Cela vous semble-t-il familier? Ce que l'on appelle aujourd'hui par dérision l'État profond a été bien anticipé par Schmitt, bien que ce terme n'ait pas existé de son vivant. Dans leur critique de la Constitution libérale de Weimar, les nationalistes allemands ont introduit et popularisé dans toute l'Europe le terme (das) System, que l'on peut facilement substituer aujourd'hui à l'État profond libéral moderne. Dans un système libéral où le pouvoir est décentralisé, ce que les universitaires appellent le processus de "partage du pouvoir", un citoyen dissident ne peut que fantasmer sur la possibilité de renverser le gouvernement par la force dans l'État où il réside. À première vue, cela peut sembler être un noble trait de protection de la liberté du système libéral. Cependant, la nature atomisée du pouvoir dispersé dans le libéralisme, résultant de ses célèbres politiques d'équilibre des pouvoirs, conduit inévitablement à une méfiance et une haine mutuelles dispersées entre les citoyens, dans lesquelles la ligne de démarcation entre la victime et l'auteur disparaît peu à peu. Le regretté Claude Polin, qui fut l'un des meilleurs observateurs des contradictions libérales, pose une question lancinante: "Comment se fait-il que l'on craigne un roi exerçant son pouvoir, et que l'on craigne moins que le même pouvoir soit conféré à des millions de petits rois [vi] ?
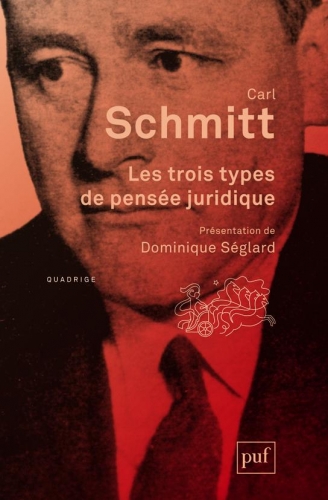 Des centaines de figures royales non gouvernementales et des centaines d'agences privées aux États-Unis et dans l'Union européenne, y compris des dizaines de groupes de pression à base ethnique, chacun affichant souvent un étrange sentiment de victimisation, et chacun contrôlant son propre territoire, ont leurs propres méthodes de répression contre les voix dissidentes. La plupart des ONG des États-Unis et de l'UE ne cachent certainement pas leur profonde aversion pour l'État fort et sont promptes à dénoncer tout signe de populisme dans la bureaucratie gouvernementale. Pourtant, elles n'hésitent pas à exercer leurs propres politiques répressives à l'encontre d'autres groupes marginaux, tout en implorant l'État de leur accorder de généreuses subventions. L'ADL, le SPLC aux États-Unis, des dizaines de fondations antifa et transgenres, y compris des institutions chrétiennes et juives financées par le gouvernement dans l'UE, telles que le Crif, la LICRA ou l'Amadeu Antonio Stiftung, fonctionnent de manière très similaire aux commissariats populaires locaux de l'ex-Union soviétique. Elles considèrent toutes comme acquis qu'elles ont droit à une part du gouvernement, c'est-à-dire du gâteau des contribuables. Au nom de la "tolérance" abstraite et de "l'État de droit", ils considèrent qu'il est de leur devoir démocratique et légal d'espionner et de dénoncer leurs concitoyens qui critiquent le dogme judiciaire libéral. La démocratie libérale postmoderne, bien qu'elle se vante d'être le meilleur des mondes, rappelle de plus en plus les États médiévaux en devenir.
Des centaines de figures royales non gouvernementales et des centaines d'agences privées aux États-Unis et dans l'Union européenne, y compris des dizaines de groupes de pression à base ethnique, chacun affichant souvent un étrange sentiment de victimisation, et chacun contrôlant son propre territoire, ont leurs propres méthodes de répression contre les voix dissidentes. La plupart des ONG des États-Unis et de l'UE ne cachent certainement pas leur profonde aversion pour l'État fort et sont promptes à dénoncer tout signe de populisme dans la bureaucratie gouvernementale. Pourtant, elles n'hésitent pas à exercer leurs propres politiques répressives à l'encontre d'autres groupes marginaux, tout en implorant l'État de leur accorder de généreuses subventions. L'ADL, le SPLC aux États-Unis, des dizaines de fondations antifa et transgenres, y compris des institutions chrétiennes et juives financées par le gouvernement dans l'UE, telles que le Crif, la LICRA ou l'Amadeu Antonio Stiftung, fonctionnent de manière très similaire aux commissariats populaires locaux de l'ex-Union soviétique. Elles considèrent toutes comme acquis qu'elles ont droit à une part du gouvernement, c'est-à-dire du gâteau des contribuables. Au nom de la "tolérance" abstraite et de "l'État de droit", ils considèrent qu'il est de leur devoir démocratique et légal d'espionner et de dénoncer leurs concitoyens qui critiquent le dogme judiciaire libéral. La démocratie libérale postmoderne, bien qu'elle se vante d'être le meilleur des mondes, rappelle de plus en plus les États médiévaux en devenir.
Le système libéral, c'est-à-dire l'État profond des États-Unis et de l'UE contemporains, qui est fondamentalement un système oligarchique, n'est pas tombé de la lune et n'est pas non plus constitué de bandes monolithiques conspiratrices de voleurs autoproclamés déterminés à subvertir l'État. Le système libéral occidental n'est que l'aboutissement logique de différents groupes, souvent en conflit les uns avec les autres, qui, volontairement - et parfois involontairement, comme dans le cas des groupes religieux chrétiens qui promeuvent les politiques libérales d'accueil des réfugiés - travaillent à la décomposition sociale, raciale et nationale de l'État et de son peuple - un trait inhérent à la dynamique même de l'État de droit (ou de l'absence d'État de droit) libéral.
Notes:
[i] T. Sunic, "Historical Dynamics of Liberalism : From Total Market to Total State ? ", The Journal of Social, Political, and Economic Studies 13, no. 4, (Hiver 1988), p. 455.
[ii] C. Schmitt, "Fünf Leitsätze für die Rechtspraxis" in Deutsches Recht, 3, Nr. 7 (1933), S. 201-202, réimprimé dans Gesammelte Schriften 1933-1936 (Berlin : Duncker & Humblot, 2021), p.56. (également : https://archive.org/details/carl-schmitt-gesammelte-schriften-1933-1936)
[iii] C. Schmitt, Der Rechtsstaat, publié pour la première fois dans Nationalsozialistisches Handbuch für Recht und Gesetzgebung (München : Zentralverlag der NSDAP, 1935, S. 24-32) repris dans Gesammelte Schriften 1933-1936, p.286-287.
[iv] C. Schmitt, "Die Verfassungslage Deutschlands" in Preußische Justiz - Rechtspflege und Rechtspolitik, Nr. 42, 5. Oktober 1933, pp. 479-482, réimprimé dans Gesammelte Schriften 1933-1936, p.74.
[v] Ibid, p. 75-76.
[vi] Claude Polin, "Pluralisme ou Guerre civile ?" Catholica (hiver 2005-2006), p. 16.
15:08 Publié dans Actualité, Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : état de droit, tomislav sunic, carl schmitt, théorie politique, philosophie politique, politologie, sciences politiques, révolution conservatrice |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 27 janvier 2024
Mobilisation politique des affects

Mobilisation politique des affects
par Georges FELTIN-TRACOL
En psychanalyse, l’affect désigne une décharge d’énergie psychique qui constitue, avec la représentation, l’une des deux grandes manifestations de la pulsion. Chantal Mouffe reprend volontiers ce terme dans son nouvel essai.
Cette Belge hispanophone qui enseigne la philosophie politique en Grande-Bretagne a théorisé dès 2018 le « populisme de gauche ». Ses travaux ont influencé une faction de Podemos en Espagne et le député La France Insoumise de la Somme, François Ruffin. Elle échange avec Jean-Luc Mélenchon qui adopte parfois et en partie sa vision de la confrontation politique.
Principale figure d’un « schmittisme de gauche » (comme il existait naguère des « hégéliens de gauche »), Chantal Mouffe définit par « “ moment populiste “ […] l’expression de diverses formes de résistance aux transformations politiques et économiques issues de trente années d’hégémonie néolibérale. Ces transformations ont abouti à une situation de “ post-démocratie “, notion qui souligne l’érosion des deux piliers de l’idéal démocratique : l’égalité et la souveraineté populaire ». Elle entend ainsi conduire « une “ guerre de position “ qui connaît sans cesse des avancées et des reculs ». Son but ? Réaliser une « révolution démocratique verte », c’est-à-dire « un nouveau front du processus de radicalisation de la démocratie – qui redéfinit les principes démocratiques avant de les appliquer à de nouveaux domaines et à des relations sociales plurielles ». Elle présente par conséquent « une stratégie populiste de gauche capable d’articuler entre elles les luttes sociales et écologiques autour du projet d’une révolution démocratique verte ».
Entre Sorel et Freud
Dans son esprit, cet engagement souhaitable et nécessaire « jouerait le rôle d’un “ mythe “ dans le sens que lui donne Georges Sorel : une idée dont la puissance d’anticipation de l’avenir permet de redessiner le présent. C’est un récit mobilisateur d’affects qui pourraient se révéler beaucoup plus puissants et crédibles que les discours néolibéraux ayant cours, et apporter l’impulsion requise pour la création d’une majorité sociale ». Il devient alors « essentiel de mettre en avant la nature partisane de la politique et la centralité des affects dans la conjoncture actuelle, qui se caractérise par une désaffection grandissante pour la démocratie ». Les sentiments se divisent entre les émotions qui relèvent du registre individuel et les passions qui sont « les affects communs qui entrent en jeu dans le domaine politique lors de la constitution des formes d’identification nous / eux ». Chantal Mouffe justifie volontiers son choix en se référant toujours à Sigmund Freud : « Dans le champ du politique, il est plus approprié de parler d’affects et de “ passions “ pour évoquer une confrontation entre des identités politiques collectives. » Elle oublie cependant que dans l’Europe d’Ancien Régime, les « émotions » signifiaient aussi des mouvements populaires violents de brève durée.
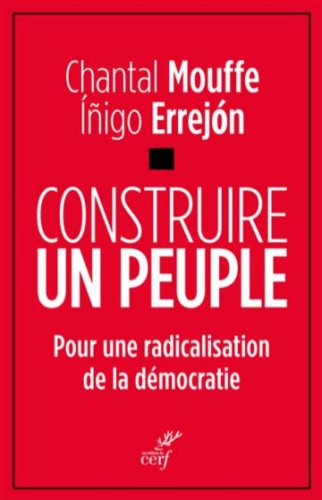
Chantre de la repolitisation des rapports sociaux, Chantal Mouffe conçoit « une conception “ agonistique “ de la démocratie qui envisage le projet démocratique sans recourir aux diktats de la raison ». Par « agonistique », il s’agit de la lutte ordonnée et réglée entre adversaires et non pas un affrontement sans aucune limite entre ennemis. Cette schmittienne qui apprécie penser contre le célèbre juriste allemand atténue la césure fondamentale et fondatrice entre l’ami et l’ennemi dans la cité. Elle avance qu’« à l’opposé des modèles rationalistes qui entendent tenir les passions en dehors de la politique, l’approche agonistique prend en compte le rôle crucial qu’elles jouent dans la constitution des identités politiques ». En observatrice avisée des campagnes de Donald Trump et de Boris Johnson, Chantal Mouffe insiste donc sur l’existence des affects « qui expriment des exigences en matière de souveraineté, de protection et de sécurité ». Attention toutefois à ne pas se méprendre ! Elle écarte de sa réflexions les instincts chers à Nietzsche. Elle juge par ailleurs le ressentiment comme un affect guère progressiste et potentiellement dangereux. Elle se garde bien de promouvoir toute politique des instincts…

Par la mobilisation politique des affects, Chantal Mouffe désire combattre l’hégémonie libérale marchande. Elle cible « le consensus établi entre les partis de centre droit et de centre gauche autour de l’idée qu’il n’existerait pas d’alternative à la mondialisation néolibérale. Sous prétexte de la “ modernisation “ qu’impose cette mondialisation, les partis sociaux-démocrates se sont pliés aux diktats du capitalisme financier et aux restrictions qu’ils ont imposées aux interventions de l’État dans le champ des politiques de redistribution ». Il résulte que « la souveraineté populaire a été décrétée obsolète et, s’indigne-t-elle, la démocratie réduite à sa composante libérale ». Elle récuse tout recours solutionniste, « version technologique de la conception post-politique qui s’est imposée au cours de la décennie 1990 ». La politisation des affects doit en revanche favoriser la formation du peuple. Cependant, le peuple n’est pas « une catégorie sociologique, mais une construction discursive possédant une dimension symbolique et libidinale ». Son « peuple » n’a aucune substance ethno-culturelle tangible ! Anti-essentialiste, elle confirme encore « une stratégie populiste de gauche axée sur la constitution d’un “ peuple “, construite à partir d’une “ chaîne d’équivalence “ issue de luttes démocratiques variées autour des questions touchant à l’exploitation, à la domination et à la discrimination ». « Une telle stratégie, poursuit-elle, suppose que soit réaffirmée l’importance de la “ question sociale “, en prenant en compte la fragmentation et la diversité grandissante des “ travailleurs “, mais aussi la spécificité des revendications démocratiques variées autour du féminisme, de l’anti-racisme et des questions LGBTQ+. » N’y voit-elle pas pour preuve que « l’affirmation par la psychanalyse qu’il n’existe pas d’identités essentielles, mais seulement certaines formes d’identification, se trouve au cœur de l’approche anti-essentialiste » ? Toute la nocivité de la psychanalyse si bien dénoncée par Julius Evola se concrétise dans cette phrase.
S’affranchir du cercle de raison
Sa démarche, originale, déplaît déjà aux folliculaires sociaux-démocrates. Chantal Mouffe estime que « le projet démocratique doit être redéfini, libéré de ses biais rationalistes, et faire place à la reconnaissance des besoins des non-humains ». Par exemple, en 2017, trois États ont accordé un statut légal et des droits à des cours d’eau majeurs (le Rio Atrato en Colombie, le Gange et la Yamuna en Inde et le Whanganui en Nouvelle-Zélande) ». Au Moyen Âge, les tribunaux pouvaient juger animaux et éléments naturels accusés de dévastations. Son point de vue est donc une modeste approche néo-médiévale, ce qui risque de dérouter les gauchistes wokistes focalisés sur un anti-fascisme fantasmatique d’autant qu’elle assure que « dans la conjoncture actuelle […], je ne pense pas que les populistes de la droite extrême doivent nécessairement être vus comme l’adversaire principal ».
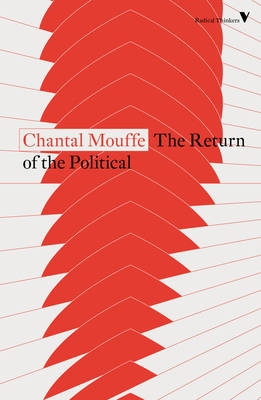
Son ennemi principal se nomme en fait le « néo-libéralisme digitalisé autoritaire » covidien ! Dans The Free Economy and the Strong State : The Politics of Thatcherism (1988), Andrew Gamble évoquait l’avènement d’« une économie libre dans un État fort », comprendre la mise en place d’un autoritarisme en faveur du marché. Chantal Mouffe fustige une nouvelle variante tyrannique du libéralisme financier. Elle se caractérise par la réduction des « fonctions redistributives de l’État et leur rôle dans la planification de l’économie; en revanche, ses fonctions répressives devaient être renforcées pour défendre les droits de propriété et sécuriser le bon fonctionnement du libre marché ». Contre cette domination; elle désire « reformuler le socialisme comme une radicalisation de la démocratie » et avoue que « c’est une stratégie qui ne vise pas une rupture radicale avec la démocratie libérale pluraliste, ni la fondation d’un ordre politique totalement nouveau. Elle se distingue donc clairement, d’une part, de la stratégie révolutionnaire de “ l’extrême gauche “ et, d’autre part, du réformisme stérile des sociaux-libéraux. Il s’agit d’une stratégie de “ réformisme radical “ » si bien que, finalement, « l’objectif n’est pas de “ fracasser “ le capitalisme, mais de le faire bouger en mettant en œuvre une série des réformes “ non réformistes “ […], et en développant des institutions alternatives telles que les coopératives, et des initiatives venant de la base de la société civile et centrée sur elle – qui encouragent des activités économiques reposant sur des relations égalitaires ».
Tout ça pour ça serait-on tenté de réagir ! Serait-ce la raison implicite qui explique la désenchantement des électeurs grecs, espagnols, britanniques, allemands et, peut-être, français pour le populisme de gauche ? Chantal Mouffe a toutefois raison quand elle insiste sur « l’absence de dimension affective [...] inscrite dans la conception même du projet européen ». Le patriotisme européen ne se réalisera que devant des menaces considérables (l’Artsakh abandonné, Chypre divisé, les Canaries, les enclaves espagnoles de Ceuta et de Melilla, l’île italienne de Lampedusa, etc.).


On remarque que la révolution démocratique verte de Chantal Mouffe n’est pas un décalque européen du Green New Deal exposé aux États-Unis par la représentant démocrate de New York, Alexandria Ocasio-Cortez. C’est plutôt une ébauche capable de se détourner enfin de ces nouveaux bellicistes embourgeoisés totalitarisants que sont les partis Verts occidentaux. À sa manière tout personnelle, Chantal Mouffe ne craint pas de passer pour une empêcheuse de tourner en rond dans le « cercle de raison » libéral-centriste.
Georges Feltin-Tracol
- Chantal Mouffe, La révolution démocratique verte. Le pouvoir des affects en politique, traduit de l’anglais par Christophe Beslon, Albin Michel, Paris, 2023, 128 p., 15,90 €.
18:18 Publié dans Actualité, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, chantale mouffe, socialisme, théorie politique, philosophie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 26 janvier 2024
Machiavel et l'art difficile de gouverner

Machiavel et l'art difficile de gouverner
Gennaro Malgieri
Source: https://electomagazine.it/machiavelli-e-la-difficile-arte-del-governo/
Le Prince de Nicolas Machiavel est un texte qui ne vieillit pas. Antonio Gramsci, qui en a tiré les coordonnées pour esquisser la figure du "nouveau prince", ordonnateur de la politique moderne, le savait bien. Dans ses Noterelle, il disait : "Le caractère fondamental du Prince est de ne pas être un traité systématique mais un livre "vivant", dans lequel l'idéologie politique et la science politique se confondent sous la forme dramatique du "mythe"". Cela signifie que l'élément doctrinal et rationnel s'incarne dans un "condottiere" qui résume la "volonté collective" lorsqu'elle se forme à travers un processus d'appropriation de l'élément le plus humain par le sujet actif, à savoir la passion qui anime l'esprit du peuple. Cesare Borgia, le duc Valentino, était-il capable de susciter un phénomène similaire ? L'histoire s'interrogera longuement sur ce point. Mais certainement, en suivant les pages de Machiavel, nous dirions qu'il a incarné l'"exceptionnalité" dans le monde déchiré de son époque, en dirigeant un projet qui n'a pas laissé indifférents ceux qui avaient le cœur de sentir et la raison de comprendre: la création de l'État national.

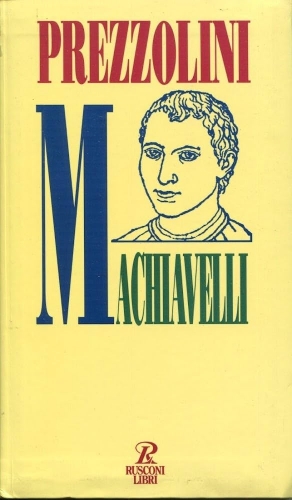
Le Valentin, comme l'observe Giuseppe Prezzolini dans son magnifique portrait du Florentin Nicolò Machiavelli (strictement avec un "c" dans son nom), publié par Longanesi, était un homme qui avait "flairé l'époque" et l'époque, comme cela est documenté, dans cette Italie désunie, dominée par des bandes qui se disputaient ses destinées, "poussait à une grande unité nationale, à des États modernes plus vastes, à des centres de justice organisés et à des impôts réguliers, à des budgets et à des caisses publiques séparés de ceux du prince, à la paix au moins dans l'intérieur, à la répression du brigandage". Le temps a fait disparaître les tyrans, les petites autonomies, les républiques, les cours des châtelains au 16ème siècle. Le temps était aux tyrans in quarto, aux grandes armées, à la justice et à l'injustice in grande, à l'autoritarisme à grande échelle. Les libertés dites communales sont en train de disparaître, parce qu'il s'agit de libertés limitées à des groupes et à des factions, au profit d'une sujétion générale, qui assure au moins des avantages matériels à un plus grand nombre. La liberté du petit nombre était échangée contre la semi-liberté du grand nombre".
C'était l'époque du duc Valentino et du secrétaire florentin. Et lorsque le premier exprime au second son intention d'"éteindre les tyrans" pour créer des agrégations politiques capables de tenir tête à des sujets agressifs dominés par une volonté de puissance inflexible, comment celui qui a décliné la figure du Prince par rapport à un ordre comme fondement de la paix et de la prospérité des peuples et des nations ne serait-il pas d'accord ? C'est un gentilhomme très splendide et magnifique", écrit Machiavel, "et il est si animé dans les armes que ce n'est pas une si grande chose qui lui semble petite ; et il ne se repose jamais, ni ne connaît la fatigue ou le danger, pour la gloire et pour acquérir un statut : il arrive le premier en un lieu où l'on peut comprendre le jeu dont il est content ; il fait que ses soldats le veulent bien, il a été capitaine des meilleurs hommes d'Italie ; ces choses le rendent glorieux et redoutable, ajouté à une fortune perpétuelle". Et lorsqu'il entreprend de mettre sur pied une sorte d'armée nationale, unissant la Romagne, Machiavel est séduit.
Un point de vue du 16ème siècle, pourrait-on dire, compréhensible à l'époque. Mais aujourd'hui ? L'Italie a longtemps souffert de l'absence d'une telle perspective, réalisée dans la tension vers la recomposition. C'est pourquoi la figure du Prince comme prototype de l'unificateur est tout à fait actuelle, car ce n'est qu'autour d'un principe ordonnateur que l'on peut trouver le sentiment de la nation, projeté dans une politique unitaire dont le paradigme machiavélique tient malgré tout, comme il a tenu pendant les cinq cents dernières années.
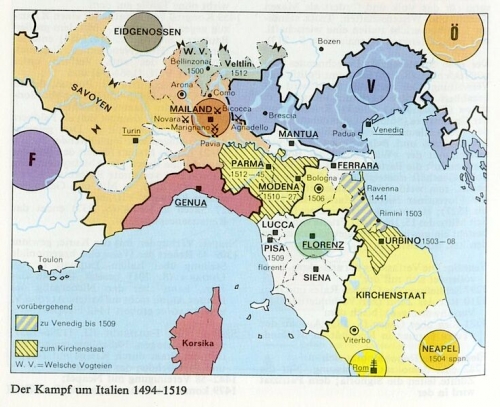
Une telle vision, bien que transposée dans la figure d'un État-nation composite, est loin d'avoir disparu. Au contraire, elle apparaît extraordinairement vivante face à la décadence de l'art de gouverner examiné par Machiavel tout au long de sa vie de savant, mais aussi d'homme public.
Au centre, l'homme (élément tragiquement absent aujourd'hui comme fondement d'une anthropologie politique) auquel il faut s'adresser et pour lequel on prend des mesures qui peuvent même être impopulaires, difficiles à digérer, mais qui, malgré l'adversité qu'elles provoquent, si le gouvernant ou le "décideur" est convaincu de leur bien-fondé, ne peut que les adopter avec tous les moyens dont il dispose en exerçant un pouvoir légitime.
Et quand le pouvoir est-il légitime ? Voici ce que dit Machiavel : "L'homme qui devient prince grâce à la faveur du peuple doit se garder cet ami ; ce qui lui est facile, puisqu'il ne demande pas à être opprimé. Mais celui qui, contre le peuple, devient prince par la faveur des grands doit, avant toute chose, essayer de gagner le peuple ; ce qui lui sera facile, quand il aura pris sa protection". L'horizon du Prince, c'est-à-dire du détenteur du Pouvoir, est donc le "bien commun", quel qu'en soit le prix. Et bien au-delà du bénéfice qu'il peut lui-même en tirer. Car il sait bien de quoi est faite la nature humaine : en soi triste et vouée à des sentiments changeants, inconstante, plus attachée à la défense des biens matériels qu'à ses propres affections. Elle ne le veut pas, mais c'est ainsi dans la pérennité du devenir, bien au-delà de la "bonté" qui caractérise certaines époques, dont la nôtre.
Nous pouvons généralement dire ceci des hommes", lit-on dans Le Prince, "qu'ils sont ingrats, inconstants, simulateurs, fuyant le danger, avides de gain et que tant que vous leur faites du bien, ils sont tout à vous, enchérisseurs de sang, de biens, de vie, d'enfants, comme je l'ai dit plus haut. Les hommes ont moins de respect pour offenser celui qui se fait aimer que celui qui se fait craindre, parce que l'Amour est tenu par un lien d'obligation qui, parce que les hommes sont tristes, est rompu à chaque occasion de sa propre utilité, mais la crainte est tenue par une peur du châtiment qui n'abandonne jamais".
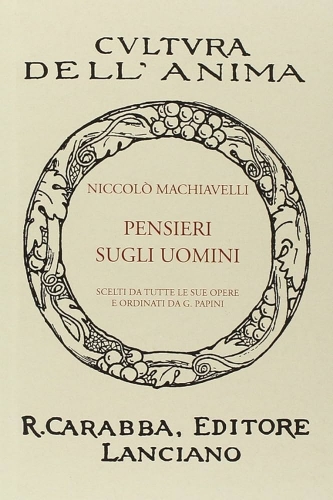
À cet égard, Giovanni Papini, dans l'introduction aux Pensieri de Machiavel de 1910 (éditeur Carabba), a observé comment le secrétaire florentin, "conscient de la captivité et de la stupidité des hommes et désireux, dans son noble esprit, de les améliorer, n'a pas cru que le meilleur moyen était de guérir les blessures et de blanchir les taches.
Qu'il ait aspiré à une sorte de cité parfaite, habitée par un peuple libre et vertueux, sans maîtres ni tyrans, sans sectes ni batailles, cela se voit en maints endroits de ses œuvres, mais doit-on crier à la croix parce qu'il a eu le bon sens de voir que la République de Platon était plutôt loin et Cesare Borgia plutôt proche ?".
La négativité de la considération de Machiavel pour l'esprit humain est radicale. D'où le pessimisme raisonnable sur lequel il fonde la construction politique du Pouvoir comme instrument régulateur des égoïsmes, des conflits et des désordres inévitables. Des éléments qui, lorsqu'ils prennent des traits non pas privés mais publics, donnent lieu à des événements impliquant les peuples et c'est alors que le Prince s'exerce avec l'expertise qui découle de ses qualités et de la légitimité qui lui est conférée par ceux qui le reconnaissent comme détenteur du pouvoir de représenter les raisons qui lui sont confiées et de les défendre. En somme, le " mythe " gramscien, au-delà des contingences qui ont conduit Machiavel à identifier le Prince à la personnalisation du Pouvoir, c'est l'État.
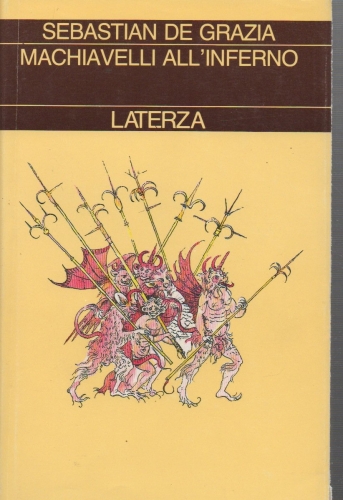
Dans la vision anthropologique et politique de Machiavel, la cité des hommes est habitée par des "brutes rationnelles" et sa science s'applique à minimiser les dommages causés par cette condition et, pour répondre de manière adéquate aux besoins du monde humain, il propose un autre art de gouverner, une "politique de la main lourde", comme le dit Sebastian De Grazia dans son Machiavelli all'Inferno (Laterza), qui reconnaît également que Machiavel "entre en scène au moment où tout commence à se précipiter vers l'abîme, quand la situation appelle un sauveur, un "rédempteur", un héros". Ce qui signifie que dans des circonstances particulières, dominées par une crise profonde des institutions civiles et de la morale commune, un pays peut avoir besoin d'un "pouvoir quasi-royal" difficile à trouver.
C'est donc dans "l'état d'exception", politiquement déterminé et juridiquement codifié, que l'action du Prince en tant qu'ordonnateur est légitimée. Nous dirions de l'État et des formes qu'il prendra.
En ce sens, l'œuvre de Machiavel a une valeur paradigmatique pour déchiffrer notre époque, qui lui ressemble à bien des égards, précisément parce que l'explosion des éléments anti-étatiques et, pourrions-nous dire, anti-communautaires, - en supposant que la formulation de l'État-communauté désigne la primauté politique de la Res publica dans laquelle les citoyens (qui ne sont plus des sujets) se reconnaissent - met en péril la liberté même qui, selon une certaine lecture du Prince, était considérée comme une sorte de guigne par Machiavel. Mais ce n'est pas le cas.
Il y a des époques où la liberté succède à l'ordre civil. Sans la garantie de celui-ci, il ne peut y avoir celui-là. Machiavel le voyait ainsi et c'est pourquoi, dans des termes que nous jugerions aujourd'hui méprisants, il écrivait : "Cesare Borgia passait pour cruel ; mais sa cruauté avait rassemblé la Romagne, l'avait unie, l'avait ramenée à la paix et à la foi. Si l'on y réfléchit bien, on s'aperçoit qu'il a été beaucoup plus clément que le peuple florentin qui, pour fuir le nom du cruel, a laissé détruire Pistoia. C'est pourquoi un prince ne doit pas se préoccuper de l'infamie du Cruel, afin de maintenir ses sujets unis et dans la foi ; car, à quelques exemples près, il sera plus clément que ceux qui, par trop de pitié, laissent s'installer le désordre, d'où découlent des événements ou des vols ; car ceux-ci tendent à offenser toute une universalité, et les exécutions qui viennent du prince en offensent une en particulier".

Alors, vaut-il mieux être aimé ou craint ? Une combinaison des deux serait préférable. Mais dans un monde idyllique, qui n'est probablement pas le nôtre, car la nature humaine est par nature tout sauf orientée vers le bien. Cela ne signifie pas que la coexistence civilisée doive être dominée par la cruauté, mais qu'elle doit être régulée de manière à minimiser les conflits et à sanctionner ceux qui enfreignent la loi. C'est aussi dans cette dimension que se déploie l'espace de l'amour et de la miséricorde, qui est donné par la peur de ceux qui doivent veiller à limiter les conséquences du désordre. Il en va de même pour les États et toutes les autres institutions humaines qui ont un impact sur l'existence de citoyens liés par un ordre nécessaire et donc accepté.
Depuis cinq cents ans, nous nous demandons comment concilier les deux stades contradictoires de l'humanité, l'amour et la peur. Surtout lorsque l'absence de l'un donne lieu à la corruption et que les coutumes publiques deviennent le miroir de la tromperie de ceux qui croient pouvoir abuser de la main légère du prince-État, voire de son absence.
De ce point de vue, il n'y a rien de plus révolutionnaire que la régénération qui présuppose le principe de la légitimité du Pouvoir fondé non sur l'origine juridique des Constitutions, mais sur l'origine politique. Je ne sais pas si Machiavel aujourd'hui, souriant comme il apparaît dans le portrait de Santi di Tito au Palazzo Vecchio de Florence, serait favorable à l'abdication de l'État politique au profit d'un formalisme caduc ou vice versa. Tout indique le contraire. Mais je suis certain que, constatant la chute de l'État et les ravages qu'il a subis, il se retirerait à San Casciano pour "se gaver" de "ses" roturiers, plus enclins à le comprendre que les puissants auxquels il a tenté, peut-être sans succès, d'enseigner l'art de gouverner. Le plus difficile, le plus dangereux. Au moins aussi dangereux que l'amour que Machiavel a décrit et même prôné.
17:19 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, philosophie politique, politologie, sciences politiques, théorie politique, machiavel, 16ème siècle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 24 janvier 2024
Post-démocratie - Pas de place pour la dialectique interne et la confrontation dans les partis-casernes

Post-démocratie - Pas de place pour la dialectique interne et la confrontation dans les partis-casernes
par Mario Landolfi
Source: https://www.destra.it/home/post-democrazia-nei-partiti-caserma-non-ce-spazio-per-la-dialettica-interna-e-il-confronto/
Qu'est-il advenu de la minorité interne (autrefois) célébrée et redoutée ? À l'époque glorieuse de la Première République, chaque parti en possédait au moins une. Seul le PCI hésitait à proclamer son existence, peut-être par un vieux réflexe lié au sectarisme cultivé dans la clandestinité. Si bien qu'à l'opposé, même le MSI, tout en revendiquant une ascendance autoritaire, ne dédaignait pas la division en courants. C'est qu'à l'époque, une direction n'était pas éternelle, mais représentait une structure pro-tempore, presque toujours le résultat d'un affrontement de congrès autour de thèses opposées: les partisans de la thèse gagnante tentaient de la transformer en stratégie politique tandis que les partisans de la thèse perdante s'évertuaient à la saboter en attendant des temps meilleurs. Entre les assemblées, la majorité et la minorité intérieure continuaient à se flairer, à se défier et à se contaminer. Un prodige alchimique enfermé dans la formule de la soi-disant "dialectique interne", un euphémisme qui servait souvent à dissimuler pudiquement des contrastes profonds et des fractures verticales. Il n'est donc pas étonnant que les tribulations internes aient davantage contribué à dicter la ligne politique que les objectifs externes.

Là encore, rien de nouveau et rien de spécifiquement italien, puisque c'est Charles de Gaulle qui, avec le dégoût typique du général pour tout ce qui n'est pas militaire, a qualifié la politique de "cuisine des partis". Tout est donc normal. Comme le fait que personne ne pouvait rester chef malgré ses échecs. Une précision, cette dernière, qui n'est oiseuse qu'en apparence si l'on considère ceux, nombreux, qui continuent à faire la loi au sein de leur propre parti malgré leurs retentissants fiascos politiques et électoraux. Il en est ainsi, précisément, parce que la minorité est partout latente. Sauf au sein du parti démocrate, bien que même là, elle se déploie sous des formes désormais totalement inédites par rapport au passé, préférant des sorties extemporanées, souvent désordonnées et le plus souvent liées à des revendications personnalistes ou, tout au plus, groupusculaires. Bref, tout le monde s'en donne à cœur joie.
Et les résultats sont là : l'enquête de fin d'année sur les orientations politiques des Italiens, réalisée par Ipsos de Nando Pagnoncelli pour le Corriere della Sera, évalue à 42,2% (+ 3,2% par rapport aux élections générales de septembre 1922) le nombre d'abstentionnistes/indécis. Les raisons de la désaffection sont nombreuses, des millions, comme les étoiles de la publicité pour le célèbre salami, mais il ne fait aucun doute que parmi elles, il faut également mentionner l'absence de minorités internes organisées au sein des partis. Ce qui signifie accélérer la décomposition démocratique des partis et, par conséquent, provoquer une grave violation de l'article 49 de la Constitution ("Tous les citoyens ont le droit de s'associer librement en partis afin de concourir démocratiquement à la détermination de la politique nationale").
Oui, ce n'est peut-être pas clair pour tout le monde, mais notre Charte fondamentale protège les moyens plutôt que la fin. Cela signifie qu'un mouvement, un parti (pas un parti fasciste réanimé, dont la reconstitution serait expressément justifiée) peut également poursuivre des objectifs antidémocratiques (par exemple, la dictature du prolétariat), à condition de le faire démocratiquement. Dans ces conditions, chacun peut comprendre que la "mère de toutes les réformes" n'est pas tant la primauté que la nécessité de redonner un sens (et une légalité) à l'article 49 en "forçant" les partis à rendre leur direction contestable et à s'affronter également en leur sein.
Facile à dire, presque impossible à faire puisque l'argument se heurte de plein fouet à l'iceberg du droit électoral. Et même un enfant comprendrait que tant que le mode de scrutin actuel sera en vigueur, chaque chef de parti se sentira à l'étroit. Il ne lui échappe pas, en effet, que quiconque s'écarterait de ses décisions mettrait en péril sa candidature et donc sa nomination (et non son élection !) comme député ou sénateur. Et ce n'est pas tout, car le mécanisme de nomination - ainsi que la coïncidence de la direction et de la fonction de premier ministre dans la même personne - bouleverse complètement la relation entre le gouvernement et le parlement : c'est le premier qui contrôle et conditionne le second et non l'inverse, comme cela serait physiologique dans toute démocratie.

Il suffit de se rendre compte que la question de la minorité interne n'est pas un sujet mineur ou un sujet à confier à la magnanimité des dirigeants ou à la sensibilité des statuts. En effet, il est prévisible que les partis enfin contestables finiront par se rendre plus attractifs aux yeux des citoyens également du point de vue de l'engagement et de la participation, avec une possible récupération de la désaffection populaire et, par conséquent, avec une possible réduction du pourcentage d'abstentionnisme qui fait aujourd'hui du non-vote de loin le premier parti des Italiens.
Et si, sur le plan plus institutionnel, le retour des partis à la démocratie pourrait remettre à sa juste place la dialectique gouvernement-Parlement, sur le plan plus politique de la polémique, cela signifierait désarmer les dénigreurs assidus de la Casta, aussi bien ceux qui sont tapis dans la tribune que leurs trublions camouflés dans les stalles. Bref, qu'on le veuille ou non, l'avenir des partis dépend aussi de l'existence d'une minorité organisée en leur sein. Il ne s'agit pas de remplacer les actuels régiments prussiens où le chef décide pour tous par des armées de Bracaléone où personne ne commande, mais de rendre aux forces politiques leur rôle de lien avec la société civile et d'instrument de sélection de la classe dirigeante. Malheureusement (ou heureusement), une démocratie sans partis n'est pas encore en vue alors que des partis sans minorités, nous y goûtons déjà. Et nous avons tous compris qu'ils sont plus fades qu'une soupe sans sel.
20:38 Publié dans Actualité, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, théorie politique, politique, partis, partitocratie, sciences politiques, postdémocratie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 15 janvier 2024
Césarisme ou juristocratie: la fracture inattendue dans les démocraties contemporaines

Césarisme ou juristocratie: la fracture inattendue dans les démocraties contemporaines
Raphael Machado
Source: https://www.geopolitika.ru/pt-br/article/cesarismo-ou-juristocracia-inesperada-bifurcacao-das-democracias-contemporaneas
Nous avons été élevés dans l'idée que le terme "démocratie libérale" était pratiquement un nom composé, et nous nous sommes politiquement habitués à considérer que toute démocratie est libérale et que tout libéralisme est démocratique. Les exceptions étaient des accidents et des distorsions historiques, facilement rejetées.
Cette perspective était également associée à un certain optimisme pseudo-messianique, comme chez Francis Fukuyama, qui prédisait que cette formule de "démocratie libérale", dont la vérité et la supériorité avaient été démontrées par le triomphe de l'Occident suite à la guerre froide, deviendrait effectivement universelle.

Chaque pays du monde, de l'Islande à l'Érythrée, de la Bolivie au Cambodge, deviendrait une petite copie des États-Unis (ou de la France), avec "l'État de droit", la primauté des droits de l'homme, l'économie de marché, l'égalitarisme abstrait (le "voile d'ignorance" de Rawls), les centres commerciaux et les magazines Playboy, et tout ce que nous avons appris à identifier au "modèle occidental" au début des années 90.
Le processus d'ingénierie sociale planétaire appelé "globalisation" a certes progressé jusque dans les coins les plus inhospitaliers de la planète, mais la "McDonaldisation" du monde ne s'est pas accompagnée d'une amélioration objective des conditions matérielles des secteurs productifs (prolétariat, paysannerie et classe moyenne) dans le premier ou le tiers monde.

Au contraire, dans le sillage des "Reaganomics", les salaires dans la plupart des pays n'ont plus suivi l'augmentation de la productivité. On a assisté à une poussée vers la déréglementation du travail et la déstabilisation économique, accompagnée d'une déterritorialisation des entreprises. Si, d'un côté, cela a accéléré l'accumulation du capital, de l'autre, cela a commencé à pousser la classe moyenne vers le bas et le prolétariat vers le précariat.
D'autres processus ont accompagné le phénomène, selon les pays ou les continents. Par exemple, l'Europe a vu l'annulation directe de la volonté populaire face à tout résultat jugé négatif lors des référendums sur l'adhésion à l'Union européenne; la solution trouvée par les élites a été de répéter les référendums autant de fois qu'il le fallait pour obtenir finalement une approbation. À cela s'ajoute l'augmentation vertigineuse de la criminalité au cours des 30 dernières années, liée à l'affaiblissement des contrôles aux frontières et à l'immigration de masse.
En ce sens, il y a des "gagnants et des perdants" en matière de mondialisation. Dans l'utopie de la "fin de l'histoire", certains ont manifestement des existences plus utopiques que leurs concitoyens.
C'est la perception de cette aggravation des contradictions et du degré croissant d'aliénation des élites par rapport au peuple qui a donné naissance au phénomène (complexe et généralement mal compris) du populisme. En théorie, le processus continu d'accumulation et d'aliénation du capital a transformé les couches "triomphantes" des élites nationales en élites transnationales dotées d'un caractère déraciné et nomade. Cette élite n'est plus composée de travailleurs-entrepreneurs, qui commandent leur "force de travail" depuis l'usine ou l'entreprise, comme des capitaines d'industrie (et qui ont donc toujours une relation directe avec leur propre communauté, malgré les contradictions de classe); mais d'une sorte de caste purement financiarisée, anonyme, sans visage, déconnectée du processus de production et de l'espace physique et social même dans lequel ces relations socio-économiques se déroulent.

Ce détachement fait perdre une certaine sensibilité réaliste qui fait la longévité des élites dirigeantes. Il en résulte que les programmes égocentriques des élites ne sont plus reconnus par les masses; ce rejet s'exprime à travers la démocratie "sacrée", dans les défaites électorales des partis identifiés à ces intérêts élitistes. Quelle n'est pas la surprise des peuples lorsque, face à des résultats "désagréables" lors de référendums ou d'élections, les élites recourent à divers mécanismes (vides juridiques, précédents obscurs, analogies stupides, allégations d'exception ou de "force majeure", etc.).
Le sens classique de la démocratie comme gouvernement des citoyens par la méthode majoritaire, voire comme expression juridico-institutionnelle de la volonté générale rousseauiste, est confondu avec ses "appendices" libéraux jusqu'au paroxysme, culminant dans l'auto-inversion. Les élites en arrivent à la conclusion que pour sauver la "démocratie", elles doivent la suspendre.
En d'autres termes, on ne peut plus "faire confiance" au peuple. Il est trop "stupide", trop "conservateur", encore "attaché aux superstitions religieuses", etc. Ils ne sont donc pas "prêts pour la démocratie". On ne peut pas lui faire confiance pour prendre les "bonnes décisions", il faut donc créer des mécanismes pour "gérer" la démocratie, l'orienter dans la "bonne direction", quitte à aller à l'encontre de ce qui est manifestement l'opinion majoritaire, voire à empêcher le peuple d'exprimer son point de vue.
Cette gestion de la démocratie par des élites "éclairées" peut se faire par une myriade de méthodes, mais le moyen qui s'est avéré le plus efficace au cours des 30 dernières années semble avoir été la judiciarisation de toutes les questions sociales, c'est-à-dire le transfert du "dernier mot" sur chaque conflit ou controverse entre les mains du pouvoir judiciaire de chaque pays.

À cet égard, il est facile de comprendre pourquoi le pouvoir judiciaire est un outil intéressant: dans la plupart des pays, il n'est pas élu, de sorte que les positions de ce pouvoir ne sont pas soumises au principe démocratique, la racine du "problème"; pour la même raison, comme il n'y a pas de mandats, les juges en position permanente sont mieux placés dans leurs positions, le pouvoir judiciaire devenant une sorte d'"État profond", un corps permanent de fonctionnaires mieux placés pour influencer la direction de l'État que les politiciens en rotation permanente. Il va sans dire que le caractère "méritocratique" de la magistrature, compte tenu de la quasi indigence intellectuelle qui a caractérisé les pouvoirs législatif et exécutif dans de nombreux pays du monde, est également pertinent.
Mais ce rôle hypertrophié assumé par le pouvoir judiciaire n'est pas apparu soudainement comme une solution d'urgence à un problème conjoncturel.
Il faut ici souligner le rôle de la consolidation du néo-constitutionnalisme en tant que fondement théorique et institutionnel qui a rendu possible la transformation de la démocratie en juristocratie. Par néo-constitutionnalisme, nous entendons l'idéologie qui : a) affirme la suprématie de la Constitution, des principes et des normes qu'elle contient, dans l'ordre juridique ; b) soumet tous les actes exécutifs, législatifs et judiciaires au contrôle concentré d'un seul organe (la Cour suprême); c) lie le droit à la morale; d) place la défense et la promotion des soi-disant "droits de l'homme" comme une fonction de l'État et de la loi.
Le fait même que de nombreuses personnes considèrent certainement toutes ces caractéristiques comme "naturelles", "évidentes", "consensuelles", etc., plutôt que comme le fruit d'un choix idéologique spécifique, une option parmi d'autres, montre que le travail des défenseurs de la Juristocratie a été bien fait et que ses racines sont profondes; que le problème n'est pas un juge de la Cour Suprême occupant actuellement l'un de ses sièges, mais un système qui a été cultivé pendant des décennies.
Comme antidote à la normalisation, il suffit de rappeler que cet activisme judiciaire typique de la Juristocratie est une importation anglo-saxonne qui va à l'encontre de la tradition romano-germanique, dans laquelle le juge est un bureaucrate apolitique éloigné de la prise de décision sur les questions fondamentales. En fait, le néo-constitutionnalisme a été conçu dans le contexte d'un prétendu dépassement d'une tradition "positiviste" responsable de l'Holocauste.
La Constitution cesse alors d'être un document politique fondateur, dont l'objectif principal serait d'organiser l'État et de servir de guide et de paramètre aux administrateurs et aux législateurs, pour devenir un document normatif, dont les principes sont immédiatement applicables dans toute affaire portée devant un juge, selon l'interprétation que ce dernier fait des normes constitutionnelles.
Dès lors, le droit ne peut plus être séparé de la morale, dont le contenu est donné par l'idéologie des droits de l'homme, qui gagne en popularité et en consensus comme base commune pour établir des relations entre des peuples et des cultures si différents.
Idéalement, cette morale des droits de l'homme devrait être incorporée dans la Constitution, comme son noyau et comme l'axe herméneutique non seulement du texte constitutionnel lui-même, mais aussi de tout le système juridique - la Cour suprême décidant des éventuelles contradictions, ainsi que de l'interprétation correcte à donner aux règles, à la lumière de ces principes.
Il va sans dire que l'idéologie des droits de l'homme n'est pas une construction nationale (elle est le fruit d'un travail intellectuel et militant qui se déroule dans des organisations transnationales et des congrès académiques internationaux, et qui est en perpétuelle expansion), que le résultat est que les règles changent toujours sans que le peuple ou ses représentants élus n'aient changé quoi que ce soit - d'une année à l'autre, la Cour suprême d'un pays, interprétant les mêmes règles, mais déjà à la lumière des nouveaux "droits de l'homme" inventés à New York, Bruxelles et Genève, fait de ce qui était auparavant permis un délit pénal, ou autorise ce qui était auparavant interdit.

Récemment, par exemple, la Cour suprême du Mexique a dépénalisé l'avortement, alors que certains sondages d'opinion indiquent que la majorité des Mexicains sont opposés à l'avortement. Qu'en est-il du principe démocratique ? La juristocratie éclairée, dans son herméneutique des droits de l'homme, "comprend" que le "droit de l'homme" à l'avortement l'emporte sur la démocratie en tant que valeur universelle.
Le raisonnement sous-jacent est aussi impénétrable que les paroles des sibylles de Delphes. On n'explique pas, par exemple, pourquoi les juges et les juristes devraient être considérés comme de meilleurs "porte-parole" des droits de l'homme que le peuple lui-même, par le biais du vote. Ou pourquoi, lorsqu'il y a un conflit dans une nation entre différents droits de l'homme ou entre un droit de l'homme et un autre principe supposé universel, ce sont les juges et les juristes qui devraient décider ce qui est le plus important, et non le peuple, que ce soit par le biais du vote ou de la démocratie directe.
Cette logique d'affaiblissement et de discrédit de la démocratie réelle n'est cependant pas légitimée par des attaques verbales contre la démocratie. Au contraire, l'accélération de la dilution de la démocratie est directement proportionnelle à la défense verbale et rituelle de la démocratie et à la demande de sanctions draconiennes pour ceux qui sont coupables (ou soupçonnés) de l'attaquer. En effet, la consécration du concept de démocratie, achevée après l'effondrement du totalitarisme, ne permet pas de l'abandonner. Il faut donc imposer un régime de révision permanente du contenu du concept, tandis que son nom est crié de plus en plus fort, comme un slogan vide, pour détourner l'attention de l'opération.
Ce type d'opération ne peut que conduire à un discrédit de la démocratie elle-même. Il y a quelques semaines, l'Open Society a publié un sondage indiquant que près de 40% des personnes âgées de 18 à 35 ans soutiendraient un dirigeant fort qui se débarrasserait des élections et des assemblées législatives, à condition qu'il puisse garantir une série de besoins et d'exigences populaires.
Il convient de noter que de nombreux pays avaient déjà commencé à adopter ce que l'on appelle le "contrôle concentré de la constitutionnalité" (dans lequel la suprématie de la Constitution sur le reste du système juridique est garantie par un organe judiciaire spécifique qui juge de la constitutionnalité des normes). Cela signifie que lorsque le néo-constitutionnalisme s'est développé et que les constitutions ont été vulgarisées dans les manifestes néo-lumières, les conditions institutionnelles étaient déjà parfaites pour que les juges de la Cour suprême aient un pouvoir beaucoup plus important que les pouvoirs législatif et exécutif, ce qui n'a été pleinement réalisé qu'au cours des dernières années.
Ce différentiel de pouvoir n'est pas seulement important pour des raisons institutionnelles, mais aussi pour des raisons de légitimité. Le pouvoir judiciaire s'est donné un certain caractère de "sainteté", les juges étant considérés comme les champions de la nouvelle morale cosmopolite, investis d'une mission sacrée de civiliser les pays du monde, et leur auto-attribution a été reconnue par la classe journalistique, une grande partie du monde universitaire, les organisations internationales, les ONG, etc.
En ce sens, si les raids entre l'exécutif et le législatif sont considérés comme une simple lutte de pouvoir ou comme une tentative d'équilibrer les relations entre les pouvoirs, toute attaque similaire de l'exécutif ou du législatif contre le judiciaire est considérée comme une "attaque contre la démocratie", une "menace pour les institutions", un "risque de dictature", etc.
Si dans une démocratie digne de ce nom, la légitimité suprême est incarnée par la fonction élue à la majorité (généralement l'exécutif), dans le système actuel au Brésil et dans plusieurs pays du monde, la légitimité suprême (du moins selon tous ceux dont la voix a porté) est incarnée par une caste oligarchique et perpétuelle de spécialistes dont les valeurs sont manifestement incompatibles avec les valeurs du peuple.

Cette "légitimité" auto-attribuée et reconnue par les élites formatrices de l'opinion garantit au pouvoir judiciaire une "carte blanche" pour l'activisme judiciaire qui va de pair avec le néo-constitutionnalisme et lui donne une orientation. Si le néo-constitutionnalisme est un phénomène aux racines européennes, bien que construit en dialogue avec le monde juridique américain, l'activisme judiciaire est une importation fondamentalement yankee, dont les racines se trouvent dans le rôle prépondérant de la figure du "juge" dans la structure sociopolitique américaine.
Une généalogie métapolitique du phénomène nous conduirait nécessairement au "légalisme" anglo-saxon avec des racines puritaines (qui, à son tour, a ses racines dans le légalisme juif), comme source à la fois de l'idée de la "règle de droit" et du rôle plus actif de la figure du "juge" et, plus tard, du juge en tant que promoteur de la moralité publique (qu'il soit puritain ou, aujourd'hui, libéral-progressiste).
Avec la "constitutionnalisation" du droit, la Cour suprême des États-Unis a été le protagoniste de l'imposition de changements législatifs à grande échelle, de sa propre initiative, surtout à partir de la fin des années 1940, en exorbitant les lois sous prétexte de "combler des lacunes" ou de "garantir les droits fondamentaux".
Dans le cas du Brésil, le phénomène de l'activisme judiciaire est apparu avec force surtout depuis la Sixième République, dont la Constitution, patchwork plein de contradictions et de demi-mesures et de tentatives de concilier l'inconciliable, a été construite précisément dans l'esprit du néo-constitutionnalisme d'inspiration américaine.
Le discours utilisé dans les facultés de droit pour légitimer l'activisme judiciaire et la judiciarisation de toutes les relations sociales est d'une nature antidémocratique flagrante, ce qui passe évidemment inaperçu pour la plupart des étudiants. L'explication avancée, en particulier depuis l'affaire Mensalão, est que les pouvoirs exécutif et législatif ont été discrédités et ont aujourd'hui de moins en moins de légitimité sociale, et qu'ils ne sont pas fiables lorsqu'il s'agit de faire avancer des programmes et des questions qui sont considérés comme "nécessaires" (par les ONG et les organisations internationales), mais controversés en raison de la nécessité de rendre des comptes à la population au moment des élections.
Les jeunes juristes sont donc préparés à servir le peuple non pas comme des "opérateurs du droit", outils bureaucratiques discrets de l'État utilisés pour "dire le droit" face à toute controverse judiciarisable, mais comme une technocratie d'hommes éclairés dont le travail consiste à "sauver le pays" d'une élite politique "corrompue" et d'un peuple "ignorant" et "arriéré".
Il est cependant curieux de constater que cette bifurcation a commencé à conduire certains pays dans une direction diamétralement différente de celle suivie par les régimes dans lesquels les élites libérales ont réussi à s'emparer plus fermement du pouvoir et, surtout, de la construction des consciences.
Nous pouvons résumer toute cette tendance décrite ci-dessus comme un processus d'aliénation du peuple dans la décision de ses propres intérêts souverains, orchestré par des élites libérales qui s'appuient sur une technocratie juridique pour garantir la légitimité de la post-démocratie. Et l'on peut souligner que, face à ce phénomène, il est possible de se rendre compte qu'il est contré par la montée de leaders charismatiques à la tête de partis antilibéraux, qu'ils soient de droite ou de gauche.
C'est ce phénomène que l'on appelle péjorativement le "populisme" qui, comme tout concept politique utilisé par des adversaires pour désigner l'objet de leur inimitié, est difficile à définir et de portée variable.
Peu de ces projets dits "populistes" ont été portés au pouvoir en Europe, où le phénomène semble avoir été mieux analysé. Et ceux qui l'ont fait, comme dans le cas italien de la Lega, ont dû gouverner au sein de coalitions hétérogènes et composer avec des conditions plutôt défavorables à la mise en œuvre de leurs idées.

Nous pourrions mentionner le gouvernement de Donald Trump aux États-Unis, qui a non seulement cédé aux pressions internes de ce que l'on appelle l'État profond, mais s'est également défenestré lors des dernières élections présidentielles. Au Brésil, les phénomènes de Bolsonaro et de Lula, simultanément, sont les plus proches de l'idée, mais ils semblent avoir adopté le populisme uniquement comme une technique électorale et pour mobiliser des partisans, plutôt que comme quelque chose de plus profond.
Un cas plus réussi semble être celui de Nayib Bukele au Salvador, qui semble avoir atteint un certain degré de stabilité et pourrait être en mesure de s'accrocher au pouvoir pendant un certain temps.
Dans tous ces cas, plus ou moins réussis, il s'agit d'une pratique politique de mobilisation populaire permanente, à travers la connexion directe entre un leader charismatique et une masse qui représenterait "la majorité", en contournant les instances intermédiaires de représentation (considérées comme corrompues, cooptées ou inutiles). A la tête de cette "majorité", le leader populiste s'attaque alors aux élites libérales et aux maux qu'elles provoquent: de l'exclusion des bénéfices économiques de la mondialisation à la perte de souveraineté, en passant par l'idéologie "woke" et une myriade d'autres problèmes. Mais le défi fondamental est, dans tous les cas, la suppression ou la dilution de la démocratie en faveur d'une forme technocratique de gestion.
Les opposants libéraux, dans leur pays et à l'étranger, qualifient généralement ces personnages de "dictateurs" et de "fascistes" (le terme est même utilisé pour le Vénézuélien Nicolás Maduro), et appellent à un affrontement quasi apocalyptique contre eux au nom de la "civilisation" et contre la "barbarie"; un affrontement dans lequel tout est légal (jusqu'à la manipulation des résultats des élections) et tout est légitime (jusqu'à l'anéantissement physique de l'ennemi).
C'est ce discours, notons-le, qui donne le ton aux grandes questions politiques contemporaines, mettant Bukele et Maduro, Orban et Xi du même côté dans le camp de "l'Axe du Mal", qu'ils le veuillent ou non, qu'ils acceptent ou non le nouvel axe de coordonnées politiques. A cet égard, les discours d'auteurs inconnus lus par Joe Biden sur le téléprompteur sont éclairants.
Le phénomène que nous décrivons est bien sûr radicalement différent de ce que nous entendons par démocratie libérale, et surtout de ce qu'elle est devenue au cours des 20 dernières années. Mais le terme de "dictature", trivialement distribué aux ennemis, n'est pas adapté au sens strict.
Au sens strict, la dictature, en tant qu'institution d'origine romaine, est la suspension de l'ordre juridique commun dans un moment de crise et d'urgence, afin qu'un personnage, investi de pouvoirs exceptionnels, puisse faire face à la situation de crise. Il ne s'agit donc pas d'un "régime politique", mais d'un "phénomène politico-juridique".
Chez les Romains, tout cela était prévu par la loi, ce qui constitue une exception historique. La définition de la dictature comme la suspension de la législation ordinaire avec l'élévation d'un législateur-exécuteur extraordinaire dans une situation de crise a cependant perduré, apparaissant chez Gabriel Naudé, Juan Donoso Cortés et Carl Schmitt, entre autres.
Selon cette définition classique, ni la Russie ni la Chine ne peuvent être considérées comme des dictatures. La dictature n'est pas synonyme d'"autoritarisme" ou de "concentration du pouvoir dans l'exécutif", mais simplement de gouvernement supra-légal dans un état d'exception. On peut même faire un coup d'État et régner en dictateur après avoir suspendu une constitution, mais à partir du moment où le nouveau statu quo est juridiquement consolidé dans une nouvelle constitution et que les pouvoirs du putschiste deviennent le droit commun, il n'y a plus de dictature, même si cette transition s'est faite sans élections et si elle consacre un certain degré de concentration des pouvoirs.
Loin de pouvoir inscrire le phénomène populiste dans la logique de la dictature, puisqu'il n'y a pas de preuve de suspension de la Constitution ou de gouvernement par décret en état d'exception dans les pays dits populistes (contrairement à de nombreux pays libéraux lors de la crise sanitaire), tous les gouvernements populistes ont eu tendance à chercher à revigorer la démocratie par un lien plus direct avec le peuple. Dans cette optique, le siège du pouvoir exécutif par le pouvoir judiciaire, qui s'est accru au cours des dernières décennies, est considéré comme une usurpation du vote populaire.
Cependant, même si le pouvoir judiciaire est considéré comme un adversaire politique, les initiatives dirigées contre lui, au-delà des discours d'agitation de masse, se sont déroulées dans le cadre de la légalité, avec la nomination de juges, des changements législatifs suivant les procédures ordinaires ou, dans certains cas, la convocation d'assemblées constituantes pour réformer les constitutions et redistribuer ainsi les prérogatives.
 Au lieu de "dictature", il serait donc plus logique de parler de "démocratie illibérale" ou de "démocratie césariste", voire de "démocratie plébiscitaire". Le technocrate et politologue russe Vladimir Sourkov (photo), considéré comme "l'architecte du poutinisme", a inventé le terme de "démocratie souveraine" pour décrire le système russe.
Au lieu de "dictature", il serait donc plus logique de parler de "démocratie illibérale" ou de "démocratie césariste", voire de "démocratie plébiscitaire". Le technocrate et politologue russe Vladimir Sourkov (photo), considéré comme "l'architecte du poutinisme", a inventé le terme de "démocratie souveraine" pour décrire le système russe.
Tous ces termes, qu'ils soient inventés par les opposants ou par leurs défenseurs, semblent appropriés et raisonnables pour désigner la transformation politique représentée par le populisme.
Si le bonapartisme - concept également proche de celui dont nous parlons - s'est imposé en science politique grâce au 18 Brumaire de Karl Marx (au point d'être utilisé, par exemple, par certains auteurs marxiens pour décrire Kadhafi et d'autres personnages du 20ème siècle), l'idée d'une "démocratie césariste" dialogue avec les racines latines du Brésil.
Indépendamment du nom, cependant, la distinction fondamentale que nous voyons dans les manifestations de ce phénomène en Europe occidentale et dans les Amériques par rapport à l'Europe de l'Est, à l'Eurasie et au reste du monde, est qu'en dehors de l'axe atlantique, ce "césarisme" a dépassé le populisme en tant qu'agitation populaire et a trouvé des formes d'institutionnalisation et de normalisation juridiques qui renvoient aux traditions de chaque pays.
Il est donc impossible de dissocier le modèle de gouvernement de la Chine, fondé sur le parti, de la bureaucratie méritocratique de l'Empire chinois, ancrée dans la tradition confucéenne. De même qu'après ses aventures communistes et néolibérales, la Russie est revenue à un système qui rappelle l'autocratie russe pré-absolutiste du début de la dynastie des Romanov, lorsque le tsar était conseillé par le Zemsky Sobor, l'assemblée qui réunissait les boyards (les "oligarques" de l'époque), les bureaucrates, le synode orthodoxe et les représentants du peuple.
Penser à une démocratie césariste brésilienne pour sortir de la crise de la démocratie libérale et de la juristocratie sera extrêmement difficile et nécessitera de sortir des sentiers battus. Mais nous avons aussi des précédents historiques de leadership fort qui peuvent être repensés en termes d'un nouveau républicanisme démocratique illibéral qui surmonte le discrédit des institutions intermédiaires, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, par exemple en recourant largement à des formes de consultation populaire.
Cela nécessiterait évidemment de rééquilibrer la division tripartite des pouvoirs, qui est excessivement biaisée en faveur du pouvoir judiciaire en raison des processus historico-intellectuels décrits ci-dessus. Le pouvoir judiciaire ne peut plus être l'outil de suspension de la souveraineté populaire, comme il l'a été ces dernières années.
Curieusement, la juristocratie semble avoir été la solution au problème que Carl Schmitt avait signalé dans l'État libéral de l'ère Weimar. L'État de droit, fondamentalement contrôlé par le législateur, en réduisant le politique à la parole et à la négociation et en n'envisageant pas de mécanismes extraordinaires pour faire face aux crises générées par l'inaction typique du modèle de démocratie législative, a trouvé dans le libéralisme contemporain la solution de l'exceptionnalisme judiciaire.
Le césarisme, quant à lui, dans son expression de démocratie populaire, apparaît comme une autre solution à la crise de l'État de droit, faisant appel non pas à la dictature (comme le suggérait Schmitt), mais à un retour à la source de la souveraineté, le peuple, radicalisant la démocratie à travers la mobilisation politique constante des masses contre les oligarchies libérales.
Au-delà des dichotomies entre "civilisation" et "barbarie" ou "démocratie" et "autocratie", il semble que le paysage politique mondial se redessine selon une contradiction entre "démocraties césaristes" et "juristocraties libérales".
19:42 Publié dans Actualité, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, philosophie politique, politolmogie, sciences politiques, césarisme, juristocratie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 01 janvier 2024
Quel est le rapport entre le libéralisme et la liberté ?

Quel est le rapport entre le libéralisme et la liberté ?
Par Raphael Machado
Source: https://jornalpurosangue.net/2023/12/18/o-que-o-liberalismo-tem-a-ver-com-liberdade/
Il est très fréquent de voir les libéraux traiter leur théorie politique et la "liberté" en tant que valeur et principe comme s'ils étaient synonymes et comme s'il y avait une corrélation proportionnelle directe entre eux.
En fait, pour le libéralisme, la liberté est la valeur suprême et l'axe autour duquel tous les phénomènes sociaux, politiques, économiques et culturels sont lus. C'est plus qu'évident. Ce qui l'est moins, c'est "quelle" liberté ?
Le problème est que les libéraux traitent la "liberté" comme s'il s'agissait d'une chose qui existe dans la nature, ou d'une chose dont le contenu est évident et donné d'avance, et non d'une construction sociale et culturelle. Comme dans toute fausse conscience, ce qui est idéologique, relatif, construit et récent est traité comme scientifique, absolu, naturel et pérenne.
Seriez-vous surpris de découvrir que leur concept de liberté n'a que trois siècles ? Car si l'on définit la "liberté" comme l'absence d'obstacles, d'entraves ou d'interdictions à l'action individuelle, comme le droit de "faire ce que l'on veut", alors jusqu'à l'époque moderne, ce concept de liberté était fondamentalement inconnu de l'humanité.
Aussi étrange que cela puisse paraître, ce que presque tout le monde comprend de manière "évidente" comme étant la définition et le sens même de la "liberté" (certains vont jusqu'à la considérer comme un "droit naturel"!) n'est rien d'autre qu'une construction historique liée au triomphe historique de la bourgeoisie.
Le sujet est largement abordé par Benjamin Constant, Isaiah Berlin et Alain de Benoist.
Ce que les "anciens", comme Constant désignait les Grecs et les Romains, définissaient comme la liberté, c'était la participation active et constante à la communauté comme moyen d'exercer directement une part de souveraineté. La liberté serait donc un principe politique et une prérogative collective.
On n'est libre que dans la mesure où l'on participe à l'exercice de la souveraineté par le biais de la politique. La liberté ne concerne pas la sphère privée, mais la sphère publique. C'est pourquoi les décisions souveraines du corps politique sont rarement considérées comme des atteintes à la "liberté". La liberté est quelque chose qui implique aussi l'obéissance à l'autorité.
Isaiah Berlin aborde le sujet d'une manière différente, mais dans la même direction. Contrairement à ce qu'il appelle la "liberté négative" (c'est-à-dire la possibilité de faire ce que l'on veut, sans avoir à se soucier d'interdictions ou de limitations), Berlin parle de "liberté positive", qui serait une action autodéterminée orientée vers la réalisation de ses propres objectifs fondamentaux.
En ce sens, selon Berlin, un homme dépendant n'est jamais libre, car ses décisions sont facilement influencées par des impulsions qui échappent à son contrôle. Selon cette conception, il est même possible de recourir à l'intervention de l'État et à la coercition pour étendre la liberté, par exemple en renforçant les mécanismes d'autocontrôle et d'autodiscipline des hommes.
Si l'on combine les définitions de Constant et de Berlin, on obtient une vision assez fidèle de la conception traditionnelle de la liberté, telle qu'elle est défendue par Platon, ou telle qu'elle était valorisée dans les sociétés traditionnelles (même si elles n'ont pas toujours réussi à s'en approcher).
Dans la synthèse platonicienne, la liberté prélibérale serait donc la co-participation au corps politique dans la poursuite du Bien, ce qui implique nécessairement le gouvernement du meilleur et la recherche des vocations fondamentales de chacun, avec la responsabilisation de chaque citoyen pour qu'il puisse se réaliser de manière autonome (en tant que cellule du corps politique).
L'image finale est radicalement différente du concept de liberté inventé par les marchands ambulants, les usuriers et les parasites qui composaient la bourgeoisie naissante à la fin du Moyen-Âge et qui ont réussi, pendant longtemps, à dicter la direction du monde.
Le libéralisme (et ses dérivés comme le libertarianisme et l'anarcho-capitalisme), non seulement n'a donc pas le monopole de la défense de la liberté, mais peut aussi être interprété comme contraire à la liberté à la lumière de la Tradition.
18:26 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : libéralisme, liberté, théorie politique, philosophie, philosophie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 07 décembre 2023
Alexandre Douguine: le réalisme dans les relations internationales

Le réalisme dans les relations internationales
Alexandre Douguine
Source: https://www.geopolitika.ru/en/article/realism-international-relations
Alexandre Douguine examine le monde multipolaire émergent, en soulignant les voies idéologiques et civilisationnelles distinctes de diverses régions du monde, en opposition au paradigme libéral occidental.
Les réalistes pensent que la nature humaine est intrinsèquement viciée (héritage du pessimisme anthropologique de Hobbes et, plus profondément encore, échos des notions chrétiennes de déchéance - lapsus en latin) et qu'elle ne peut être fondamentalement corrigée. Par conséquent, l'égoïsme, la prédation et la violence sont inéluctables. On en conclut que seul un État fort peut contenir et organiser les humains (qui, selon Hobbes, sont des loups les uns pour les autres). L'État est une inévitable nécessité et détient dès lors la plus haute souveraineté. En outre, l'État projette la nature prédatrice et égoïste de l'homme, de sorte qu'un État national a ses intérêts qui sont ses seules considérations. La volonté de violence et la cupidité rendent la guerre toujours possible. Cela a toujours été et sera toujours le cas, estiment les réalistes. Les relations internationales ne se construisent donc que sur l'équilibre des forces entre des entités pleinement souveraines. Il ne peut y avoir un ordre mondial capable de tenir sur le long terme; il n'y a que le chaos, qui évolue au fur et à mesure que certains États s'affaiblissent et que d'autres se renforcent. Dans cette théorie, le terme "chaos" n'est pas négatif, il ne fait que constater l'état de fait résultant de l'approche la plus sérieuse du concept de souveraineté. S'il existe plusieurs États véritablement souverains, il n'est pas possible d'établir un ordre supranational auquel tous obéiraient. Si un tel ordre existait, la souveraineté ne serait pas complète, et en fait, il n'y en aurait pas, et l'entité supranationale elle-même serait la seule souveraine.



L'école du réalisme est traditionnellement très forte aux États-Unis, à commencer par ses premiers fondateurs : les Américains Hans Morgenthau et George Kennan, et l'Anglais Edward Carr.
Le libéralisme dans les relations internationales
Les libéraux en relations internationales s'opposent à l'école réaliste. Ils s'appuient non pas sur Hobbes et son pessimisme anthropologique, mais sur Locke et sa conception de l'être humain comme une table rase (tabula rasa) et en partie sur Kant et son pacifisme, qui découle de la morale de la raison pratique et de son universalité. Les libéraux en relations internationales croient que les gens peuvent être changés par la rééducation et l'intériorisation des principes des Lumières. C'est d'ailleurs là le projet des Lumières: transformer l'égoïste prédateur en un altruiste rationnel et tolérant, prêt à considérer les autres et à les traiter avec raison et tolérance. D'où la théorie du progrès. Si les réalistes pensent que la nature humaine ne peut être changée, les libéraux sont convaincus qu'elle peut et doit l'être. Mais tous deux pensent que les humains sont d'anciens singes. Les réalistes l'acceptent comme un fait inéluctable (l'homme est un loup pour l'homme), tandis que les libéraux sont convaincus que la société peut changer la nature même de l'ancien singe et écrire ce qu'elle veut sur son "ardoise vierge".
Mais si c'est le cas, l'État n'est nécessaire que pour l'éveil. Ses fonctions s'arrêtent là, et lorsque la société devient suffisamment libérale et civique, l'État peut être dissous. La souveraineté n'a donc rien d'absolu, c'est une mesure temporaire. Et si l'État ne vise pas à rendre ses sujets libéraux, il devient mauvais. Seul un État libéral peut exister, car "les démocraties ne se combattent pas".
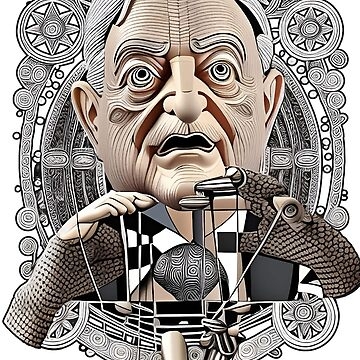
Mais ces États libéraux doivent s'éteindre progressivement pour laisser place à un gouvernement mondial. Ayant préparé la société civile, ils s'abolissent eux-mêmes. Cette abolition progressive des États est un progrès inconditionnel. C'est précisément cette logique que l'on retrouve dans l'Union européenne actuelle. Et les globalistes américains, parmi lesquels Biden, Obama, ou le promoteur de la "société ouverte" George Soros, précisent qu'au cours du déroulement du progrès, le gouvernement mondial se formera sur la base des États-Unis et de ses satellites directs - c'est le projet de la ligue des démocraties.
D'un point de vue technique, le libéralisme dans les relations internationales, opposé au réalisme, est souvent appelé "idéalisme". En d'autres termes, les réalistes en relations internationales croient que l'humanité est condamnée à rester telle qu'elle a toujours été, tandis que les libéraux en relations internationales croient "idéalement" au progrès, à la possibilité de changer la nature même de l'homme. La théorie du genre et le posthumanisme appartiennent à ce type d'idéologie - ils sont issus du libéralisme.
Le marxisme dans les relations internationales
Le marxisme est une autre orientation des relations internationales qui mérite d'être mentionnée. Ici, le "marxisme" n'est pas tout à fait ce qui constituait le cœur de la politique étrangère de l'URSS. Edward Carr, un réaliste classique en matière de relations internationales, a démontré que la politique étrangère de l'URSS - en particulier sous Staline - était fondée sur les principes du réalisme pur. Les mesures pratiques de Staline reposaient sur le principe de la pleine souveraineté, qu'il associait non pas tant à l'État national qu'à son "Empire rouge" et à ses intérêts.

Ce que l'on appelle le "marxisme dans les relations internationales" est davantage représenté par le trotskisme ou les théories du système mondial d'Immanuel Wallerstein (photo). Il s'agit également d'une forme d'idéalisme, mais d'un idéalisme posé comme "prolétarien".
Le monde y est considéré comme une zone unique de progrès social, grâce à laquelle le système capitaliste est destiné à devenir global. C'est-à-dire que tout va vers la création d'un gouvernement mondial sous l'hégémonie complète du capital mondial, qui est international par nature. Ici, comme chez les libéraux, l'essence de l'être humain dépend de la société ou, plus précisément, du rapport à la propriété des moyens de production. La nature humaine est donc de classe. La société élimine la bête en lui mais le transforme en un rouage social, entièrement dépendant de la structure de classe. L'homme ne vit pas et ne pense pas, c'est la classe qui vit et pense à travers lui.
Cependant, contrairement au libéralisme dans les relations internationales, les marxistes dans les relations internationales croient que la création d'un gouvernement mondial et l'intégration complète de l'humanité sans États ni cultures ne seront pas la fin de l'histoire. Après cela (mais pas avant, et c'est là la principale différence avec le système soviétique, avec le "stalinisme"), les contradictions de classe atteindront leur point culminant et une révolution mondiale se produira. L'erreur du stalinisme est ici considérée comme la tentative de construire le socialisme dans un seul pays, ce qui conduit à une version de gauche du national-socialisme. Ce n'est que lorsque le capitalisme aura achevé sa mission de destruction des États et d'abolition des souverainetés qu'une véritable révolution prolétarienne internationale pourra se produire. D'ici là, il est nécessaire de soutenir le capitalisme - et surtout l'immigration de masse, l'idéologie des droits de l'homme, toutes les sortes de minorités, et en particulier les minorités sexuelles.
Le marxisme contemporain est principalement pro-libéral, mondialiste et accélérationniste.
Le réalisme dans la théorie d'un monde multipolaire
La question se pose ici de savoir ce qui est le plus proche de la théorie d'un monde multipolaire : le réalisme ou le libéralisme ? Le réalisme ou l'idéalisme ?
Pour rappel, dans cette théorie, le sujet n'est pas l'État-nation bourgeois classique de l'époque moderne (dans l'esprit du système westphalien et de la théorie de la souveraineté de Machiavel-Bodin), mais l'État-civilisation (Zhang Weiwei) ou le "grand espace" (Carl Schmitt). Samuel Huntington a esquissé avec perspicacité un tel ordre mondial multipolaire au début des années 1990. Plusieurs États-civilisations, après avoir mené à bien des processus d'intégration régionale, deviennent des centres indépendants de la politique mondiale. J'ai développé ce thème dans la Théorie d'un monde multipolaire.

À première vue, la théorie d'un monde multipolaire concerne la souveraineté. Et cela signifie le réalisme. Mais avec une mise en garde très importante : ici, le détenteur de la souveraineté n'est pas seulement un État-nation représentant un ensemble de citoyens individuels, mais un État-civilisation, dans lequel des peuples et des cultures tout entiers sont unis sous la direction d'un horizon supérieur - religion, mission historique, idée dominante (comme chez les eurasistes). L'État-civilisation est un nouveau nom purement technique pour l'empire. Chinois, islamique, russe, ottoman et, bien sûr, occidental. Ces États-civilisations ont défini l'équilibre de la politique planétaire à l'ère précolombienne. La colonisation et la montée en puissance de l'Occident à l'époque moderne ont modifié cet équilibre en faveur de l'Occident. Aujourd'hui, une certaine correction historique est en cours. Le non-Occident se réaffirme. La Russie se bat contre l'Occident en Ukraine pour le contrôle d'une zone liminale de cruciale importance. La Chine se bat pour dominer l'économie mondiale. L'Islam mène un djihad culturel et religieux contre l'impérialisme et l'hégémonie de l'Occident. L'Inde devient un sujet mondial à part entière. Les ressources et le potentiel démographique de l'Afrique en font automatiquement un acteur majeur dans un avenir proche. L'Amérique latine affirme également ses droits à l'indépendance.
Les nouveaux sujets - des États-civilisations et, pour l'instant, seulement des civilisations, qui envisagent de plus en plus de s'intégrer dans des blocs souverains et puissants, les "grands espaces" - sont conçus comme de nouvelles figures du réalisme planétaire.
Mais contrairement aux États-nations conventionnels, créés dans le moule des régimes bourgeois européens de l'ère moderne, les États-civilisations sont déjà intrinsèquement plus qu'un amalgame aléatoire d'animaux agressifs et égoïstes, comme les réalistes occidentaux conçoivent la société. Contrairement aux États ordinaires, un État-civilisation est construit autour d'une mission, d'une idée et d'un système de valeurs qui ne sont pas seulement pratiques et pragmatiques. Cela signifie que le principe du réalisme, qui ne prend pas en compte cette dimension idéale, ne peut s'appliquer pleinement ici. Il s'agit donc d'un idéalisme, fondamentalement différent du libéralisme, puisque le libéralisme est l'idéologie dominante d'une seule civilisation, la civilisation occidentale. Toutes les autres, étant uniques et s'appuyant sur leurs valeurs traditionnelles, sont orientées vers d'autres idées. Par conséquent, nous pouvons qualifier d'illibéral l'idéalisme des civilisations non occidentales montantes, qui forment un monde multipolaire.
Dans la théorie d'un monde multipolaire, les États-civilisations adoptent donc simultanément des éléments du réalisme et du libéralisme dans les relations internationales.

Du réalisme, elles retiennent le principe de la souveraineté absolue et l'absence de toute autorité obligatoire et contraignante au niveau planétaire. Chaque civilisation est pleinement souveraine et ne se soumet à aucun gouvernement mondial. Ainsi, entre les Etats-civilisations, il existe un "chaos" conditionnel, comme dans les théories du réalisme classique. Mais contrairement à ces théories, nous traitons d'un sujet différent - non pas d'un État-nation constitué selon les principes des temps modernes européens, mais d'un système fondamentalement différent basé sur une compréhension autonome de l'homme, de Dieu, de la société, de l'espace et du temps, découlant des spécificités d'un code culturel particulier - eurasien, chinois, islamique, indien, etc.
Un tel réalisme peut être qualifié de civilisationnel, et il n'est pas fondé sur la logique de Hobbes, justifiant l'existence du Léviathan par la nature intrinsèquement imparfaite et agressive des bêtes humaines, mais sur la croyance de grandes sociétés, unies par une tradition commune (souvent sacrée) dans la suprématie des idées et des normes qu'elles considèrent comme universelles. Cette universalité est limitée au "grand espace", c'est-à-dire aux frontières d'un empire spécifique. Au sein de ce "grand espace", elle est reconnue et constitutive. C'est le fondement de sa souveraineté. Mais dans ce cas, elle n'est pas égoïste et matérielle, mais sacrée et spirituelle.
L'idéalisme dans la théorie d'un monde multipolaire
Mais en même temps, nous voyons ici un idéalisme clair. Il ne s'agit pas de l'idéalisme de Locke ou de Kant, car il n'y a pas d'universalisme, pas de notion de "valeurs humaines universelles" qui sont obligatoires et pour lesquelles la souveraineté doit être sacrifiée. Cet idéalisme civilisationnel n'est pas du tout libéral, et encore moins illibéral. Chaque civilisation croit à l'absoluité de ses valeurs traditionnelles, et elles sont toutes très différentes de ce que propose l'Occident mondialiste contemporain. Les religions sont différentes, les anthropologies sont différentes, les ontologies sont différentes. Et la science politique, qui se résume à la science politique américaine, où tout est construit sur l'opposition entre "démocraties" et "régimes autoritaires", est complètement niée. Il y a de l'idéalisme, mais pas en faveur de la démocratie libérale comme "but et sommet du progrès". Chaque civilisation a son idéal. Parfois, il n'est pas du tout similaire à celui de l'Occident. Parfois, il est similaire, mais seulement en partie. C'est l'essence même de l'illibéralisme: les thèses de la civilisation libérale occidentale contemporaine en tant que modèle universel sont rejetées. Et à leur place, chaque civilisation propose son système de valeurs traditionnelles - russe, chinoise, islamique, indienne, etc.
Dans le cas des civilisations d'État, l'idéalisme est associé à une idée spécifique qui reflète les objectifs, les fondements et les orientations de cette civilisation. Il ne s'agit pas seulement de s'appuyer sur l'histoire et le passé, mais d'un projet qui nécessite une concentration des efforts, de la volonté et un horizon intellectuel important. Cette idée est d'une autre nature que le simple calcul des intérêts nationaux, qui limite le réalisme. La présence d'un objectif supérieur (en quelque sorte transcendantal) détermine le vecteur de l'avenir, la voie du développement conformément à ce que chaque civilisation considère comme bon et le guide de son existence historique. Comme dans l'idéalisme libéral, il s'agit de tendre vers ce qui devrait être, ce qui définit les objectifs et les moyens d'avancer dans l'avenir. Mais l'idéal lui-même est ici fondamentalement différent: au lieu de l'individualisme ultime, du matérialisme et de la perfection des aspects purement techniques de la société, que l'Occident libéral cherche à affirmer comme un critère humain universel, reflétant uniquement la tendance historico-culturelle de l'Occident à l'ère postmoderne, chacune des civilisations non occidentales met en avant sa propre forme. Cette forme peut très bien contenir la prétention à devenir universelle à son tour, mais à la différence de l'Occident, les civilisations-états reconnaissent la légitimité des autres formes et en tiennent compte. Le monde multipolaire est intrinsèquement construit sur la reconnaissance de l'Autre, qui est proche et qui peut ne pas coïncider dans ses intérêts ou ses valeurs. Ainsi, la multipolarité reconnaît le pluralisme des idées et des idéaux, les prend en compte et ne dénie pas à l'Autre le droit d'exister et d'être différent. C'est la principale différence entre l'unipolarité et la multipolarité.

L'Occident libéral part du principe que toute l'humanité n'a qu'un seul idéal et qu'un seul vecteur de développement: le vecteur occidental. Tout ce qui est lié à l'Autre et qui ne coïncide pas avec l'identité et le système de valeurs de l'Occident lui-même est considéré comme "hostile", "autoritaire" et "illégitime". Dans le meilleur des cas, il est considéré comme "en retard sur l'Occident", ce qui doit être corrigé. Par conséquent, l'idéalisme libéral dans son expression mondialiste coïncide en pratique avec le racisme culturel, l'impérialisme et l'hégémonie. Les États-civilisations du modèle multipolaire opposent à cet "idéal" leurs propres conceptions et orientations.
Versions de l'idée illibérale
La Russie a traditionnellement tenté de justifier une puissance continentale eurasienne fondée sur les valeurs du collectivisme, de la solidarité et de la justice, ainsi que sur les traditions orthodoxes. Il s'agit là d'un idéal totalement différent. Tout à fait illibéral, si l'on s'en tient à la manière dont le libéralisme occidental contemporain se définit. Dans le même temps, la civilisation russe (le monde russe) possède un universalisme unique, qui se manifeste à la fois dans la nature œcuménique de l'Église orthodoxe et, pendant la période soviétique, dans la croyance en la victoire du socialisme et du communisme à l'échelle mondiale.
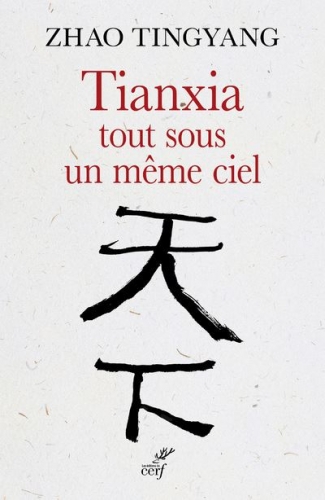
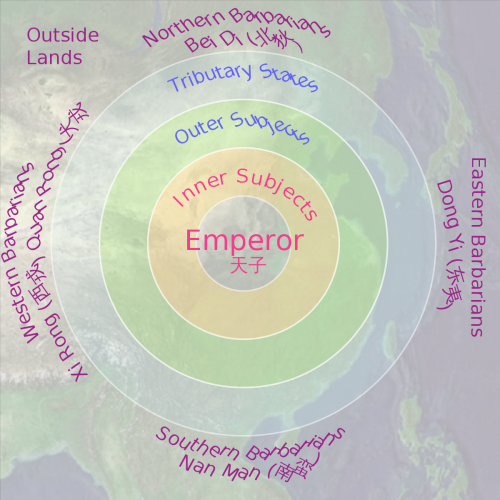
Le projet chinois de Xi Jinping de "communauté d'un avenir commun pour l'humanité" (人類命運共同體) ou la théorie de Tianxia (天下) représente un principe élargi de l'idéal confucéen traditionnel de l'Empire céleste, l'Empire chinois, au centre du monde, offrant aux peuples environnants le code culturel chinois comme idéal éthique, philosophique et sociopolitique. Mais le rêve chinois - tant dans sa forme communiste, ouvertement anti-bourgeoise et anti-individualiste, que dans sa version traditionnellement confucéenne - est très éloigné, dans ses fondements, du libéralisme occidental, et est donc essentiellement illibéral.
La civilisation islamique a également des principes inébranlables et est orientée vers la propagation de l'islam à l'échelle mondiale, en tant que "dernière religion". Il est normal que cette civilisation fonde son système sociopolitique sur les principes de la charia et sur l'adhésion aux principes religieux fondamentaux. Il s'agit là d'un projet illibéral.

Au cours des dernières décennies, l'Inde s'est de plus en plus tournée vers les fondements de sa civilisation védique - et en partie vers le système des castes (varnas), ainsi que vers la libération des modèles coloniaux de philosophie et l'affirmation des principes hindous dans la culture, l'éducation et la politique. L'Inde se considère également comme le centre de la civilisation mondiale et sa tradition comme l'apogée de l'esprit humain. Cela se manifeste indirectement par la diffusion de formes prosélytes simplifiées de l'hindouisme, telles que le yoga et les pratiques spirituelles légères. Il est évident que la philosophie du Vedanta n'a rien en commun avec les principes du mondialisme libéral. Aux yeux d'un hindou traditionnel, la société occidentale contemporaine est la forme extrême de dégénérescence, de mélange et de renversement de toutes les valeurs, caractéristique de l'âge des ténèbres : Kali Yuga.
Sur le continent africain, des projets civilisationnels propres émergent, le plus souvent sous la forme du panafricanisme. Ils s'appuient sur un vecteur anti-occidental et un appel aux peuples autochtones d'Afrique à se tourner vers leurs traditions précoloniales. Le panafricanisme a plusieurs directions, interprétant différemment l'idée africaine et les moyens de sa réalisation dans le futur. Mais toutes rejettent unanimement le libéralisme et, par conséquent, l'Afrique est orientée de manière illibérale.
Il en va de même pour les pays d'Amérique latine, qui s'efforcent de se distinguer à la fois des États-Unis et de l'Europe occidentale. L'idée latino-américaine repose sur la combinaison du catholicisme (en déclin ou complètement dégénéré en Occident, mais très vivant en Amérique du Sud) et des traditions revivifiées des peuples indigènes. Il s'agit là d'un autre cas d'illibéralisme civilisationnel.
Le choc des civilisations - une bataille d'idées
Ainsi, les idées russes, chinoises et islamiques ont chacune un potentiel universel exprimé de manière distincte. Elles sont suivies par l'Inde, tandis que l'Afrique et l'Amérique latine limitent actuellement leurs projets aux frontières de leurs continents respectifs. Cependant, la dispersion des Africains dans le monde a conduit certains théoriciens à proposer la création, principalement aux États-Unis et dans l'Union européenne, de zones africaines autonomes sur le principe des quilombos brésiliens. La population latino-américaine croissante aux États-Unis pourrait également influencer de manière significative la civilisation nord-américaine et le système de valeurs dominant à l'avenir. En raison de ses fondements catholiques et du lien préservé avec la société traditionnelle, il ne fait aucun doute qu'il entrera tôt ou tard en conflit avec le libéralisme, qui a des racines protestantes et nettement anglo-saxonnes.
Ainsi, la lutte entre un ordre mondial unipolaire et un ordre mondial multipolaire représente un conflit d'idées. D'un côté, le libéralisme, qui tente de défendre ses positions dominantes à l'échelle mondiale, et de l'autre, plusieurs versions de l'illibéralisme, qui s'expriment de plus en plus clairement dans les pays qui composent le bloc multipolaire.
20:13 Publié dans Actualité, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre douguine, réalisme, idéalisme, libéralisme, relations internationales, politique internationalen, philosophie politique, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 22 novembre 2023
Entre instabilité et novlangue: la crise de l'Occident selon Quigley

Entre instabilité et novlangue: la crise de l'Occident selon Quigley
Le problème de l'Occident, pour les savants anglo-saxons, se trouve dans l'accélération de la communication et la destruction des communautés, des corps intermédiaires, réalisée par la "commercialisation des relations humaines".
par Giovanni Sessa
Source: https://www.barbadillo.it/111776-tra-instabilita-e-neolingua-la-crisi-delloccidente-per-quigley/
 Nous sortons de la lecture d'un ouvrage intéressant, La fine dell'Occidente. Trame segrete del mondo a due blocchi de Carroll Quigley, publié en version italienne par Oaks publishing (sur commande: info@oakseditrice.it, pp. 283, euro 20). Le volume est édité par Spartaco Pupo, spécialiste de la pensée conservatrice et professeur à l'université de Calabre. Le nom de l'auteur est pratiquement inconnu du grand public en Italie, et pourtant c'est grâce à ses études que "les reconstructions téléologiques et déterministes ont été définitivement dépassées pour faire place à une perspective de l'histoire globale basée sur une analyse réaliste et anti-idéologique des événements" (p. 7). Cette déclaration de Pupo accompagne directement le lecteur dans le monde idéal de l'auteur. Le volume est une anthologie d'essais, d'interviews et de conférences de Quigley, dont le contenu est d'une actualité brûlante.
Nous sortons de la lecture d'un ouvrage intéressant, La fine dell'Occidente. Trame segrete del mondo a due blocchi de Carroll Quigley, publié en version italienne par Oaks publishing (sur commande: info@oakseditrice.it, pp. 283, euro 20). Le volume est édité par Spartaco Pupo, spécialiste de la pensée conservatrice et professeur à l'université de Calabre. Le nom de l'auteur est pratiquement inconnu du grand public en Italie, et pourtant c'est grâce à ses études que "les reconstructions téléologiques et déterministes ont été définitivement dépassées pour faire place à une perspective de l'histoire globale basée sur une analyse réaliste et anti-idéologique des événements" (p. 7). Cette déclaration de Pupo accompagne directement le lecteur dans le monde idéal de l'auteur. Le volume est une anthologie d'essais, d'interviews et de conférences de Quigley, dont le contenu est d'une actualité brûlante.
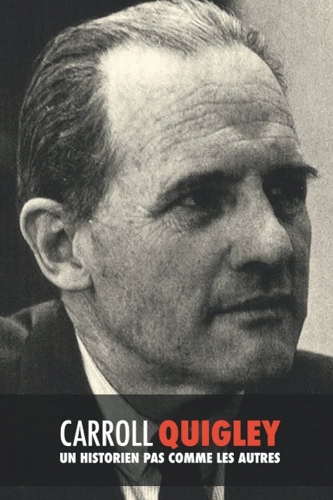 Qui était-il, se demandera le lecteur ? Cet historien est né à Boston dans une famille d'origine irlandaise. Éduqué dans des institutions catholiques, il est diplômé de Harvard. Il s'installe bientôt en Europe avec une collègue, Lillian Fox, qui deviendra plus tard son épouse. C'est à Milan qu'il rédige sa thèse de doctorat, encore inédite, sur l'administration publique dans le royaume napoléonien d'Italie. Dans ces pages, Quigley soutient une thèse qui met à mal la vulgate historiographique sur le sujet: Napoléon n'a pas imposé aux pays conquis des méthodologies de développement avancées mais, au contraire, a greffé au système français des méthodes administratives et budgétaires déjà éprouvées dans le Piémont et le duché de Milan.
Qui était-il, se demandera le lecteur ? Cet historien est né à Boston dans une famille d'origine irlandaise. Éduqué dans des institutions catholiques, il est diplômé de Harvard. Il s'installe bientôt en Europe avec une collègue, Lillian Fox, qui deviendra plus tard son épouse. C'est à Milan qu'il rédige sa thèse de doctorat, encore inédite, sur l'administration publique dans le royaume napoléonien d'Italie. Dans ces pages, Quigley soutient une thèse qui met à mal la vulgate historiographique sur le sujet: Napoléon n'a pas imposé aux pays conquis des méthodologies de développement avancées mais, au contraire, a greffé au système français des méthodes administratives et budgétaires déjà éprouvées dans le Piémont et le duché de Milan.
En 1941, il est appelé à la School of Foreign Service de l'Université de Georgetown à Washington, où il restera pendant quarante ans un conférencier estimé et passionné. En 1961, il publie le premier de ses ouvrages monumentaux, L'évolution des civilisations, dans lequel il présente son approche holistique des événements historiques. Dans une interview accordée au Washington Post, recueillie dans le volume, on peut lire: "Nous, les holistes, utilisons la pensée comme un réseau ou une matrice de choses. Les réductionnistes utilisent une éthique absolue: les choses sont bonnes ou mauvaises; les holistes utilisent une éthique situationnelle" (p. 11). Selon lui, la civilisation représente : "l'entité intelligible des changements sociaux d'une époque à l'autre" (p. 11).
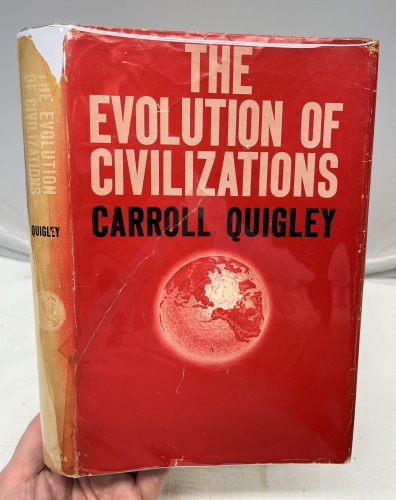 Dans cette perspective, l'histoire se développe par des phases "expansives" et "conflictuelles". L'organisation militaire, politique, religieuse et économique est le moteur de l'expansion qui produit des "surplus" de nature différente. D'une part, ils sont un instrument de stabilité politique; d'autre part, ils sont "consommés" par les peuples jusqu'au "gaspillage", ce qui induit le "déclin" d'un arrangement historique donné. À partir d'une telle condition, une nouvelle phase de civilisation redémarre cycliquement, comme Toynbee l'a noté, bien que d'une manière exégétique différente.
Dans cette perspective, l'histoire se développe par des phases "expansives" et "conflictuelles". L'organisation militaire, politique, religieuse et économique est le moteur de l'expansion qui produit des "surplus" de nature différente. D'une part, ils sont un instrument de stabilité politique; d'autre part, ils sont "consommés" par les peuples jusqu'au "gaspillage", ce qui induit le "déclin" d'un arrangement historique donné. À partir d'une telle condition, une nouvelle phase de civilisation redémarre cycliquement, comme Toynbee l'a noté, bien que d'une manière exégétique différente.
En 1966, avec le volume Tragédie et Espoir, Quiegly a dessiné sur lui-même les stries de l'"intellectuellement correct". En effet, dans ces pages, note l'éditeur, il élabore une dissection historico-politique inédite et "peu orthodoxe du monde institutionnel anglo-américain, fait de complots secrets et d'enchevêtrements complexes, mis en lumière avec une rare lucidité" (pp. 12-13).
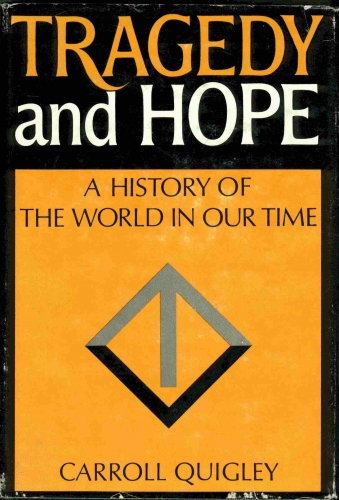 Entre le 19ème et le 20ème siècle, l'Occident a vu naître sa propre "tragédie", a jeté les bases de sa fin possible et a subordonné la politique au pouvoir financier. C'est une oligarchie d'origine britannique, d'orientation libérale et socialiste, dirigée par le Royal Institute of International Affairs, dont les ganglions ont fini par contrôler l'information de masse et le monde universitaire, qui a réalisé ce projet. À cette fin, une association secrète, The Round Table Group, a été créée, dont les membres se sentaient les défenseurs "de la beauté et de la civilisation dans le monde moderne", pour lequel ils voulaient répandre "la liberté et la lumière [...] non seulement en Asie mais même en Europe centrale" (p. 14).
Entre le 19ème et le 20ème siècle, l'Occident a vu naître sa propre "tragédie", a jeté les bases de sa fin possible et a subordonné la politique au pouvoir financier. C'est une oligarchie d'origine britannique, d'orientation libérale et socialiste, dirigée par le Royal Institute of International Affairs, dont les ganglions ont fini par contrôler l'information de masse et le monde universitaire, qui a réalisé ce projet. À cette fin, une association secrète, The Round Table Group, a été créée, dont les membres se sentaient les défenseurs "de la beauté et de la civilisation dans le monde moderne", pour lequel ils voulaient répandre "la liberté et la lumière [...] non seulement en Asie mais même en Europe centrale" (p. 14).
Ce réseau britannique avait d'importants correspondants outre-Atlantique : les Rockefeller, les Morgan et les Lazard. Quigley n'a jamais écrit sur les prétendues activités conspiratrices de ce groupe mais, à la lumière des documents, il a dévoilé les canaux de recrutement de cette oligarchie et ses moyens d'infiltrer les potentats politiques et culturels.
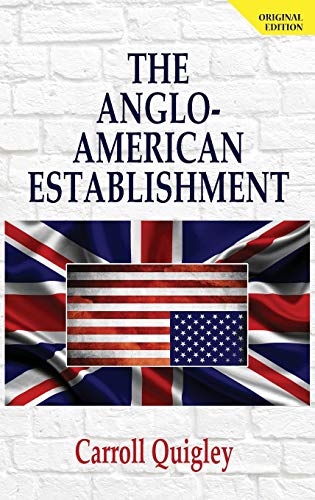
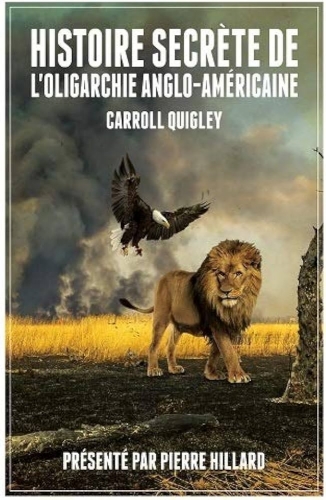
Dans un chapitre de La fine dell'Occidente, on peut lire : "le réseau secret est décrit comme une association d'impérialistes enthousiastes qui est restée en place bien après la Seconde Guerre mondiale" (p. 15). Pour cette raison, ses travaux ont été discrédités, retirés du circuit du livre et réédités par des éditeurs américains de droite. En outre, l'universitaire a collaboré avec les publications les plus connues du conservatisme américain. Le thème le plus pertinent, qui ressort des conférences, est l'idée que l'origine des conflits se trouve dans la volonté, non pas de détruire l'ennemi, mais de construire une période de paix durable. En outre, l'historien souligne que l'économie ne peut être élevée au rang de deus ex machina de l'exégèse historique, car cette position induit une sous-estimation de la "complexité" des événements. Plus précisément, il affirme que la démocratie américaine "n'a été définitivement établie que vers 1880, lorsque la répartition des armes dans la société était telle qu'aucune minorité n'était en mesure de subjuguer la majorité par la force" (pp. 20-21).
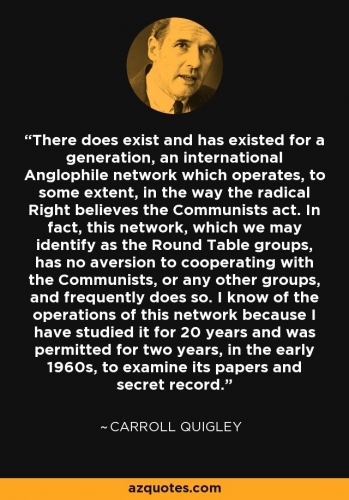
La lecture du monde divisé en blocs proposée par l'universitaire est frappante. L'instabilité occidentale a été donnée par l'hypertrophie assumée du monde financier et de la bureaucratie mammouth. Les Occidentaux continuent, aujourd'hui encore, à subir un "lavage de cerveau" permanent par le biais de la novlangue: "la certitude de pouvoir changer la réalité en modifiant le sens des mots" (p. 22), l'aboutissement extrême du néo-gnosticisme. Le centralisme soviétique est lu par Quigley comme un résultat de l'histoire russe, centré sur l'utilisation privée et semi-divine du pouvoir. Un modèle qui ne peut être exporté à l'Ouest, comme l'auraient prétendu les théoriciens de la contestation. Le problème occidental se trouve dans l'accélération communicationnelle et dans la destruction des communautés, des corps intermédiaires, réalisée par la "commercialisation des relations humaines", capable de réduire les hommes à l'état d'atomes.
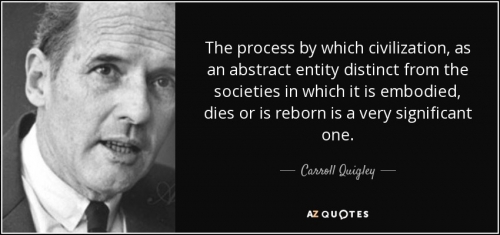
Un mois après sa dernière conférence, le professeur est décédé subitement. C'est pourquoi certains des textes de ce volume peuvent être considérés comme son testament spirituel. La fin de l'Occident est un livre qui ramène l'attention sur un penseur qui, comme il s'avère, mérite plus de considération.
20:36 Publié dans Actualité, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philoosophie, philosophie de l'histoire, caroll quigley, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
A propos de "Capitalisme, socialisme et démocratie" de Joseph A. Schumpeter

A propos de "Capitalisme, socialisme et démocratie" de Joseph A. Schumpeter
par Andrea Fumagalli
Source: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/26793-andrea-fumagalli-a-proposito-di-capitalismo-socialismo-e-democrazia-di-joseph-a-schumpeter.html
Grâce à l'intercession de Massimiliano Guareschi et surtout au travail d'Adelino Zanini (éditeur et correcteur) et à la traduction d'Emilio Zuffi, les éditions Meltemi rééditent un ouvrage fondamental pour le débat économique et politique du 20ème siècle : Capitalisme, Socialisme et Démocratie de Joseph A. Schumpeter.

Il s'agit du dernier grand ouvrage de l'économiste autrichien, qui a émigré à Harvard en 1932, peu avant la montée du nazisme en Allemagne (Hitler est devenu chancelier le 30 janvier de l'année suivante). Il s'agit également d'une sorte de testament politique, dans lequel on peut discerner les pierres angulaires de sa pensée économique, imprégnée d'un certain pessimisme quant au destin du capitalisme. Schumpeter a été (avec Marx et Keynes) l'un des trois plus grands analystes du système capitaliste. Le hasard a voulu qu'ils soient liés depuis 1883, année de la mort de Marx mais aussi de la naissance de Keynes et de Schumpeter, presque un passage de témoin.
Contrairement à Keynes (qui n'avait jamais lu Marx), Schumpeter était un proche de la pensée marxienne. Ce n'est pas un hasard si la première partie de Capitalisme, socialisme et démocratie est consacrée à une analyse critique du philosophe de Trèves. Si, d'une part, Schumpeter reconnaît à Marx le mérite d'avoir été le premier à analyser le capitalisme dans une perspective dynamique et non statique [1], avec une logique opposée à celle présente dans les modèles walrasiens d'équilibre général basés sur le concept de "Kreislauf" (flux circulaire), d'autre part, l'économiste autrichien critique l'approche marxienne basée sur le concept de lutte des classes. Schumpeter écrit (p. 75) :
"... Marx essaie de montrer comment, dans la lutte des classes, les capitalistes se détruisent les uns les autres et, à long terme, détruisent le système capitaliste lui-même. Il essaie également de montrer comment la propriété du capital conduit à une accumulation supplémentaire".
Mais voici la critique de Schumpeter :
"Mais cette façon d'argumenter, et la définition même qui élève la propriété au rang de caractéristique distinctive d'une classe sociale, ne font qu'accroître l'importance du problème de "l'accumulation primitive", c'est-à-dire de la façon dont les capitalistes ont réussi en premier lieu à le devenir, ou de la façon dont ils ont pris possession de la masse de marchandises qui, selon la doctrine marxienne, était nécessaire pour leur permettre d'initier l'exploitation. Sur ce point, Marx est beaucoup moins explicite (p. 75)".
Marx rejette l'idée que l'entrepreneur-capitaliste est doté de vertus particulières (talent, esprit d'entreprise et intelligence). Il s'agit d'une "fable bourgeoise" (Kinderfiebel). Or, selon Schumpeter
"quiconque regarde les faits historiques et contemporains avec un esprit dégagé de tout préjugé reconnaîtra que cette fable, si elle est loin de dire toute la vérité, en dit néanmoins une grande partie. Le succès industriel et surtout la fondation d'entreprises industrielles solides s'expliquent dans neuf cas sur dix par une intelligence et une énergie supérieures (p. 76)".
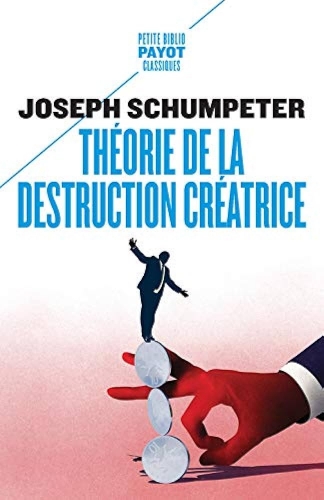
Si l'accumulation primitive peut être le résultat d'un processus de déprédation, de violence et d'exploitation, une fois établi historiquement, le capitalisme se caractérise également par sa capacité à se transformer continuellement grâce à un esprit d'entreprise innovant. La référence au processus de destruction créatrice que Schumpeter avait déjà décrit dans la Théorie du développement économique en 1911 (il n'avait pas encore 30 ans) est évidente ici. L'influence de Max Weber et de Werner Sombart est également perceptible. Le désaccord avec Marx est profond et Schumpeter estime que la figure de l'entrepreneur innovateur représente une "subjectivité" capable de redéfinir en permanence les rapports de production. Il n'y a pas de différence, de ce point de vue, entre structure et superstructure et le profit est la juste rémunération non pas d'un acte d'exploitation mais de la capacité entrepreneuriale à faire croître le capitalisme.
Dans la deuxième partie, Schumpeter évoque ensuite le sort du capitalisme : "Le capitalisme peut-il survivre ? Non, je ne le pense pas" (p.139). Une conclusion qui s'inscrit donc dans la continuité de la pensée marxienne. Mais les motivations sont évidemment différentes. Pour Schumpeter, le capitalisme sera victime de son propre triomphe. La capacité dynamique d'un tel système est la condition de sa survie, mais plus l'accumulation augmente (que Schumpeter définit comme le taux d'accroissement de la production réelle, chap. 5), grâce au pouvoir d'innovation de la classe des entrepreneurs, plus sa stabilité diminue et les conditions endogènes qui conduiront à sa fin apparaissent. Contrairement au Schumpeter des débuts, au Schumpeter de la jeunesse de la théorie du développement économique, le Schumpeter de la maturité est forcé de réaliser que le processus de destruction créatrice a cédé la place au capitalisme monopolistique. La transition clé est la révolution managériale et la Grande Dépression du début des années 1930 qui a suivi l'avènement du paradigme tayloriste. La nécessité d'exploiter les économies d'échelle statiques associées au paradigme tayloriste a entraîné l'augmentation de la taille des entreprises et la concentration des marchés dans les principaux secteurs de production. Cette évolution a entraîné la disparition de la figure de l'entrepreneur innovant et sa tendance à être remplacée par une bureaucratie managériale visant davantage à exploiter les rentes de situation qu'à favoriser les politiques innovantes.
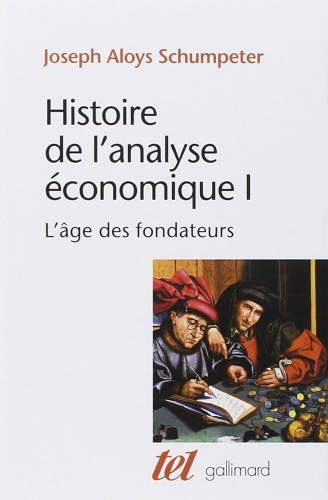

La philosophie politique de Schumpeter est d'autant plus conservatrice que sa philosophie économique est innovante et hétérodoxe. Le Schumpeter politique est nostalgique d'un capitalisme concurrentiel, composé de nombreuses petites entreprises, dont la compétitivité et le processus de sélection qui en découle est le moteur de sa capacité de transformation. Mais c'est précisément cette charge d'innovation qui a produit la bureaucratisation de l'entreprise que Schumpeter voit comme l'antichambre de la fin. Comme pour Marx, la recherche spasmodique du profit (plus-value) conduira l'évolution organisationnelle à marquer le déclin du capitalisme.
Mais contrairement à Marx, la fin du capitalisme ne conduira pas à une rupture révolutionnaire qui facilitera la transition vers une société plus juste et plus respectueuse de l'homme. Pour Schumpeter, l'euthanasie du capitalisme monopolistique conduira à une forme de socialisme. En fait, la transition vers le socialisme ne se fera pas par une révolution violente, comme l'ont prophétisé les marxistes et comme l'ont réalisé les bolcheviks, mais par un processus graduel, par voie parlementaire, et donnera naissance à un système socialiste compatible avec la démocratie, dans lequel la concurrence entre les groupes d'entreprises sera régulée non plus par le marché, mais par l'État.
Comme le souligne à juste titre Adelino Zanini dans sa savante et exhaustive préface :
"C'est ici que Schumpeter se livre à une "expérience de pensée" qui introduit l'un des points forts de Capitalisme, socialisme et démocratie, à savoir l'idée de la démocratie en tant que méthode politique" (p. 23).
Selon Schumpeter :
"un instrument constitutionnel pour parvenir à des décisions politiques - législatives et administratives - incapable, par conséquent, d'être une fin en soi, indépendamment de ce que ces décisions produiront dans des conditions historiques données" (p. 406).
C'est ainsi que l'on peut combiner le socialisme et la démocratie. La société socialiste est la fin, la démocratie la méthode.
* * * * *
Plus de 80 ans se sont écoulés depuis la publication de l'ouvrage de Schumpeter, et le thème de la survie du capitalisme est toujours d'actualité, rendu encore plus pressant aujourd'hui par la crise environnementale, qui voit l'effondrement du capitalisme coïncider avec la fin de la vie humaine. En revanche, la discussion sur la manière d'imaginer une transition vers une société non capitaliste et socialiste semble moins d'actualité. En ces temps de pensée unique militaire, associer socialisme et démocratie relève du blasphème.
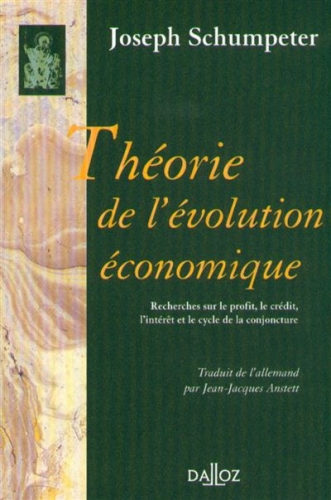
La pensée de Schumpeter peut être considérée, à cet égard, comme paradoxale, non exempte de contradictions, mais, peut-être pour cette raison, très stimulante. Après la crise des années 1930, le pacte social fordiste à la sauce keynésienne représentait la sortie de ces années, garantissant cette stabilité économique historiquement exceptionnelle grâce à la croissance simultanée des profits et des salaires, capable d'assurer un équilibre dynamique entre production de masse et consommation de masse (mais aussi au détriment des conditions de travail de l'ouvrier de masse). Pourtant, pour Schumpeter, le triomphe du fordisme est la cause principale du déclin du système capitaliste.
Le paradigme fordiste est entré en crise à la fin des années 1960 aux États-Unis et dans les années 1970 en Europe et au Japon. Les causes sont en partie celles prophétisées par Schumpeter (la bureaucratisation croissante des grandes entreprises), mais aussi celles préconisées par Marx : l'émergence d'un conflit de classes.
Mais à la fin des années 70 et dans les années 80, un nouveau processus de destruction créatrice s'est répandu, favorisant l'émergence du nouveau paradigme technologique des TIC (technologies de l'information et de la communication). D'une part, l'hypothèse de l'onde longue de Kondratieff (à laquelle Schumpeter avait fait allusion dans son ouvrage de 1939 intitulé Les cycles économiques) a été confirmée, mais d'autre part, la prédiction selon laquelle le gigantisme industriel conduirait à la disparition du capitalisme a été discréditée.
La nouvelle phase du capitalisme, que certains appellent capitalisme bio-cognitif ou capitalisme de plateforme, a su développer une nouvelle puissance innovatrice, technologique et organisationnelle qui a transformé structurellement les processus de valorisation et d'accumulation entre la financiarisation d'une part, et l'internationalisation sélective de la production et de la logistique d'autre part.
Il s'ensuit que le système capitaliste ne peut survivre que s'il est capable de mettre en œuvre un processus constant de métamorphose. Schumpeter suggère que ce processus n'est pas le résultat de son devenir. En d'autres termes, le capitalisme ne peut se sauver seul. Il a besoin de stimuli extérieurs, qui obligent le système capitaliste à modifier les routines d'accumulation établies, car il n'est plus capable d'obtenir des résultats satisfaisants. C'est là qu'intervient Marx qui, contrairement à Schumpeter, pense que des facteurs exogènes au capitalisme peuvent en modifier la structure, avec la possibilité de compenser sa dérive.
Que ce sont les forces anticapitalistes qui garantissent la survie du capitalisme lui-même ?
Note :
[1] Ce concept est également bien exprimé dans la préface de l'édition japonaise de 1937 de la "Théorie du développement économique". Marx est considéré par Schumpeter comme un spécialiste du développement économique et, en particulier, il se réfère à sa conception d'un tel développement comme étant basé sur un mécanisme d'auto-propulsion. Dans la préface de l'auteur à l'édition japonaise de l'ouvrage, Schumpeter a entrepris de formuler : "une théorie économique pure du développement économique, qui ne repose pas uniquement sur les facteurs externes susceptibles de propulser le système économique d'un équilibre à un autre... cette idée et cette intention sont exactement les mêmes que celles qui sous-tendent la doctrine économique de Karl Marx. En effet, ce qui le distingue des économistes de son temps comme de ceux qui l'ont précédé, c'est une conception de l'évolution économique comme processus particulier généré par le système économique lui-même (Schumpeter 1937, p. LX)".
18:09 Publié dans Economie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : capitalisme, socialisme, démocratie, joseph schumpeter, économie, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 21 novembre 2023
Perón, Fidel et Chávez: caudillos d'un socialisme national et référents pour la construction d'une quatrième théorie politique

Perón, Fidel et Chávez: caudillos d'un socialisme national et référents pour la construction d'une quatrième théorie politique
Carlos X. Blanco
Source: https://www.geopolitika.ru/es/article/peron-fidel-y-chavez-caudillos-de-un-socialismo-nacional-y-referentes-para-la-construccion
Le monde a radicalement changé après l'échec de l'Occident en Ukraine (2023), précédé par la fuite panique des Américains hors d'Afghanistan (2021), et leur ingérence désastreuse en Syrie. La machine militaire américaine, gigantesque et omniprésente sur toutes les mers, est un fiasco. Elle peut semer le chaos et intimider les gouvernements. Elle peut conditionner les politiques et les alliances et créer de plus en plus de souffrances. Mais ses échecs stratégiques annoncent la fin d'une époque et le début d'une autre.
Il existe un lien entre l'échec de l'OTAN en Ukraine et l'attitude génocidaire et irresponsable d'Israël à l'égard des Palestiniens. Tel est le lien révélé, telle est l'histoire et son épiphanie: le déploiement de la vérité au milieu des fleuves de sang et de la confusion des idées. Les rayons lumineux de la vérité percent des années après que les événements se sont éloignés. C'est avec un regard froid et critique que le Temps, juge sévère, contemple ce qui a déjà été. Et qu'est-ce que Chronos, à la lumière des faits, a condamné ?
Il n'y a pas d'autre vérité: le cycle américain se termine. C'est le cycle d'un "long siècle", commencé dans la perspective de la guerre contre l'Espagne en 1898. La "jeune nation américaine" y est lancée à l'assaut du monde, après avoir ruiné une civilisation hispanique (et, dans une moindre mesure, française) sur son propre continent. Les États-Unis d'Amérique prennent la relève de l'Empire britannique dans tous les sens du terme: la culture anglo-saxonne vient ficeler les rouages d'une machine économico-militaire de domination mondiale, bien plus thalassocratique et distributive que celle des Britanniques. Le capitalisme dans sa version extrêmement prédatrice n'aurait pas été possible sans ce processus de relais et de complémentarité impériale. La réinvention de l'anglosphère après 1898 a marqué le début de la fin de l'Europe et de bien d'autres civilisations anciennes et vénérables. Les puissances européennes n'ont pas empêché les Yankees d'abuser de l'Espagne, et elles le paient aujourd'hui. Au lieu d'être des puissances, ce sont des nations naines et des protectorats états-uniens sans dignité.

Le grand penseur russe Alexandre Douguine a proposé un cadre très complet et bien conçu pour orchestrer une révolte planétaire contre l'hégémon américain. Il s'agit d'un cadre à la fois ontologique et pratique. Il s'agit de localiser le "sujet" de la transformation planétaire.
Le libéralisme a centré son ontologie sur l'individu, atomisé et déifié. Le libéralisme dans sa version extrême nie l'existence même de la société (Thatcher), et dans sa version fanatique et caricaturale coïncide avec les hérésies anarchistes sur lesquelles s'appuie de plus en plus la gauche post-moderne occidentale: abolition de la famille, négation de la patrie, négation de l'identité biologique et sexuelle, autodétermination onaniste, hédonisme. Ce que l'on appelle aujourd'hui le néolibéralisme, de Milton Friedman à Javier Milei ou Isabel Díaz Ayuso, n'est pas si différent de la gauche anarchiste qui s'est réveillée et que Fusaro, avec beaucoup de pertinence et de justesse, appelle la "gauche arc-en-ciel". Il s'agit de la 1ère théorie politique, une théorie qui aurait été balayée de l'histoire pour sa faiblesse et son anti-humanisme si elle n'avait pas été soutenue par l'anglosphère.
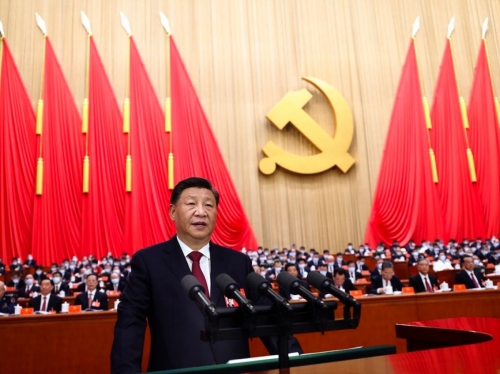
Douguine évoque la 2e théorie politique en des termes très intéressants. Son cycle, avec la chute de l'URSS et de son bloc de "socialisme réel" après 1989, semble clos, mais pas entièrement. L'évolution de la République populaire de Chine est un rappel intéressant de ce qu'est réellement le socialisme. Il est possible de parler de socialisme en termes de redistribution planifiée des richesses et de vision collectiviste nationale, alors que l'on assiste en même temps à une actualisation et à une validation authentiques et sincères des principes confucéens en Chine.
Il n'y a jamais de véritable socialisme sans une mise au centre du principe d'Autorité et sans une renaissance des valeurs traditionnelles de la polis adaptées au présent. Bien sûr, la gauche anarcho-libérale occidentale est incapable de comprendre ce que signifie encore le socialisme. Dans mon pays, l'Espagne, ceux d'entre nous qui suivent avec intérêt et admiration toute l'évolution impériale et socialiste de la Chine peuvent passer pour des "rancios" ou des "rojipardos" (= des "rouges-bruns"). L'utilisation de telles épithètes n'est rien d'autre qu'un signe de stupidité. La majeure partie de la gauche du style "Sumar" ou "Podemos" est un anarchisme petit-bourgeois infantile et ne sait rien faire d'autre que de distribuer des cartes progressistes dans ses réseaux sociaux. Lénine, Mao, etc. connaissaient le bon remède dont ces gens ont besoin.
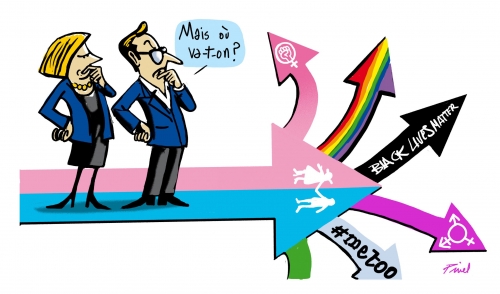
Il y a chez Douguine une attitude constructive à l'égard de la 2e théorie politique (socialiste, marxiste 2TP): en vue de la 4e théorie politique qu'il promeut, on lui donne une valeur critique et instrumentale, une valeur combative dans l'érosion de la 1re théorie politique, libérale ou capitaliste prédatrice sous l'hégémonie anglo-américaine.
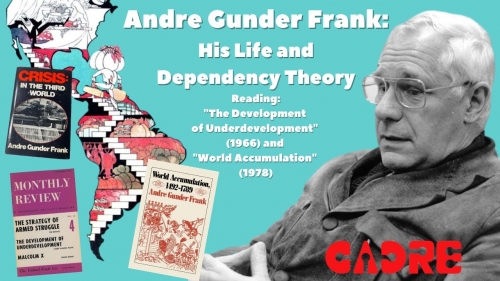
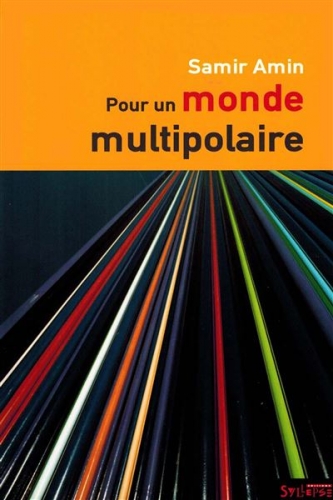
Le meilleur du marxisme récent contient des outils conceptuels qui sont clairement utiles, je dirais même nécessaires, pour la construction collective du monde multipolaire. Les théories marxistes de la dépendance, de l'échange inégal et de l'oppression du Centre sur la Périphérie (Gunder Frank et Samir Amin, parmi beaucoup d'autres) sont incontournables pour l'encerclement de cet empire anglo-américain qui s'est érigé en pôle dominant et unique de puissance. Les peuples opprimés en lutte, et cette alliance grandissante que l'on appelle aujourd'hui le "Global South", ont besoin d'une théorie adéquate de la lutte des classes et d'une vision rigoureuse de l'impérialisme. Dans son célèbre ouvrage "La quatrième théorie politique", Douguine expose clairement la nécessaire articulation des luttes de tous les peuples de la Terre, chacun avec sa propre vision du monde (religion, mythe, éthique et autres aspects de son contexte anthropologique) contre l'hégémon. L'hégémon est le (néo)libéralisme en tant qu'idéologie ou théorie politique, et c'est aussi l'Empire anglo-américain (Anglosphère) en tant que propriétaire ou leader de l'Occident collectif.
La 3ème théorie politique (3TP, fascisme et national-socialisme) est celle qui a été le plus sévèrement endommagée par Chronos, par le juge sévère. Sa défaite en 1945 était juste, nécessaire et définitive. Dans sa version fasciste pure (Mussolini), il constituait un étatisme pas si différent d'autres modèles socialistes évolués (comme nous l'avons déjà évoqué, dans le cas de la Chine post-maoïste). Un étatisme avec une forte composante syndicale et ouvrière peut être inclus dans le vaste catalogue des modèles de "3ème voie" ou de "3ème position" sans mériter, pour cette raison, l'étiquette actuelle - si criminalisée - de fascisme.

L'étatisme est considérablement réduit et est très éloigné des tendances despotiques si l'on adopte l'intéressant modèle péroniste de la "communauté organisée". La communauté organisée telle qu'elle a été tentée par le général Perón était, comme le terme l'indique, non pas tant un État totalitaire pur (comme celui de Mussolini) qu'une organisation rigoureuse du peuple lui-même en familles, communautés locales, branches syndicales et groupements professionnels, etc. Dans le cas de l'Espagne franquiste, la non-viabilité de son régime autoritaire résidait précisément dans l'incapacité du Caudillo lui-même et de son système personnel à se légitimer à nouveau comme un véritable État corporatif ou comme une véritable communauté organisée de travailleurs. Face à ces faiblesses organisationnelles, Franco n'a fait que prolonger un État autoritaire sur une base plutôt libérale, surtout après l'accaparement de la Phalange et du Carlisme, et l'irruption technocratique de l'Opus Dei. La base étant déjà libérale et développementaliste, l'opposition alimentée par les Américains et l'axe "européiste" franco-allemand ne pouvait que s'amplifier, non pas pour "injecter la démocratie" en Espagne mais pour lui enlever toute souveraineté, que Franco conservait encore, mais dans un équilibre précaire.
Une défaite plus grande, et définitive, est celle du national-socialisme. Le "sujet" de la version fasciste de la 3ème théorie politique est l'État, tandis que dans sa version nationale-socialiste, il s'agit de la race. La folie criminelle d'Hitler, son action génocidaire, et l'irrationalité - vaincue - des nazis en 1945 empêcheront toute renaissance d'une Théorie Politique centrée sur le Sujet "Race", même si, de manière tout à fait analogue, le sionisme israélien reste une idéologie très proche. Le sionisme est un nazisme qui, à ce jour, représente un cancer pour l'humanité et un danger existentiel, non seulement pour ses voisins, mais pour la planète entière, compte tenu de sa maîtrise de l'armement nucléaire.
L'évolution des "théories politiques" au sens douguinien est l'évolution des différents Sujets de la transformation politique du monde : l'individu abstrait et atomisé (1TP), la classe sociale, le prolétariat (2TP), l'Etat ou la Race (3TP). Le sujet de la quatrième théorie politique est, comme le sait tout lecteur du penseur russe, le Dasein. L'"être-là" heideggerien qui, à mon avis, est trop nébuleux pour une théorie politique qui transforme le monde et sert en même temps à le comprendre d'une manière pleinement rationnelle et non romantique. Car il faut situer ce Sujet nécessaire, tout en organisant une opposition multipolaire à l'hégémon américain. Un hégémon qui, avec l'énorme aide et aussi sous l'énorme pression du sionisme raciste israélien, met en danger la paix, la coexistence et le développement des autres peuples du monde.
Face à ce sujet nébuleux des 4TP, je suis très intéressé par la mise en évidence de la dialectique interne des théories politiques précédentes, leur réactivation contingente dans les différents scénarios et moments, ainsi que leurs résurrections. La lutte des classes au sens marxiste, le moteur de l'histoire dans la 2TP, peut avoir semblé désactivée dans l'Occident opulent et post-industriel. L'absence du sujet révolutionnaire explique la crise des partis communistes occidentaux, qui disposaient pourtant, jusqu'aux années 1980, de formidables appareils organisationnels, d'une hégémonie académique, d'un large militantisme, d'intellectuels et de leaders d'opinion prestigieux, d'une large représentation parlementaire et de tout le reste.
C'est l'embourgeoisement objectif d'une partie de la classe ouvrière, ainsi que la délocalisation de l'industrie occidentale, fuyant vers la périphérie à la recherche de chair humaine moins chère et plus exploitable (de préférence dans le "tiers-monde"), qui ont conduit à l'essor du "tiers-monde". Les partis communistes et les forces de la gauche radicale ont alors perdu leur identité, sont entrés en crise et ont cherché les "nouveaux prolétaires" (migrants étrangers, femmes opprimées "juste parce qu'elles sont des femmes", animaux dotés de "sensibilité et de droits", gays et lesbiennes, transgenres, etc.). Toutes ces personnes et toutes ces entités qui peuvent être pleurées, défendues, exaltées, etc. ne sont pas le "prolétariat". La théorie marxiste, centrée sur une vision du monde selon laquelle notre système mondial est fondé sur l'exploitation de l'homme par l'homme et, de manière de plus en plus abstraite et terrible, sur l'exploitation de l'homme par le Capital, est fatalement diluée et détruite dès lors que le Sujet révolutionnaire n'est plus le travailleur, ni une classe sociale plus ou moins rigoureusement définie comme une classe économique salariée et exploitée.
Ce que le marxisme occidental et la quasi-totalité de la gauche radicale occidentale ont perdu de vue, c'est le véritable Sujet de la lutte des classes. Ce n'est pas le cas du marxisme des organisations ouvrières et paysannes du Sud, des zones dépendantes et néo-colonisées où leurs acteurs sont très clairs sur le fait que la lutte contre le capitalisme passe par des stratégies de solidarité populaire. Seule la solidarité de classe peut mettre en échec les oligarchies, stopper les gouvernements corrompus, expulser les multinationales et coincer les propriétaires terriens néo-esclavagistes.
Il est effrayant de voir comment certains leaders de la gauche "réveillée" espagnole, bénéficiant même de portefeuilles ministériels, conseillent une "grève des jouets" et de cesser de manger de la viande (Baltasar Garzón), ou s'effilochent dans une lutte verbale contre un fascisme inexistant (Pablo Iglesias, I. Belarra, Monedero, Echenique, etc.), alors que dans le monde il y a des millions de personnes qui ne peuvent pas considérer de telles "luttes" simplement parce qu'ils vivent comme des esclaves et travaillent du lever au coucher du soleil pour manger une poignée de quelque chose de comestible par jour.

Ces bourgeois "éveillés" (woke) et ces gauchistes néolibéraux n'apportent rien. La vraie gauche est loin d'eux. Des paysans pauvres en tongs et un fusil à la main ont délogé les Américains au Vietnam et à Cuba. C'est cela la vraie gauche. Que la "gauche" espagnole et occidentale se préoccupe de mettre en œuvre l'Agenda 2030 dans les écoles, de forcer les enfants à participer à des "ateliers" d'endoctrinement sexuel hédoniste et de promouvoir le véganisme et le transsexualisme par décret, alors que le Capital continue dans tout le Sud à ravager des peuples entiers, les condamnant à l'émigration de masse, au trafic d'enfants et d'organes, et les envoyant comme des marchandises vers un Premier Monde décadent - avec la collaboration nécessaire des ONG mafieuses de l'immigrationnisme - n'est rien d'autre qu'une véritable honte. Cette gauche néolibérale, arc-en-ciel, "wokiste" et postmoderne (Izquierda Unida, Podemos, Sumar, Comunes, Esquerra, etc. en Espagne) n'a rien à voir avec le 2TP de Douguine.
Le 2TP (socialisme, marxisme) reste efficace contre le 1TP (libéralisme, néolibéralisme) dans la mesure où il reconstruit le concept de classe (classe sociale entendue selon des critères économiques, comme contrôle inégal des moyens de production) et donc le concept de lutte des classes. Le véritable 2TP, lorsqu'il est réactivé dans le contexte international multipolaire et post-guerre froide, reprend certains éléments du 3TP, précisément ceux qui sont essentiellement émancipateurs et qui n'ont pas été entachés par la criminalité fasciste et, surtout, national-socialiste. Alexandre Douguine affirme, d'une manière ou d'une autre, que l'arrière-plan valable (et donc susceptible d'être réactivé dans les moments qui suivent la disparition du 3TP par la défaite de 1945 est l'ethnos). En dehors de Mussolini, contre lui, il est possible de penser à un national-socialisme, c'est-à-dire à l'État non totalitaire émanant organiquement du Peuple. Un État du peuple, une communauté organisée de travailleurs. En dehors d'Hitler, et radicalement contre lui, contre son racisme pseudo-scientifique et irrationnel, on peut penser à un ethnos ou Volk, à un Sujet doté d'une identité collective qui se donne les moyens d'assurer sa survie (autarcique) et sa coexistence (solidaire) avec d'autres peuples.

En effet, les grands leaders anti-impérialistes ibéro-américains étaient des "socialistes nationaux", synthèses des 2TP et 3TP, véritables représentants du caudillisme hispanique invétéré, et référents pour toute la gauche authentique : Juan Domingo Perón, Fidel Castro, Hugo Chávez. Ce type d'homme hispanique est un caudillo, et le caudillisme est la forme particulière de cette aire civilisationnelle, héritière de l'empire espagnol (et aussi du portugais, qui n'a pas de différences culturelles ou ethniques substantielles avec l'Espagne). Les trois grands hommes mentionnés étaient des révolutionnaires, des anti-impérialistes et, par conséquent, des bâtisseurs de nouvelles nations. Ils ont créé dans la pratique un véritable socialisme national. Ils sont une synthèse du 2TP et du 3TP "purifié" de toute trace fasciste ou nazie, le 3TP décrit par Douguine. Ce sont des références essentielles pour construire la 4TP : la Théorie Politique qui parle d'une pluralité de civilisations articulées autour d'Empires garants a) de leur diversité interne (tout Empire non prédateur est pluriel) et b) de la diversité humano-planétaire. Une diversité fondée sur le droit international, et non sur des "règles" yankees : chaque empire doit éviter de s'immiscer chez son voisin, le respecter et collaborer avec lui au bénéfice de l'humanité.
21:01 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : quatrième théorie politique, alexandre douguine, théorie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 03 novembre 2023
La validité et l'efficacité de la pensée de Perón

La validité et l'efficacité de la pensée de Perón
Antonio Rougier
Source: https://geoestrategia.es/noticia/41680/opinion/la-vigenci...
Comme la vie le veut, et parce que les âmes sœurs se rencontrent aussi, je suis entré en contact via Facebook avec Pedro Jubera García de Madrid. Et, partant de conceptions apparemment différentes (socialisme espagnol et justicialisme argentin), nous nous sommes mis d'accord sur les fondamentaux : le respect de la dignité humaine et la lutte pour la justice sociale.
Sur cette base, il me demande d'essayer d'apporter des concepts sur "la validité et l'efficacité de la pensée de Perón" (dans un bref résumé) afin de contribuer à sa clarification dans les milieux espagnols à travers la prestigieuse REVISTA GEOESTRATEGIA.
Ma gratitude est suprême.
Péronisme ou justicialisme
Commençons par clarifier le "nom". Il faut savoir que le mot Justicialismo est synonyme de "doctrine péroniste". Parmi les idées et les concepts qui fondent le projet politique, le "péronisme" a été la première concrétisation de ces "idées ou doctrine" au cours de la vie du général Juan Domingo Perón.
Cela signifie qu'il peut y avoir d'autres "réalisations" de la doctrine péroniste, des idées de Perón, du justicialisme, comme ce fut le cas en Argentine, selon mon concept, du kirchnerisme et de l'actuel "multilatéralisme" en tant qu'expression de la "troisième position" proposée par Perón.
La coïncidence entre la "doctrine péroniste" et le "justicialisme" se trouve dans la définition même de la doctrine péroniste :
"La Doctrine péroniste ou Justicialisme, qui a pour but suprême d'atteindre le bonheur du Peuple et la grandeur de la Nation, au moyen de la Justice sociale, de l'Indépendance économique et de la Souveraineté politique, en harmonisant les valeurs matérielles avec les valeurs spirituelles, et les droits de l'individu avec les droits de la société".
Et sa réalisation, Perón l'explique ainsi, en parlant de sa "troisième position" le 1er décembre 1952 :
"Le gouvernement des nations peut se réaliser de différentes manières ; mais toutes, au cours de l'histoire, ont oscillé comme un pendule entre l'individualisme et le collectivisme. Nous pensons qu'entre ces deux extrêmes, il existe une troisième position, plus stable et permanente, et c'est sur cette troisième position que nous avons fondé toute notre doctrine, dont les principes constituent le Justicialisme et dont la réalisation est le Péronisme".
Nous essaierons donc désormais de partager avec vous ce qu'est le Justicialisme, dont la première "réalisation" a été le Péronisme. Et qui a été pensé comme une proposition universelle, comme nous essaierons de le justifier.
Le Justicialisme est un Mouvement National
Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que toute la proposition politique de Perón, dans ses idées et ses réalisations, s'adressait et s'adresse toujours "au peuple argentin dans son ensemble". Par conséquent, le Justicialisme n'est pas un "parti politique", même s'il prend cette forme pour pouvoir participer à la structure "démocratique" nationale et internationale actuelle.
Parce que Perón a pris l'Argentine, l'ensemble du peuple argentin comme une unité, comme un corps, comme une organisation unique. Et pour Perón, toute organisation, et donc l'Argentine, doit comporter deux éléments essentiels :
- l'organisation spirituelle, constituée par l'ensemble des idées et surtout par l'objectif qui "unit" les membres de toute organisation. Idées ou objectifs qui visent à unir les membres du Mouvement Justicialiste National.
- L'organisation matérielle, constituée par la forme et la manière de réaliser ces idées, cette finalité, que Perón appelle "formes d'exécution".

Pour Perón, l'instrument de l'organisation spirituelle est la "doctrine". Réaliser ce qu'il appelle "l'unité de conception", l'unité d'idées, l'unité d'objectifs au sein du peuple dans son ensemble.
Pour que le peuple nous accompagne librement et volontairement dans la réalisation de ces idées, de cette doctrine. Réaliser "l'unité d'action". Une tâche qui implique nécessairement une occupation constante pour "transmettre" ces idées, cette Doctrine.
Le but premier pour atteindre le but suprême
Le but premier des idées, d'une "doctrine nationale" était de réaliser ce qu'il appelait "l'unité nationale" le 1er mai 1950 avec ces concepts.
"Pour que notre peuple adopte notre idéologie et réalise la coïncidence essentielle pour atteindre notre objectif premier d'unité nationale, il était nécessaire d'abattre toutes les barrières de séparation entre le peuple et ses gouvernants et entre les différents groupes sociaux d'un même peuple, et de faire en sorte que chaque Argentin se sente maître de son propre pays. C'est pourquoi nous avons lancé le grand objectif de notre mouvement : la justice sociale".
La doctrine n'est pas née d'une réflexion de bureau mais d'un "processus" permanent de contact et de dialogue avec les travailleurs en particulier.
Ce processus peut se résumer ainsi : le premier objectif de Perón était la "justice sociale" : que chaque Argentin vive un peu plus heureux, un peu plus dignement que jusqu'alors, comme le veut le principe de la "dignité humaine".
Lorsqu'il a essayé de mettre cela en pratique, il a constaté que presque tous les biens du pays se trouvaient dans des mains étrangères : la Banque centrale, les chemins de fer, les transports terrestres et maritimes, etc. Il lui faut donc réaliser l'"indépendance économique" et la "souveraineté politique" sans lesquelles cette justice sociale est impossible.


La réalisation de cette "justice sociale" par le biais de l'"indépendance économique" et de la "souveraineté politique" a pris toute la durée du premier gouvernement : de 1946 à 1951, et il l'a réalisée par le biais du premier plan quinquennal.
Une fois la "justice sociale" réalisée avec succès au cours de cette période et en préparation du deuxième plan quinquennal, il définit "la doctrine péroniste ou justicialisme" comme le troisième article de la loi "nationale" 14.184 du deuxième plan quinquennal :
"Aux fins d'une interprétation correcte et d'une exécution efficace de la présente loi, la "doctrine nationale", adoptée par le peuple argentin, est définie comme la doctrine péroniste ou le justicialisme, qui a pour objet:
- L'objectif suprême est d'atteindre le bonheur du peuple et la grandeur de la nation,
- par la justice sociale, l'indépendance économique et la souveraineté politique,
- en harmonisant les valeurs matérielles avec les valeurs spirituelles, et les droits de l'individu avec les droits de la société.
L'objectif premier de "l'unité nationale" pour atteindre l'objectif suprême du "bonheur du peuple et de la grandeur de la nation".
Tous ces concepts proposés dans l'histoire, en tant que projet politique, n'ont été proposés par le Justicialisme qu'avec cette clarté et sont parfaitement réalisables aujourd'hui dans n'importe quelle partie du monde.
Dans n'importe quel pays du monde, il est possible de former un Mouvement qui vise le "tout" du Peuple. Il est "national".
Il a pour but premier l'unité nationale.
Son but suprême doit être "le bonheur de son peuple et la grandeur de sa nation".
Qu'il réalise ce bonheur et cette grandeur par la justice sociale, l'indépendance économique et la souveraineté politique.
En cherchant toujours, en toutes choses, à harmoniser les valeurs matérielles avec les valeurs spirituelles et les droits de l'individu avec ceux de la société.
Bien sûr, en essayant de comprendre, par la réflexion et l'étude, quel est le sens et la signification que le Justicialisme donne à chacun de ces concepts.
Un sens et une signification que l'on retrouve dans le plan de formation mis en œuvre par Perón à travers l'École supérieure péroniste et les Écoles syndicales pour parvenir à l'"élévation culturelle" permanente de l'ensemble du peuple. Vous pouvez consulter ce plan sur le site www.escuelasuperiorperonista.com
Et dont la première et synthétique explication se trouve dans ce résumé.
APERÇU GÉNÉRAL DE LA DOCTRINE PÉRONISTE OU JUSTICIALISME:
1 - Objectifs de la doctrine.
1.1 - Immédiat : l'unité nationale. 1.2.
1.2 - Ultime : bonheur du peuple et grandeur de la nation.
2.- L'homme, la femme, l'être humain est une dignité (c'est le principe philosophique fondamental).
2.1 - Est un principe et une fin en soi (a des valeurs individuelles).
2.2 - Elle a une fonction sociale (valeurs sociales).
2.3 - Elle a des valeurs spirituelles (c'est l'harmonie de la matière et de l'esprit).
3.- La justice sociale (c'est le principe sociologique fondamental), qui implique :
3.1 - Elever la culture sociale (sociologie de la culture)
3.2 - Dignifier le travail (sociologie du travailleur, de la famille, du peuple, de l'Etat).
3.3 - Humaniser le capital (sociologie économique).
4.- L'indépendance économique (principe économique fondamental) signifie:
4.1 - Récupérer le patrimoine national (première étape).
4.2 - Réactiver l'économie (mettre le capital au service de l'économie).
4.3 - Répartir équitablement les richesses (mettre l'économie au service de la fonction sociale).
5.- La souveraineté politique (c'est le principe politique fondamental) qui signifie :
5.1 - Respecter la souveraineté des citoyens (droits des citoyens)
5.2.- Respecter la souveraineté du peuple (démocratie).
5.3 - Respecter la souveraineté de la Nation (autodétermination des Peuples).

Sans jamais oublier le fondement spirituel du Justicialisme et ses conséquences, exprimé dans ce texte de l'Histoire du Péronisme d'Eva Perón.
"Les doctrines triomphent, dans ce monde, selon la dose d'amour infusée dans leur esprit. C'est pourquoi le Justicialisme, qui commence par affirmer qu'il est une doctrine d'amour et finit par dire que l'amour est la seule chose qui construit, triomphera.
Plus la doctrine est grande, plus elle est niée, plus elle est combattue. C'est pourquoi nous, les Justiciers, nous devons être fiers de savoir que les incapables, les vendus, les vénaux, ceux qui ne sont pas dans les intérêts patriotiques, la combattent de l'intérieur et de l'extérieur. Notre doctrine doit être bien grande quand elle est ainsi redoutée, combattue, détruite".
"Son efficacité et sa permanence dans le temps (1945-2023), comme le dit une chanson populaire : "malgré les bombes, les fusillades, les camarades morts, les disparus, ils ne nous ont pas vaincus". Et ils ne nous vaincront pas parce que le Justicialisme est une doctrine d'amour, parce que l'amour est la seule chose qui construit. Ce n'est qu'avec l'amour que l'on peut construire le bonheur d'un peuple et la grandeur d'une nation.
Et l'amour ne peut être tué. Il ne meurt jamais".
22:36 Publié dans Histoire, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : argentine, juan peron, evita peron, justicialisme, peronisme, amérique latine, amérique du sud, amérique ibérique, théorie politique, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 24 octobre 2023
Diego Fusaro: La mondialisation néolibérale, une nouvelle foi religieuse

La mondialisation néolibérale, une nouvelle foi religieuse
Diego Fusaro
Source: https://geoestrategia.es/noticia/41653/opinion/globalizacion-neoliberal-una-nueva-fe-religiosa.html
Selon la syntaxe de Gramsci, il y a "idéologie" quand "une classe donnée réussit à présenter et à faire accepter les conditions de son existence et de son développement de classe comme un principe universel, comme une conception du monde, comme une religion".
Le point culminant esquissé par Gramsci est tout à fait pertinent si l'on se réfère à l'idéologie de la mondialisation comme nature donnée, irréversible et physiologique (globalismus sive natura). Dans le cadre du Nouvel Ordre Mondial post-1989 et de ce qui a été défini comme "le grand échiquier", elle se présente comme un "principe universel", parce qu'elle est indistinctement acceptée dans toutes les parties du monde (c'est ce qu'on pourrait appeler la globalisation du concept de globalisation) et, en même temps, elle est aussi assumée par les dominés, qui devraient s'y opposer avec la plus grande fermeté. Elle se présente comme une vérité incontestable et universellement valable, qui ne demande qu'à être ratifiée et acceptée sous la forme d'une adaequatio cognitive et politique.
La mondialisation apparaît ainsi comme une "vision du monde", c'est-à-dire comme un système articulé et englobant, parce qu'elle a été structurée sous la forme d'une perspective unitaire et systématique, centrée sur la dénationalisation du cosmopolitisme et sur l'élimination de toutes les limitations matérielles et immatérielles à la libre circulation des marchandises et des personnes marchandisées, aux flux de capitaux financiers liquides et à l'extension infinie des intérêts concurrentiels des classes dominantes.
Enfin, elle prend la forme d'une "religion", parce qu'elle est de plus en plus vécue comme une foi indiscutable, largement située au-delà des principes de la discussion rationnelle socratique : celui qui n'accepte pas sans réfléchir et avec des références fidéistes le nouvel ordre mondialisé sera immédiatement ostracisé, réduit au silence et stigmatisé par la police du langage et les gendarmes de la pensée comme un hérétique ou un infidèle, menaçant dangereusement la stabilité de la catéchèse mondialiste et de ses principaux articles de foi (libre circulation, ouverture intégrale de toute réalité matérielle et immatérielle, compétitivité sans frontières, etc. ). La mondialisation coïncide donc avec le nouveau monothéisme idolâtre du marché mondial, typique d'une époque qui ne croit plus en Dieu, mais pas au capital.
D'une manière générale, la mondialisation n'est rien d'autre que la théorie qui décrit, reflète et, à son tour, prescrit et glorifie le Nouvel Ordre Mondial de classe post-westphalien, qui a émergé et s'est stabilisé après 1989 et qui - pour reprendre la formule de Lasch - a été idéologiquement élevé au rang de vrai et unique paradis. Tel est le monde entièrement soumis au capital et à l'impérialisme américano-centré des marchés de capitaux privés libéralisés, avec l'exportation collatérale de la démocratie de marché libre et du désir libre, et de l'anthropologie de l'homo cosmopoliticus.

Le pouvoir symbolique du concept de mondialisation est si envahissant qu'il rend littéralement impossible l'accès au discours public à quiconque ose le remettre en question. En ce sens, il s'apparente davantage à une religion au credo obligatoire qu'à une théorie soumise à la libre discussion et à l'herméneutique de la raison dialogique.
À travers des catégories devenues des pierres angulaires du néo-langage capitaliste, toute tentative de limiter l'envahissement du marché et de contester la domination absolue de l'économie mondialisée et américano-centrée est diabolisée comme "totalitarisme", "fascisme", "stalinisme" ou même "rouge-brunisme", la synthèse diabolique de ce qui précède. Le fondamentalisme libéral et le totalitarisme mondialiste du marché libre démontrent également leur incapacité à admettre, même ex hypothesi, la possibilité théorique d'autres modes d'existence et de production.
Toute idée d'un contrôle possible de l'économie et d'une éventuelle réglementation du marché et de la société ouverte (avec un despotisme financier intégré) conduirait infailliblement, selon le titre d'une étude bien connue de Hayek, vers la "route du servage". Hayek l'affirme sans euphémisme : "le socialisme, c'est l'esclavage".
De toute évidence, le théorème de von Hayek et de ses acolytes ne tient pas compte du fait que le totalitarisme n'est pas seulement le résultat d'une planification politique, mais peut aussi être la conséquence de l'action concurrentielle privée des règles politiques. Dans l'Europe d'aujourd'hui, d'ailleurs, le danger n'est pas à chercher du côté du nationalisme et du retour des totalitarismes traditionnels, mais plutôt du côté du libéralisme de marché hayékien et de la violence invisible de la matraque subtile de l'économie dépolitisée.
Il est donc impératif de décoloniser l'imaginaire des conceptions hégémoniques actuelles de la mondialisation et d'essayer de redéfinir son contenu d'une manière alternative. Cela nécessite une nouvelle compréhension marxienne des relations sociales comme étant mobiles et conflictuelles, là où le regard chargé d'idéologie n'enregistre que des choses inertes et aseptisées, rigides et immuables.
En d'autres termes, il est nécessaire de déconstruire l'image hégémonique de la mondialisation, en montrant son caractère de classe et non de neutralité.
Lorsqu'elle est analysée du point de vue des classes dirigeantes mondialistes, la mondialisation peut en effet sembler enthousiaste et très digne d'être louée et valorisée.
Par exemple, Amartya Sen la célèbre avec insistance pour sa plus grande efficacité dans la division internationale du travail, pour la baisse des coûts de production, pour l'augmentation exponentielle de la productivité et - dans une mesure nettement plus discutable - pour la réduction de la pauvreté et l'amélioration générale des conditions de vie et de travail.
Il suffit de rappeler, à l'aube du nouveau millénaire, que l'Europe compte 20 millions de chômeurs, 50 millions de pauvres et 5 millions de sans-abri, alors qu'au cours des vingt dernières années, dans cette même Europe, les revenus totaux ont augmenté de 50 à 70 %.

Cela confirme, d'une manière difficilement réfutable, le caractère de classe de la mondialisation et du progrès qu'elle génère. Du point de vue des dominés (et donc vue "d'en bas"), elle s'identifie à l'enfer très concret du nouveau rapport de force technocapitaliste, qui s'est consolidé à l'échelle planétaire après 1989 avec l'intensification de l'exploitation et de la marchandisation, du classisme et de l'impérialisme.
C'est à cette duplicité herméneutique, qui préside à la duplicité de classe dans le contexte très fracturé de l'après-1989, que renvoie l'interminable débat qui a intéressé et continue d'intéresser les deux foyers de cette contraposition frontale : d'une part, les apologistes de la mondialisation ; d'autre part, ceux qui sont engagés dans l'élaboration des cahiers de doléances du mondialisme.
Les premiers (que l'on peut globalement qualifier de "mondialistes", malgré la pluralité kaléidoscopique de leurs positions) vantent les vertus de la marchandisation du monde. Au contraire, les seconds (qui ne coïncident que partiellement avec ceux que le débat public a baptisés "souverainistes") soulignent les contradictions et le caractère éminemment régressif du cadre antérieur centré sur les souverainetés nationales.
En bref, et sans entrer dans les méandres d'un débat pratiquement ingérable par la quantité des contenus et la diversité des approches, les panégyristes du mondialisme insistent sur la façon dont la mondialisation étend au monde entier la révolution industrielle, les progrès et les conquêtes de l'Occident ; ou, en d'autres termes, sur la façon dont elle "universalise" les réalisations d'une humanité en quelque sorte comprise comme "supérieure" et donc habilitée à organiser la "file unique" du développement linéaire de tous les peuples de la planète.
Même les auteurs les plus sobrement sceptiques quant à la valeur axiologique de la mondialisation, comme Stiglitz, semblent souffrir d'une attirance magnétique et finalement injustifiée pour le travail de transformation du monde en marché. Pour Stiglitz et son optimisme réformateur, ce processus, qui en même temps "planétarise" l'inégalité et la misère capitaliste, ne mérite pas d'être abandonné en raison des évolutions et des changements qu'il pourrait susciter.
20:51 Publié dans Actualité, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : diego fusaro, actualité, philosophie, philosophie politique, théorie politique, politologie, sciences politiques, néolibéralisme, mondialisation |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 21 octobre 2023
Carl Schmitt: État, mouvement, peuple

Carl Schmitt: État, mouvement, peuple
par Franco Brogioli
Source: https://www.centrostudilaruna.it/stato-movimento-popolo.html
Ce volume comprend Staat, Bewegung, Volk, écrit par le célèbre juriste et philosophe du droit allemand Carl Schmitt (1888-1985), l'un des principaux représentants de la révolution dite conservatrice, publié à Hambourg en 1933 et traduit en italien pour le Centro Librario Occidente de Palerme sous le titre Stato, Movimento, Popolo en 2021. Pour la première fois, il est publié seul en Italie.


En 1935, la maison d'édition Sansoni de Florence l'avait publié pour le compte de la Regia Università di Pisa sous la forme d'un recueil de trois essais de Schmitt intitulé, de manière quelque peu trompeuse il est vrai, Principii politici del nazionalsocialismo et préfacé par Arnaldo Volpicelli, alors professeur de doctrine de l'État à l'université de Pise. Deux de ces essais ont été repris en 1972 par le politologue Gianfranco Miglio, qui les a réédités sous le titre Le categorie del Politico : saggi di teoria politica (Les catégories du politique : essais de théorie politique) pour il Mulino, mais le texte sur l'État, le Mouvement, le Peuple n'y a pas été inclus, car Miglio le considérait comme dépassé. Cette lacune est aujourd'hui comblée. Il faut cependant reconnaître à Miglio le mérite d'avoir été le premier en Italie à rendre sa dignité scientifique à ce grand intellectuel européen.

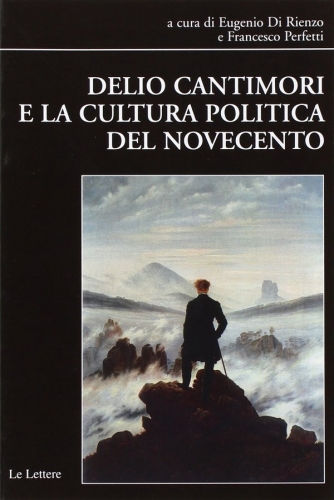
L'éditeur sicilien a voulu faire précéder l'essai de Schmitt par le texte intitulé Notes sur le national-socialisme de Delio Cantimori (photo), écrit en avril 1934, qui introduit le livre de Sansoni. Cantimori, alors âgé d'une trentaine d'années, était assistant à l'Institut d'études germaniques où il avait été appelé par Giovanni Gentile et rédacteur de la revue de l'Institut. Dans ces notes, il documente les origines et la montée au pouvoir du Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Pour Schmitt, en effet, le mouvement est autant État que Peuple et le pouvoir est fondé sur le Führerprinzip, c'est-à-dire le principe du chef suprême - Adolf Hitler - dans lequel le Peuple allemand se reconnaît intégralement, en vertu de l'égalité de lignage qui existe entre les citoyens du Troisième Reich germanique. Le juriste postule ce que devaient être les trois membres du nouvel État né de la révolution nationale-socialiste, qui, en ces mois, renaissait des cendres de la République libérale-démocratique et bourgeoise de Weimar, mais aussi l'élément unificateur.
Schmitt est né dans une famille catholique nombreuse et modeste à Plettenberg, en Westphalie protestante prussienne. Diplômé en 1910, docteur en droit de l'université de Strasbourg (alors incluse dans l'Allemagne wilhelminienne) en 1915 et professeur en 1916, il publie en 1921 Die Diktatur (La dictature), sur la constitution de la République de Weimar, en 1922 Politische Theologie (Théologie politique), hostile à la philosophie du droit, jugée trop formaliste, sur le rôle de l'État de droit dans la société, de Hans Kelsen, en 1923 Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus (La situation historico-intellectuelle du parlementarisme actuel) sur l'incompatibilité du libéralisme et de la démocratie de masse, et en 1927 Der Begriff des Politischen (Le concept du politique), sur la relation ami-ennemi comme critère constitutif de la dimension du "politique". Les positions exprimées par Schmitt au cours de cette période, jusqu'au début des années 1930, sont parfois désignées par le concept de Révolution conservatrice (Konservative Revolution). En 1932, il collabore avec le chancelier Kurt von Schleicher. Après avoir enseigné dans diverses universités allemandes, il devient professeur à l'université Humboldt de Berlin en 1933, poste qu'il est contraint de quitter en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il avait adhéré au parti national-socialiste le 1er mai 1933 et, en novembre de la même année, il devint président de la Vereinigung der nationalsozialistischen Juristen (Union des juristes nationaux-socialistes) ; en juin 1934, il devint rédacteur en chef de la Deutsche Juristen-Zeitung (Journal des juristes allemands).
Se référant à la promulgation des lois de Nuremberg de 1935, qui interdisaient les mariages et les relations extraconjugales entre Juifs et non-Juifs au nom du maintien de la "pureté du sang allemand", Schmitt observe : "Aujourd'hui, le peuple allemand est redevenu allemand, y compris d'un point de vue juridique. Après les lois du 15 septembre, le sang allemand et l'honneur allemand sont redevenus les concepts directeurs de notre droit. L'État est désormais un moyen de servir la force de l'unité völkisch. Le Reich allemand n'a qu'une seule bannière, le drapeau du mouvement national-socialiste; et ce drapeau n'est pas seulement composé de couleurs, mais aussi d'un grand et authentique symbole: le signe du serment du peuple de la croix à crochets" (C. Schmitt, "La Constitution de la liberté", 1935).
En décembre 1936, il est cependant accusé d'opportunisme dans la revue SS Das Schwarze Korps et doit renoncer à jouer un rôle de premier plan dans le régime. En 1937, des cercles du régime, dans un rapport confidentiel adressé à Alfred Rosenberg, critiquent Schmitt pour sa doctrine, accusée d'être imprégnée de "romanisme", pour ses relations avec l'Église catholique et pour son soutien au présidentialisme. Jusqu'à la fin du national-socialisme, Schmitt a surtout travaillé dans le domaine du droit international et s'est efforcé de fournir au régime des mots-clés dans ce domaine. C'est ainsi qu'il a forgé en 1939, au début de la Seconde Guerre mondiale, le concept de Völkerrechtliche Großraumordnung (ordre des grands espaces en droit international), une sorte de doctrine Monroe allemande, comme clé du nouveau droit international post-étatique et comme justification possible de la politique impérialiste d'Adolf Hitler. En outre, Carl Schmitt a participé à l'Aktion Ritterbusch, qui visait à soutenir l'effort de guerre de l'Allemagne nationale-socialiste par la participation active de personnalités du monde scientifique et culturel allemand, appelées à conseiller les politiques spatiales et démographiques du régime.
Capturé par les troupes alliées à la fin de la guerre, il risquait d'être jugé au procès de Nuremberg, mais il fut libéré en 1946 et retourna vivre dans sa ville natale, où il continua à travailler à titre privé et à publier dans le domaine du droit international. Cependant, il fut exclu de l'enseignement dans toutes les universités allemandes et aussi de l'Association des juristes allemands dans le cadre du programme de dénazification de l'Allemagne de l'après-guerre. Les expériences de cette période sont reflétées dans les essais Réponse à Nuremberg et Ex Captivitate Salus. Il est décédé en 1985, à l'âge de presque 97 ans.
En tant que juriste, Schmitt est l'un des théoriciens allemands du droit public et international les plus connus et les plus étudiés. Ses idées ont attiré et continuent d'attirer l'attention de spécialistes de la politique et du droit, notamment Walter Benjamin, Leo Strauss, Jacques Derrida, Chantal Mouffe et Slavoj Žižek, ainsi que, en Italie, Pierangelo Schiera, Carlo Galli, Mario Tronti, Massimo Cacciari, Gianfranco Miglio, Giacomo Marramao et Giorgio Agamben.

Sa pensée, qui plonge ses racines dans la religion catholique, s'articule autour des questions du pouvoir, de la violence et de la mise en œuvre du droit. Parmi ses concepts clés figurent, avec une formulation lapidaire, l'"état d'exception" (Ausnahmezustand), la "dictature" (Diktatur), la "souveraineté" (Souveranität), le katéchon et le "grand espace" (Großraum), et les définitions qu'il a inventées, telles que "théologie politique" (Politische Theologie), "gardien de la constitution" (Hüter der Verfassung), "dilatorischer Formelkompromiss" (dilatorischer Formelkompromiss), la "réalité constitutionnelle" (Verfassungswirklichkeit), le "décisionnisme" ou les oppositions dualistes telles que "légalité et légitimité" (Legalität und Legitimität), "loi et décret" (Gesetz und Maßnahme) et "hostis - inimicus" (la distinction entre ennemi et adversaire, la prémisse de la relation "ami-ennemi" comme critère constitutif de la sphère "politique").
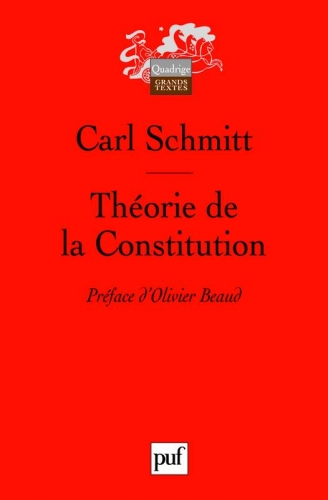
Outre le droit public et international, ses travaux abordent d'autres disciplines, telles que la politologie, la sociologie, les sciences historiques, la théologie et la philosophie (en mettant l'accent sur les aspects ontologiques du droit). Schmitt est aujourd'hui décrit par ses détracteurs comme un "juriste criminel", un théoricien douteux hostile aux démocraties libérales, mais il est en même temps qualifié de "classique de la pensée politique" (Herfried Münkler), notamment en raison de son influence sur le droit public et la science juridique dans la première République fédérale allemande (par exemple en ce qui concerne le "vote de défiance constructif", les limites matérielles du pouvoir de révision constitutionnelle, la limitation des droits fondamentaux des sujets subversifs de l'ordre constitutionnel ou de la "démocratie militante").
En Italie, après une période de méfiance due à ses liens avec le national-socialisme, sa pensée fait aujourd'hui l'objet d'une attention récurrente, notamment en ce qui concerne les problèmes juridiques et philosophico-politiques de la mondialisation (Danilo Zolo, Carlo Galli, Giacomo Marramao), la crise des catégories juridiques modernes (Pietro Barcellona, Massimo Cacciari, Emanuele Castrucci), les processus de transition constitutionnelle et l'expérience paradigmatique de la République de Weimar (Gianfranco Miglio, Fulco Lanchester, Angelo Bolaffi).
Schmitt a été influencé de manière décisive dans la formation de sa pensée par des philosophes politiques et des théoriciens de l'État tels que Thomas Hobbes, Jean Bodin, Emmanuel Joseph Sieyès, Niccolò Machiavelli, Jean-Jacques Rousseau, Louis de Bonald, Joseph de Maistre, Juan Donoso Cortés, mais aussi par des contemporains tels que Georges Sorel, Ernst Jünger et Vilfredo Pareto. Schmitt considérait comme son maître le juriste français Maurice Hauriou, le plus grand représentant de l'institutionnalisme, qu'il cite à plusieurs reprises dans ses œuvres et qu'il décrit comme "le maître de notre discipline".
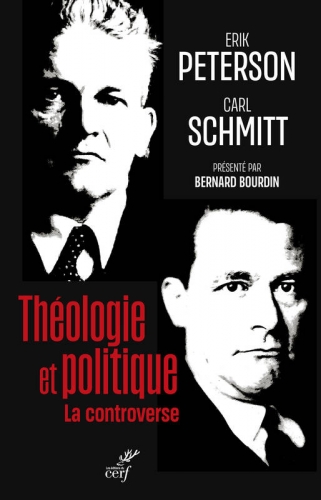
La compréhension que Schmitt a des concepts de la doctrine moderne de l'État est marquée par sa conviction que le système de la science juridique, en particulier le droit public, n'est pas autonome, mais plutôt imprégné, au cours de la sécularisation, d'une conceptualité théologique. Tous les concepts de la doctrine étatique sont des concepts théologiques sécularisés. Cette transposition ne concerne pas seulement le développement historique des concepts, mais aussi la composante métaphysique. La thèse de la sécularisation de Schmitt se reflète dans son concept de l'État. L'État est une instance absolue sécularisée et constitue la forme la plus intensive de l'unité politique. Cette unité s'est désintégrée au début du 20ème siècle avec l'avènement de la démocratie parlementaire, provoquée par l'antagonisme des classes et la confrontation entre les différents groupes d'intérêts économiques et sociaux, ce qui a rendu les décisions politiques unitaires difficiles ou impossibles. Le principe même de la majorité et de la minorité parlementaire n'est pas acceptable. L'unité ne peut être réalisée que s'il existe non seulement une égalité formelle, mais aussi une "uniformité substantielle de tout le peuple", qui peut être obtenue par l'exclusion ou l'anéantissement de tout élément étranger à l'uniformité. Un État dans lequel tous les citoyens sont égaux les uns aux autres est un "État total", qui représente le plus haut degré d'unité, puisque, par son ordre, il peut empêcher l'éclatement en groupes sociaux conflictuels et s'opposer à tout ce qui contredit l'uniformité substantielle. L'État exerce le monopole de la décision politique qui, pour Schmitt, coïncide avec la décision de savoir qui est l'ami et qui est l'ennemi : c'est pour Schmitt la distinction politique spécifique qui définit la sphère du "politique" et donc de l'État. L'ennemi n'est pas un adversaire en général, mais "essentiellement, dans un sens particulièrement intensif, quelque chose d'autre et d'étranger". L'État se caractérise donc par l'identification d'ennemis externes et internes à l'État : la détermination des premiers se fait par l'exercice du ius belli, celle des seconds par la neutralisation de ceux qui perturbent "la tranquillité, la sécurité et l'ordre" de l'État. Cette conception de "l'ennemi intérieur" a été largement invoquée lors de la conférence des juristes nationaux-socialistes allemands à Leipzig en 1933 pour justifier la politique raciale du régime : sans cette idée d'uniformité raciale, un État national-socialiste n'aurait pas pu exister. L'État de Schmitt est donc une unité politique suprême, fondée sur l'unité substantielle de tous ses membres, et montre sa force dans sa capacité à se débarrasser de ses ennemis intérieurs et extérieurs, jusqu'à les anéantir si nécessaire.
23:40 Publié dans Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolutionconservatrice, carl schmitt, philosophie politique, politologie, sciences politiques, théorie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 18 octobre 2023
Hans-Hermann Hoppe: Comment l’État moderne a détruit notre civilisation

Hans-Hermann Hoppe: Comment l’État moderne a détruit notre civilisation
Nicolas Bonnal
L’État en France, la bureaucratie à Bruxelles, l’administration Biden deviennent fous, liquidant/ruinant leur population, menaçant le reste du monde.
Un rappel…
Hans-Hermann Hoppe, philosophe allemand, disciple de Murray Rothbard, est un libertarien guénonien. Autant dire qu’il ne plaira pas à tout le monde: pour lui le système produit un phénomène de décivilisation dont on voit les effets terminaux en Europe comme en Amérique (effondrement moral, démographique, culturel, spirituel, et même socio-économique). Le phénomène se mondialise: voyez l’Asie et son déclin culturel et démographique (-30% de chinois en 2100, disparition de la Corée et du Japon, etc.).
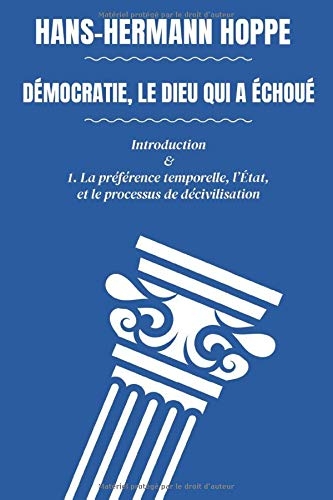
Le monde moderne nous a fait dégénérer en vertu de la perversion étatique qui a fabriqué le troupeau timide dont parle Tocqueville. Cet Etat nous ôte la peine de penser (BFM) et de vivre (euthanasie), vit à notre place et nous zombifie, nous privant de notre force vitale. Mais voici comment Hoppe en parle:
« Parmi les mesures les plus importantes en matière de politique sociale, citons l'introduction de la législation de "sécurité sociale", telle qu'elle a été introduite dans les années 1880 dans l'Allemagne de Bismarck, puis est devenue universelle dans tout le monde occidental à la suite de la Première Guerre mondiale. La tâche de devoir prendre en charge son propre âge, la portée et l'horizon temporel de l'action provisoire privée sera réduite. »
L’État bismarckien puis la sécu anéantissent la famille :
« En particulier, la valeur du mariage, de la famille et des enfants diminuera car ils sont moins nécessaires si l’on peut recourir à une assistance “publique”. En effet, depuis le début de l’ère démocratique et républicaine, tous les indicateurs de “dysfonctionnement familial” ont affiché une tendance systématique à la hausse: le nombre d’enfants a diminué, la taille de la population endogène a stagné ou même diminué et les taux de divorce, l'illégitimité, la monoparentalité, la singularité et l'avortement ont augmenté. De plus, les taux d’épargne des particuliers ont commencé à stagner ou même à baisser au lieu d’augmenter proportionnellement, voire excessivement, avec la hausse des revenus. »
 Cet État remplace aussi allègrement sa population, rappellent les libertariens. Et il est en plus belliciste.
Cet État remplace aussi allègrement sa population, rappellent les libertariens. Et il est en plus belliciste.
Je rappelle que pour Rothbard l’Etat sécuritaire (Welfare) est arrivé de pair avec l’Etat militaire (Warfare). Tocqueville parle aussi du goût démocratique pour la guerre interminable. Hoppe rappelle lui que le Far West était un endroit sûr et que la montée du Welfare a fait exploser partout la criminalité dans l’Amérique postmoderne (ce n’est pas la seule raison comme on sait) :
« Sur l'ampleur de la recrudescence des activités criminelles provoquée par le fonctionnement du républicanisme démocratique au cours des cent dernières années, à la suite de l'augmentation constante de la législation et d'un nombre toujours croissant de responsabilités "sociales" par opposition à des responsabilités privées ... voir McGrath, Gunfighters, Highwaymen et Vigilantes, en particulier... En comparant la criminalité dans certains des endroits les plus sauvages du "Far West" américain (deux villes frontalières et des camps miniers en Californie et au Nevada) avec celle de certains des endroits les plus sauvages du siècle actuel, McGrath ("Offrez-leur une bonne dose de Lead", pp. 17-18) résume ainsi en affirmant que les villes frontalières de Bodie et d'Aurora ont en fait rarement été victimes de vols… »
Et de rappeler à qui ne l’entendra pas :
« Les villes d'aujourd'hui, telles que Détroit, New York et Miami, subissent 20 fois plus de vols par habitant. Les États-Unis dans leur ensemble enregistrent en moyenne trois fois plus de vols qualifiés par habitant que Bodie et Aurora. Les cambriolages et les vols étaient également peu fréquents dans les villes minières. La plupart des villes américaines ont en moyenne 30 ou 40 fois plus de vols par habitant que Bodie et Aurora… Au début des années 1950, la ville de Los Angeles comptait environ 70 meurtres par an. Aujourd'hui, la ville subit en moyenne plus de 90 meurtres par mois… En 1952, 572 viols ont été rapportés à la police de Los Angeles, 2030 en 1992. Au cours des mêmes années, le nombre de vols qualifiés est passé de 2566 à 39.508 et le nombre de vols d'automobiles, de 6241 à 68.783. »

Il est bon de souligner le mensonge des westerns dont l’idéologie gauchiste a toujours fait bon marché des réalités historiques.
Puis Hoppe cite l’historien Fuller qui dénonce les horreurs de la conscription made in France :
« À partir du mois d'août [1793], lorsque le parlement de la République française décréta le service militaire obligatoire universel, la conscription a changé la base de la guerre. Jusque-là, les soldats avaient coûté cher, maintenant ils étaient bon marché; les batailles avaient été évitées, maintenant, elles étaient recherchées; si lourdes seraient les pertes, elles pourraient être comblées par le roulement de la conscription. Non seulement la guerre deviendrait de plus en plus illimitée, mais finalement elle serait totale. Au cours de la quatrième décennie du vingtième siècle, la vie était si peu coûteuse que le massacre de populations civiles sur des lignes massives était devenu un objectif stratégique reconnu, tout comme les batailles des guerres précédentes. En 150 ans, la conscription avait ramené le monde à la barbarie tribale. » (Fuller, The War of War, p. 33 et 35).
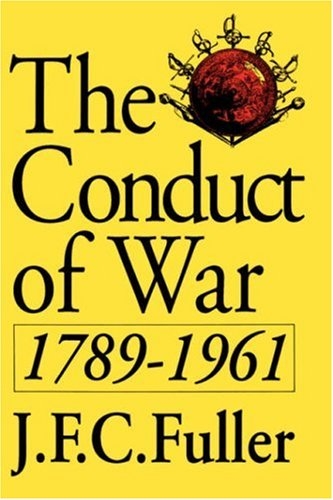
Allan Carlson rappellera que l’armée US a été un vecteur de subversion morale, sexuelle et sociale, en Europe comme en Asie ou en Océanie (cent films le démontrent).
Nous sommes entrés dans la phase finale de cette perversion avec bien sûr la Grande Guerre qui précipita notre dégénérescence politique (fascisme, communisme, étatisme-providence, etc.) et culturelle (peinture abstraite, musique dodécaphonique, littérature « moderne », « engagée », etc.); notre déclin est tel que nous ne le percevrons plus, alors que tout le monde continue d’écouter Bach ou Rameau, et que personne ne peut supporter Berg ou Webern. Mais Tolstoï dénonçait cette situation déjà en 1900 dans son passionnant petit essai sur l’art. Depuis, ayant touché le fond, nous avons continué de creuser…
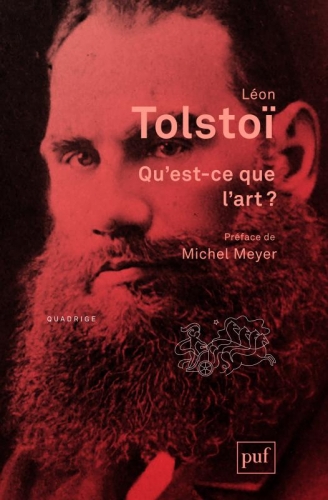
Hoppe :
« Depuis 1918, pratiquement tous les indicateurs de préférences temporelles élevées ont affiché une tendance à la hausse systématique: en ce qui concerne le gouvernement, le républicanisme démocratique a produit le communisme (et avec cet esclavage public et ce meurtre de masse parrainé par le gouvernement même en temps de paix), le fascisme, le socialisme national, enfin et de manière durable la social-démocratie ("libéralisme"). Le service militaire obligatoire est devenu presque universel, la fréquence et la brutalité des guerres étrangères et civiles ont augmenté, et le processus de centralisation politique a progressé plus que jamais. »
Et, alors qu’on nous annonce une crise finale (« achetez de l’or ! ») Hoppe ajoute sur la dégénérescence socio-économique et financière :
« En interne, le républicanisme démocratique a conduit à une augmentation permanente des impôts, des dettes et de l'emploi public. Cela a conduit à la destruction de l'étalon-or, à une inflation sans précédent du papier-monnaie et à un renforcement du protectionnisme et des contrôles de la migration. Même les dispositions de droit privé les plus fondamentales ont été perverties par une inondation incessante de lois et de règlementations… »
La pensée et les analyses factuelles de Hoppe (découvrez son œuvre sur Mises.org) démontrent en tout cas l’ancienneté de la crise occidentale et confirment le rôle sinistre de l’Etat et de la… révolution. Les folies étatiques actuelles (guerres impériales, remplacement, dettes, etc.) confirment cette analyse implacable. Je citerai pour conclure le vicomte Bonald qui est proche de Hans-Hermann Hoppe et qui écrivait après le cataclysme napoléonien :
« La disposition à inventer des machines s’est étendue aux choses morales. »
Sources:
- Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique
- Nicolas Bonnal, Chroniques sur la fin de l’histoire ; le coq hérétique (les belles lettres, 1997)
- Hans-Hermann Hoppe, The process of de-civilisation, in the costs of war (Mises.org). Reassessing presidency, chapter XXII (Mises.org)
- René Guénon, Le règne de la quantité et les signes des temps
23:35 Publié dans Actualité, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : état, théorie politique, philosophie politique, libertariens, hans-hermann hoppe, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 06 octobre 2023
La psychologie de la crise permanente

La psychologie de la crise permanente
Markku Siira
Source: https://markkusiira.com/2023/09/27/pysyvan-kriisiajan-psykologiaa/
"Guerre, changement climatique, stagnation économique, polarisation politique - les crises ne semblent pas manquer de nos jours", écrit Thomas Fazi.
L'année dernière, le mot permacrisis, qui signifie "une période prolongée d'instabilité et d'insécurité résultant d'une série de catastrophes", a été déclaré "mot de l'année" par le dictionnaire anglais Collins.
Si l'on remonte dans le temps, la conscience de la crise actuelle a été provoquée par la pandémie mondiale des taux d'intérêt, précédée par des "crises plus locales" telles que le Brexit et la crise des réfugiés européens, ainsi que par la crise financière qui a suivi 2008.
Comme l'a fait remarquer M. Fazi, si l'on considère les deux dernières décennies, on pourrait facilement conclure que "le monde est coincé dans un état de crise quasi permanent". Les défis tels que la guerre, l'inflation et le changement climatique ne montrent aucun signe d'apaisement; au contraire, ils semblent s'accélérer.



À première vue, cette analyse peut sembler sensée, mais Fazi (photo) se demande à juste titre si cette utilisation obsessionnelle du mot "crise" n'est qu'un simple constat d'une mauvaise situation, ou s'il s'agit d'autre chose.
Même avant l'ère du Coro navirus, plusieurs chercheurs critiques avaient suggéré qu'au cours des dernières décennies, la crise était devenue une "méthode de gouvernance" dans laquelle "les gouvernements exploitent systématiquement chaque catastrophe naturelle, chaque crise économique, chaque conflit militaire et chaque attaque terroriste pour radicaliser et accélérer la transformation des économies, des systèmes sociaux et des appareils d'État".
Le récit actuel ne se limite plus à l'exploitation des crises, mais semble reposer sur la création de crises de plus en plus nombreuses. Dans un tel système, la "crise" n'est plus l'exception, mais est devenue la norme, la prémisse de base de toute politique et action sociale.
L'élite transnationale a besoin de cette normalisation des crises. Elle est obligée de recourir à des mesures toujours plus répressives et militaristes - tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays - afin de rester au pouvoir et d'étouffer toute contestation de son autorité.

"D'où la nécessité d'un état de crise plus ou moins permanent capable de justifier de telles mesures", affirme M. Fazi.
La "nouvelle normalité" d'une crise permanente exige une acceptation générale de l'idée que les sociétés ne peuvent plus se permettre d'être organisées autour de règles, de normes et de lois stables. Le flux constant de nouvelles menaces - terrorisme, maladies, guerres, catastrophes naturelles - signifie que nous devons être prêts à nous adapter à des situations changeantes et à des états d'instabilité.
"Cela signifie également que nous ne pouvons plus nous permettre les débats publics nuancés et les politiques parlementaires complexes habituellement associés aux démocraties libérales occidentales. Les gouvernements doivent être en mesure de mettre en œuvre des décisions rapidement et efficacement", a déclaré M. Fazi avec sarcasme.
Ainsi, les dirigeants occidentaux associent aujourd'hui notre période de crise à la nécessité de limiter la liberté d'expression en ligne pour lutter contre la "désinformation", c'est-à-dire tout ce qui contredit le discours officiel.
La "perma-crise" donne également aux gouvernants une excuse pour ne pas améliorer l'état de la société, puisque toutes les ressources mobilisées doivent être concentrées sur la lutte contre "l'ennemi" du moment, qu'il s'agisse d'un virus, de la Russie, de la crise climatique ou d'autre chose. "Une crise sans fin, c'est l'éternel présent".
Comme l'évalue Fazi, cela représente "un changement radical dans la manière dont le concept de crise a été défini jusqu'à présent". Historiquement, la "crise" a souvent été associée à l'idée d'"opportunité", voire de "progrès".
La notion actuelle de "permacrise" implique au contraire "une situation qui est en permanence difficile ou qui s'aggrave - une situation qui ne peut jamais être résolue, mais seulement gérée".
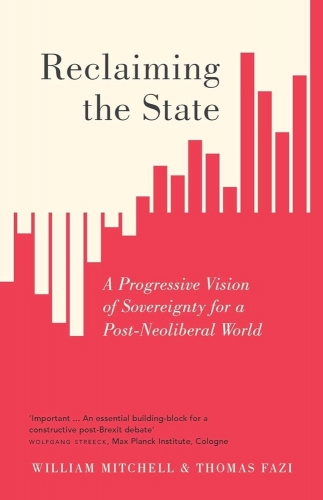
Bien que ce récit semble fondamentalement axé sur les solutions et tourné vers l'avenir, il est en fait "implicitement nihiliste et apolitique, parce qu'il suggère que le monde est condamné, quoi que nous fassions".
Cet ensemble de menaces presque apocalyptiques se manifeste dans le discours sur le changement climatique ou la crise écologique au sens large, pour lequel le discours dominant implique que toutes sortes d'interventions autoritaires et de restrictions sur la vie quotidienne des gens sont justifiées pour "sauver la planète".
Ce n'est pas une coïncidence si les partisans d'une crise permanente affirment que la nature mondiale de nombreuses crises signifie qu'elles ne peuvent être résolues qu'au niveau mondial, c'est-à-dire en déléguant de plus en plus de pouvoir de décision à des "experts" et à des institutions supranationales.
La "gouvernance" de la permacrise montre en fait que le cadre créé par le capital et les politiciens occidentaux, l'"ordre international fondé sur des règles", est en crise (auto-induite?). Il faudrait trouver un moyen de s'en sortir, mais qui pourrait régler le problème actuel ?
Même les concurrents de l'Occident parlent de "changements sans précédent" et d'un "nouvel ordre mondial". Ils affirment que "le projet d'américanisation du monde a échoué". La politique de puissance occidentale "n'est plus la réponse au monde" et l'ancien ordre libéral, "qui servait l'élite dirigeante et les capitalistes", sera abandonné.
Néanmoins, au vu des développements actuels, on peut se demander si, même si la "gouvernance mondiale" est mise à jour sous prétexte de crises, le nouvel ordre mondial (qui est de toute évidence éco-techno-fasciste) sera gouverné par plus ou moins le même petit cercle de riches cosmopolites qui ont jusqu'à présent été la force motrice des États.
19:23 Publié dans Actualité, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : permacrise, actualité, problèmes contemporains, thomas fazi, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 04 octobre 2023
Ordo pluriversalis. La pensée de Leonid Savin et la fin de la Pax Americana

Ordo pluriversalis. La pensée de Leonid Savin et la fin de la Pax Americana
Source: https://blog.ilgiornale.it/puglisi/2022/05/09/ordo-pluriversalis-il-pensiero-di-leonid-savin-e-la-fine-della-pax-americana/
Rédacteur en chef du magazine "Geopolitics" de l'université de Moscou et du site web "Geopolitica.ru", Leonid Savin, auteur et analyste prolifique, avec déjà trois publications en italien à son actif, est peut-être l'une des "plumes" les plus intéressantes pour ceux qui souhaitent comprendre ce qui se passe réellement, derrière l'écran de fumée de la propagande et de la guerre psychologique, dans l'esprit des classes dirigeantes moscovites chargées de gouverner le conflit en cours avec l'Ukraine: directeur de la Fondation pour le suivi et la prévision du développement des espaces culturels et territoriaux (FMPRKTP), membre de la Société militaro-scientifique du ministère russe de la défense, M. Savin est également l'un des principaux représentants du mouvement eurasiste international.

À cet égard, la récente publication en italien de l'essai Ordo pluriversalis. La fin de la pax americana e la nascita del mondo multipolare (= La fin de la pax americana et la naissance du monde multipolaire), publié par Anteo Edizioni, préfacé par Marco Ghisetti, jeune et brillant géopolitologue, qui avait déjà écrit, pour la même maison d'édition, l'essai Talassocrazia (préfacé d'ailleurs par Savin lui-même).
"L'ouvrage, explique Ghisetti, commence par constater que le soi-disant paradigme de la "paix américaine" s'est effondré à la suite des événements récents, ce que confirme clairement l'éclatement de guerres chaudes dans des régions et des zones que l'on croyait établies de longue date dans l'orbite de Washington. L'influence américaine recule en effet dans diverses régions du monde, mais plus qu'un affaiblissement général de la puissance outre-mer, c'est aussi un changement de stratégie, c'est-à-dire un repositionnement de Washington sur de nouvelles lignes stratégiques, qui est à l'origine de ce phénomène. Il est un fait, cependant, que la croissance des puissances dites révisionnistes, qui ont forcé les États-Unis à se retirer des régions qu'ils avaient tenté de conquérir, n'aboutit pas à une simple augmentation de leur puissance relative, mais s'accompagne au contraire d'un désarroi général et répandu à l'égard de la structure mondiale qui s'était dessinée ces derniers temps. C'est pour cette raison que la fin de la pax americana peut entraîner un véritable changement dans l'ensemble de l'ordre international et pas seulement dans l'équilibre des pouvoirs.
C'est pour cette raison que l'analyse de Savin entend aller plus loin que les nombreuses analyses déjà présentes, identifiant ainsi les raisons profondes, mais aussi les alternatives possibles à la phase de transition que nous vivons actuellement.
Par ailleurs, il apparaît clairement à la lecture de ce texte que l'objectif de Savin ne se limite pas à déconstruire ou à décrire la phase de crise actuelle. En effet, l'objectif de Savin est constructif : il espère pouvoir identifier et proposer des grammaires intellectuelles qui pourraient s'avérer utiles dans cette construction à la cimentation du nouvel ordre multipolaire en gestation.
Nous avons choisi de proposer cette nouvelle étude de Savin maintenant précisément parce que la récente action russe en Ukraine (à laquelle il faut ajouter l'énorme et inaperçu dynamisme de Moscou en Afrique subsaharienne) a non seulement rapidement confirmé ce que Savin avait pronostiqué, mais a également imposé la nécessité, pour tout acteur politique qui veut être plus qu'un simple objet de la politique de puissance des autres, ou pour tout analyste qui veut s'orienter dans la phase de transition actuelle, de comprendre pleinement à la fois les grandes stratégies des grandes puissances et la vision du monde qui les oriente.
Il est donc particulièrement important et utile pour le lecteur italien. En effet, l'Italie, qui se trouve au centre de la macro-région méditerranéenne et européenne, est un pays dont l'importance est, hélas, directement proportionnelle à l'inaptitude de sa classe dirigeante et au manque d'intérêt de l'opinion publique pour les affaires internationales, de sorte que l'Italie navigue sans boussole dans cette phase de transition houleuse. Le livre de Savin, qui malgré son titre et sa taille est vraiment facile et fluide à lire, a le potentiel d'offrir la boussole nécessaire pour s'orienter dans la phase de crise actuelle, avec la possibilité de répondre de manière plus consciente et appropriée aux choix que nous devrons bientôt faire".
 Mais quelles sont donc les alternatives au scénario mondial actuel proposées par l'auteur ?
Mais quelles sont donc les alternatives au scénario mondial actuel proposées par l'auteur ?
"Les alternatives au scénario actuel", poursuit Ghisetti, "dépendront des actions et de la volonté des acteurs en jeu, et du type d'ordre qu'ils voudront et parviendront à établir. Le multipolarisme, et en particulier la phase de transition actuelle, est un chantier ouvert. Pour Savin, l'ordre mondial ne dépend pas exclusivement de l'équilibre des puissances mondiales, car sa structure même n'est pas quelque chose de donné et d'immuable. En même temps, Savin affirme que de nombreux niveaux, de nombreuses visions et interprétations du monde coexistent dans la politique mondiale, qui sont tout aussi légitimes et qui influencent donc l'ordre mondial, quel qu'il soit. C'est pourquoi Savin préfère parler de "plurivers" plutôt que de multipolarisme. Pour l'essentiel et à l'heure actuelle, les principales alternatives sont celles des grandes puissances eurasiennes (Russie et Chine), auxquelles s'ajoutent celles du (ou des) monde(s) musulman(s) et latino-américain(s), dont le dénominateur commun est précisément l'opposition à la domination des schématismes ambiants et d'une puissance mondiale unique.
En fonction du succès de leurs politiques anti-hégémoniques, combiné à leur vision particulière du plurivers politique, ces puissances offriront l'opportunité à d'autres visions du monde de s'affirmer, même dans des régions ou des cultures qui leur sont éloignées. L'une de ces régions est précisément l'Europe, pour laquelle Savin consacre un chapitre entier au projet d'autonomie stratégique et au rôle particulier qu'elle pourrait jouer".
Quelles leçons peut-on tirer de l'essai et de la pensée de Savin à la lumière des événements récents ?
Une première leçon, poursuit l'éditeur de l'ouvrage, et la plus évidente, est que nous ne sommes plus dans une période de "paix" garantie par l'hégémon américain, si tant est que l'on puisse parler de paix, puisque certains auteurs ont préféré, pas tout à fait à tort, parler de "guerre sans fin" plutôt que de "paix américaine". Une deuxième leçon, qui découle directement de la première, est que, compte tenu des guerres qui ont maintenant éclaté précisément sur le sol européen, il ne nous est plus possible de supposer avec désinvolture et naïveté que notre sécurité peut dépendre entièrement de la volonté bienveillante d'un hégémon qui est manifestement disposé à nous laisser faire ses guerres (ou à faire ses guerres sur notre peau).
Une troisième leçon est que, dans la situation actuelle, nous devons décider de devenir responsables de notre propre destin et, par conséquent, de décider ce que nous voulons faire et ce que nous voulons être dans un monde où notre importance et l'influence de nos institutions politiques et économiques diminuent rapidement (sans parler de notre influence culturelle de plus en plus dérisoire). Une fois cette prise de conscience effectuée, les portes de tous les futurs alternatifs possibles s'ouvrent devant nous, vers lesquels nous avons la possibilité d'orienter notre avenir historique, si seulement nous sommes conscients de la situation et disposés à entreprendre les actions et les risques éventuels d'une telle entreprise.
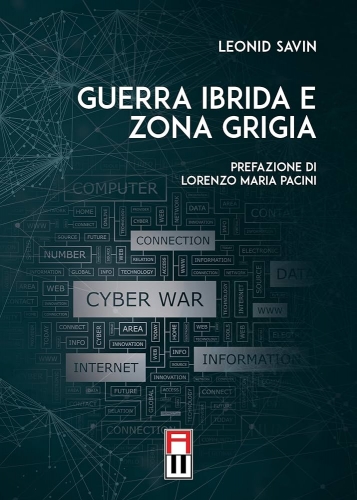 Quelle avancée l'"opération spéciale" décidée par le Kremlin en Ukraine peut-elle apporter à la transition vers un modèle polycentrique ?
Quelle avancée l'"opération spéciale" décidée par le Kremlin en Ukraine peut-elle apporter à la transition vers un modèle polycentrique ?
"Dans le livre, poursuit Ghisetti, Savin affirme clairement que l'engagement de la Russie dans la construction d'un modèle polycentrique pour le monde est une condition sine qua non, mais non suffisante à elle seule, pour le cimentage effectif d'un monde multipolaire. En effet, depuis plus de vingt ans, la Russie s'efforce de promouvoir la construction d'un monde dans lequel elle peut sauvegarder sa souveraineté et maintenir une certaine capacité de projection extérieure qui, aux yeux des hommes du Kremlin, se manifeste par une politique visant à faire jouer à Moscou un rôle stabilisateur et équilibrant dans les différentes régions du monde. Ainsi, avec la Chine et les Etats d'Asie centrale, elle a fixé une fois pour toutes leurs frontières respectives et tenté d'harmoniser ses projets d'intégration avec la Nouvelle Route de la Soie chinoise, évitant ainsi un jeu à somme nulle entre Pékin et Moscou en Asie centrale ; au Proche et au Moyen-Orient, Moscou est intervenue militairement et diplomatiquement pour stabiliser la région et évincer les acteurs qui fomentaient des divisions et des conflits interethniques et interreligieux ; dans l'Arctique, la Russie a également tenté de suivre la même politique, en jetant les bases des futures routes arctiques et en essayant d'éviter une course au réarmement dans la mer Glaciale.
La frontière avec l'Europe de l'Est est donc la dernière zone frontalière qui n'a pas encore été stabilisée, ou en tout cas pour laquelle une situation de jeu à somme nulle subsiste dans le projet d'intégration relatif (l'Union européenne), bien que Moscou ait essayé d'établir avec le projet d'intégration de l'UE une relation à certains égards similaire à celle de la Nouvelle Route de la Soie de la Chine. Cela n'a pas été possible en raison de la politique de l'OTAN visant à empêcher toute forme d'entente entre Bruxelles, Berlin et Moscou, ce qui a entraîné un jeu à somme nulle en Europe de l'Est, qui a fini par dégénérer en guerre en Ukraine.
La décision de Moscou de poursuivre ce qu'elle a appelé une "opération militaire spéciale", dont la logique suit celle de l'intervention en Syrie en faveur du gouvernement al-Assad, montre que les contradictions dans les relations de la Russie avec l'Occident commencent à se manifester et que, de la part de Poutine, il s'agit d'empêcher les dirigeants russes d'avoir des ambitions pro-occidentales. Cela ne signifie pas que Moscou a tourné le dos à l'Europe ou à son désir de stabiliser sa frontière occidentale. La Russie est bien consciente qu'elle ne peut se le permettre, et le fait qu'elle continue officiellement à qualifier celle en Ukraine d'"opération militaire spéciale" visant à la dénazification et à la neutralisation de l'Ukraine ou à la protection de la population russophone des républiques séparatistes en est la preuve.
Mais les politiques européennes visant, sous la pression américaine, à couper les liens avec la Russie, quitte à se castrer et à se détruire économiquement et socialement (la Russie, elle, est capable d'y survivre, car elle mène depuis vingt ans une politique étrangère multi-vectorielle et une quasi-autarcie à l'intérieur de ses frontières).
Les décisions prises au nom d'une morale vide ou de la loyauté envers le monde atlantique ne peuvent que, d'une part, prolonger la situation de guerre dans la zone frontalière euro-russe et, d'autre part, accélérer le déclin de l'Europe vers une situation d'isolement et d'insignifiance sur le plan international.
Mais la macro-région européenne reste l'une des plus stratégiques sur le plan international ; et c'est probablement pour cette raison que Savin, qui commence son étude par la crise du modèle occidental (d'abord eurocentrique, puis américano-centrique), la conclut par un chapitre consacré au déclin européen face à la volonté européenne, minoritaire mais actuelle, d'affirmer son autonomie stratégique et culturelle.
En d'autres termes, l'"opération militaire spéciale" de la Russie ne constitue pas tant un tournant dans la construction d'un monde polycentrique que son accélération, raccourcissant ainsi le délai dans lequel l'Italie et l'Europe doivent décider ce qu'elles veulent être et ce qu'elles veulent faire dans la phase transitoire actuelle, au risque de manquer l'appel de l'histoire et de tomber finalement dans l'oubli".
00:05 Publié dans Actualité, Géopolitique, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : leonid savin, théorie politique, politologie, sciences politiques, géopolitique, multipolarité, pluriversum, actualité, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 21 septembre 2023
Contre les "progressistes"

Contre les "progressistes"
Carlos x. Blanco
Le lecteur connaît déjà une série d'écrits de ma part, certains déjà anciens, tous destinés à dénoncer une grave imposture. L'imposture de ce qu'on appelle aujourd'hui "gauche", "progressisme", "éveil" (woke), etc. C'est toute une galaxie d'activistes, de leaders, d'enseignants, d'écrivains, de "penseurs" qui s'arrogent la possession absolue de la vérité et qui exercent de manière hégémonique et parfois totalitaire le pouvoir de censure ("culture de l'annulation" ou "cancel culture"). Les moins avisés ne peuvent manquer de remarquer un fait fondamental, qui s'impose d'emblée comme une réponse immédiate à la question suivante : qu'ont en commun des personnages et des approches aussi variés, apparemment si contradictoires entre eux ? Le capital. Le capital les finance et les met en œuvre.
Le progressisme, la "nouvelle gauche" post-moderne et "réveillée" se caractérise par :
(a) Un anti-marxisme forcené. La plupart d'entre eux font un usage partiel, ignorant ou tordu de l'héritage théorique ou scientifique de Marx et Engels. Ils nient le concept de classe et donc de lutte des classes. Ils le dénaturent en le subordonnant au concept de lutte identitaire (racialisée, sexiste, ethnique). Ils tentent de nous faire avaler un ragoût toxique: ils disent que l'identité ( ?), souvent indéfinie, est plus importante que la conscience de classe et l'exploitation d'une classe sur une autre. Ainsi, sous un habillage prétendument progressiste, ils reviennent aux pires méthodes du suprémacisme. Une race autrefois opprimée et asservie doit maintenant être la maîtresse de nos destinées. Un "genre" autrefois opprimé et exploité doit maintenant être privilégié. Un peuple ou une nation prétendument colonisé(e) dans le passé doit maintenant mettre ses bottes sur les nations autrefois dominantes. L'infantilisme et le crypto-fascisme de cette nouvelle gauche sont vraiment effrayants. Elle admet que le Blanc, le mâle, l'Européen, l'Espagnol, l'habitant du présent, possède une tache générique, un péché originel qui doit être lavé en raison des outrages commis par ses ancêtres et congénères il y a plusieurs siècles ou décennies. Ce suprémacisme qui fait porter aux populations d'aujourd'hui la "culpabilité" des exactions et des génocides du passé est intolérable. Un tel enfantillage nous conduit dans les ténèbres, et plus encore si l'on considère que la perspective de classe est délibérément occultée. C'est une classe exploitée (et en tant que classe, elle est multiraciale et composée de personnes des deux sexes) qui doit s'élever contre l'exploiteur. C'est le capitalisme qui produit le rêve de la raison et tous ses monstres, y compris le racisme, le colonialisme des peuples ou l'aliénation des femmes.
b) L'absence absolue de remise en cause du régime capitaliste dans sa version néo-libérale. De forts soupçons pèsent sur la gauche identitaire, post-moderne ou woke, anti-ouvrière, bourgeoise, financée par les grandes fondations d'ingénierie sociale, qui étendent leurs tentacules partout, y compris dans les partis politiques, les universités, les gestionnaires culturels, etc. Beaucoup d'argent a été investi pour enterrer la théorie de la valeur travail, le cœur du marxisme, dans l'oubli. La lutte idéologico-culturelle a été déconnectée de la lutte syndicale et de la lutte pour la souveraineté économique.
En Espagne, cela se voit très bien : qui finance toute cette pléthore de sites web et de plumes qui se consacrent à voir le fascisme partout, sauf chez Soros, chez les GAFAM, chez les fonds vautours et les banques habituelles? Qui se consacre à distribuer des cartes de fasciste ou de progressiste, selon le cas, comme s'il s'agissait du jugement divin à la fin des temps? Le système néolibéral paie 90% de ce qui est écrit sur le "progressisme". Je lis déjà de multiples articles de gauchistes (c'est ainsi qu'ils se présentent) assimilant Marx et le "travaillisme" au fascisme. Il en va de même pour les tentatives d'"annulation" d'autres auteurs qui, sans être strictement marxistes, défendent, avec d'authentiques marxistes, une perspective souverainiste espagnole (M. Gullo, Pedro Baños, etc.).
Il faut dénoncer la pseudo-gauche qui tente de nous refiler l'Agenda 2030 et le "monde sans frontières". De même, les gourous de la mort du travail et les partisans de l'oisiveté et de la "soupe universelle". Le marxisme espagnol doit être reconstruit dans une perspective souverainiste, au moyen d'un État du travail qui réalise une insubordination, c'est-à-dire qui se réindustrialise avec le protectionnisme et la déconnexion programmée (Gullo, S. Amin, Fusaro).
20:17 Publié dans Actualité, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, gauche, progressisme, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 20 septembre 2023
Le libéralisme liberticide
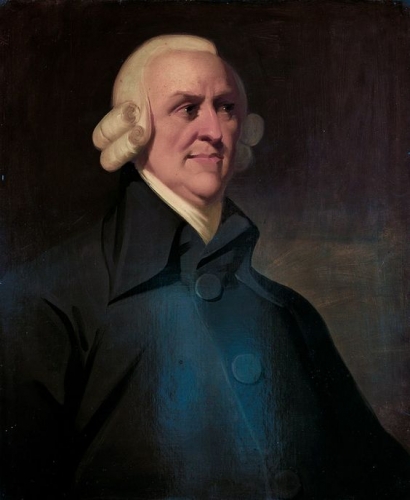
Le libéralisme liberticide
par Fabrizio Pezzani
Source : https://www.ariannaeditrice.it/articoli/il-liberismo-liberticida
La pensée unique libérale ou néolibérale d'aujourd'hui prétend trouver ses premières racines et sa légitimité dans les écrits d'Adam Smith, en particulier dans son ouvrage La richesse des nations écrit en 1767 et portant sur la signification du libre arbitre régulé par la main invisible du marché. Mais la véritable pensée de Smith est totalement asymétrique par rapport à cette interprétation. Le libéralisme, dans ce sens, devient une fin, et non un moyen comme Smith le pensait, et contribue à la formation d'un modèle d'analyse économique consacré exclusivement à une technicité exagérée et à une finance hégémonique qui a coupé ses liens avec les racines morales et sociales de cette science.
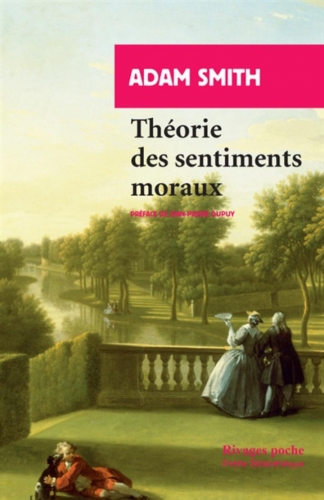
Pour comprendre la véritable pensée de Smith, il est nécessaire de le replacer dans l'histoire de son temps et de considérer ses œuvres dans leur intégralité, en commençant par la Théorie des sentiments moraux écrite en 1759 avant la Richesse des nations dont la lecture est fondamentale pour comprendre sa pensée. Le 18ème siècle, au cours duquel Adam Smith a vécu, est un siècle révolutionnaire d'un point de vue culturel, préparé par le siècle précédent au cours duquel le procès de Galilée et la révolution de Newton ont déterminé l'indépendance de la science face à l'unité de vie et de pensée qui avait été déterminée par la religion. Le 18ème siècle est le siècle des Lumières - le temps des lumières - où la pensée spéculative va affirmer la liberté de l'homme dans sa réalisation, le rôle de la raison et le principe d'une rationalité qui n'est pas absolue mais soumise à un ordre moral supérieur. Kant écrira la Critique de la raison pure et ouvrira la voie à l'idéalisme allemand et au matérialisme historique.
Les révolutions américaine et française clôtureront le siècle avec la déclaration des droits universels de l'homme - liberté, égalité et fraternité - en tant que fins absolues éloignées de l'intérêt personnel exclusif et égoïste. Smith, spécialiste écossais des Lumières, partage avec David Hume le rôle du "principe de sympathie" en tant que régulateur des relations humaines et de la capacité à s'identifier à l'autre. Le libre arbitre est affirmé, mais les choix individuels, tout en poursuivant l'intérêt personnel, doivent être soumis à l'intérêt collectif. En fait, écrit-il, le boulanger vend du pain en fonction de son intérêt personnel mais doit s'identifier aux besoins de ceux qui l'achètent, une forme de "concurrence collaborative" pourrait-on dire aujourd'hui. Pour lui comme pour ses contemporains, il était clair que les limites morales étaient insurmontables et que l'équilibre social devait être atteint en brisant l'égoïsme et l'altruisme qui définissent la conscience morale; des questions qu'il avait abordées dès le début de sa carrière en tant que chercheur dans le cadre de la philosophie morale qu'il enseignait.
Progressivement, au cours du siècle suivant - le 19ème siècle - la culture rationnelle et les sciences exactes ont pris le dessus et, selon les mots de Pascal, "l'esprit de géométrie" l'a emporté sur "l'esprit de finesse" et les raisons du cœur ont été de moins en moins écoutées par la raison. Ainsi le principe de sympathie collective sera remplacé par le principe d'utilité personnelle.
La vérité ne devient alors que ce qui se voit, se touche et se mesure et les sciences positives qui interprètent la vérité deviennent elles-mêmes des vérités incontestables et de savoirs instrumentaux prennent le statut de savoirs moraux et finalistes. Le "mirage de la rationalité" s'affirme, une illusion de la science plus dangereuse que l'ignorance.

Même l'économie subit cette mutation génétique et, de science sociale et morale, elle acquiert la nature de science positive et exacte et dicte les règles de la vie: on ne gagne pas pour vivre mais on vit pour gagner et on échange les fins contre les moyens comme l'avait indiqué Aristote avec le terme "chrématistique"; une richesse qui affame disait-on en rappelant le mythe du roi Midas. Lorsque la fin devient la maximisation de l'intérêt individuel, le libéralisme pris comme fin, exactement à l'opposé de Smith, affirme la loi du plus fort et aussi la normalisation des comportements illicites qui contribuent à définir une société perpétuellement conflictuelle et individualiste. Les dommages collatéraux de la réalisation de la fin sont l'inégalité, le chômage, la pauvreté et la dégradation morale. Dans les sociétés humaines, cependant, il devient difficile de comprendre les limites - les points de non-retour - au-delà desquels les dommages collatéraux deviennent primordiaux et, tôt ou tard, les calamités fatales de la guerre et de la classe s'affirment.
Nous sommes aujourd'hui confrontés à un libéralisme qui, poussé à son terme, tue la liberté - un oxymore - et devient "liberticide". Nous sommes encore confrontés à un absolutisme culturel qui semblait avoir été vaincu par les expériences douloureuses du siècle dernier, mais qui nous apparaît aujourd'hui sous un jour trompeur.
L'économie doit se réconcilier avec sa nature de science morale et sociale, "un nouveau paradigme est nécessaire car ce qui est en jeu est plus que la crédibilité de la profession ou des décideurs politiques qui utilisent ses idées, mais la stabilité et la prospérité de nos économies" (Stiglitz, Il Sole24Ore, 2010) et de nos sociétés.
20:58 Publié dans Définitions, Economie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : définition, libéralisme, adam smith, économie, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



